samedi, 05 février 2022
Robert Stark et le centre radical

Robert Stark et le centre radical
par Joakim Andersen
Source: https://motpol.nu/oskorei/2022/01/21/robert-stark-och-den-radikala-mitten/
La droite alternative, l'Alt-Right, devrait être familière à la plupart des gens qui nous lisent, la gauche alternative naissante a été étouffée dans l'œuf lorsque Trump a associé de manière désobligeante mais incorrecte le terme à l'AFA. Moins connu est le phénomène qui a été baptisé "alt-center" et "radical centrism" dans le monde anglophone, peut-être mieux traduit en anglais par "the radical middle" (malgré les mérites évidents de "alt-mitten"). Un représentant intéressant du phénomène, et ce, à bien des égards, est le penseur et écrivain californien Robert Stark. Les écrits de Stark peuvent se trouver sur son Substack et offrent souvent des perspectives et des informations rafraîchissantes. Il a écrit de manière intelligente sur tout, de la rémunération des citoyens et de l'enclavisme à la xénophobie anti-blanche et à la politique d'indépendance de la Californie.
Stark a décrit le centre radical dans des textes tels que A Proposal for a New Alt-Center : Philosophy & Policy, The Alt-Center Revisited, et Alt-Center Lexicon. Plutôt que d'être défini comme un populiste, il est décrit comme le porte-paroles du "contre-élitisme comme voie vers le pouvoir" ; plutôt qu'un mélange d'idées de droite et de gauche, il souligne l'importance de les ancrer dans des "principes fondamentaux à ne pas perdre".
Ces valeurs fondamentales recoupent largement celles de la droite, notamment une "vision droitière/réaliste de la nature humaine qui est tribale et hiérarchique, et non égalitaire". Stark note que "l'on peut adhérer à certaines politiques de gauche mais seulement si l'on rejette le cadre philosophique de la gauche, notamment l'égalitarisme et l'autonomie individuelle radicale". Il fait penser à Burnham et à la tradition machiavélique des idées antilibérales du type "les alter-centristes, comme l'extrême gauche et l'extrême droite, comprennent cette dialectique du pouvoir et doivent travailler sur les moyens de mieux la gérer pour éviter les abus de pouvoir" et "le tribalisme est nécessaire pour protéger les libertés civiles, car une autonomie individuelle radicale rend vulnérable ceux qui comprennent la dynamique du pouvoir". Une description plutôt simpliste du centre radical pourrait être qu'il part d'une vision du monde qui recoupe celle de la droite, mais qu'il est plus ouvert à des solutions qui recoupent celles de la gauche.

L'intérêt que suscite la politique centriste radicale, malgré le nombre limité de ses protagonistes à l'heure actuelle, est fortement lié à la politique des classes et des castes. Le conflit entre les "gens ordinaires" d'une part et les "élites" et certaines couches moyennes d'autre part traverse particulièrement les groupes de souche européenne aux Etats-Unis. Les premiers gravitent vers divers types de populisme, les seconds se sont ralliés aux idées désormais qualifiées de "woke". Le conflit est infecté et verrouillé, notamment parce qu'il est difficile de faire adopter par les élites et les classes moyennes des positions associées aux gens ordinaires.
Les néoréactionnaires constituaient, à leur époque, une tentative d'attirer les couches de l'élite, dans leur terminologie les "brahmanes", vers une vision du monde plus constructive et une alliance avec les gens ordinaires. L'"alt-center" pourrait contribuer à quelque chose de similaire. Un exemple intéressant de ce phénomène - qui montre d'ailleurs à ceux qui sont familiers avec l'ethnopluralisme de la nouvelle droite et l'ancien austro-marxisme comment des idées similaires reviennent sans cesse - est ce que Stark appelle le multiculturalisme de droite. L'idée est plus facile à appliquer à la Californie qu'aux foyers primordiaux des peuples européens, mais Stark affirme dans tous les cas que "le multiculturalisme de droite est le seul cadre qui puisse concilier les différences entre la gauche pro-diversité et la droite identitaire". Il note également que le multiculturalisme de la "gauche" est faux, "contrairement à la gauche qui est sélective quant aux groupes qui devraient avoir plus de droits, le multiculturalisme de droite respecte la légitimité de tous les groupes ayant des droits égaux pour faire pression en faveur de leurs intérêts collectifs." Il est tout à fait possible que les libéraux blancs finissent par se rapprocher, par pure préservation, de la position esquissée par Stark, quel que soit le nom qu'ils lui donnent alors.

L'analyse de Stark sur la question du logement est également intéressante. C'est le point de mire de penseurs comme Kotkin et Guilluy, ainsi que du débat sur la gentrification, mais l'approche de Stark est innovante. Il décrit deux positions sur la question de l'augmentation de la construction de logements, qu'il appelle NIMBY et YIMBY. NIMBY, "not in my back-yard" (pas dans mon jardin), est associé à l'opposition à la construction d'appartements, souvent fondée sur des préoccupations en matière d'espaces verts, d'architecture et de critique de l'immigration. Cela peut donc sembler être une attitude sympathique. Le point de Stark est que beaucoup de NIMBYs sont des libéraux blancs, ce qui donne à l'ensemble un aspect de deux poids deux mesures. Ils sont pour des "frontières ouvertes" mais ils ne veulent pas de voisins pauvres. Les conséquences pour les jeunes Blancs, souvent leurs propres enfants et petits-enfants, sont graves. Ils doivent choisir entre rester à la maison, quitter la grande ville ou devenir des hipsters sans enfants. Quelle que soit l'opinion que l'on a sur la question, et notamment sur l'avenir des banlieues résidentielles, les arguments avancés par Stark sont intéressants. Il établit clairement un lien avec la politique générationnelle. Dans un article intitulé White Millennials : America's Sacrificial Lamb, il mentionne que les Millennials ne possèdent que 4,2 % de la richesse américaine. Ici aussi, il espère des opportunités pour de nouvelles alliances "entre la gauche woke pro-diversité et inclusion et la droite identitaire anti-grand remplacement contre l'establishment existant en Californie".
Le raisonnement de Stark sur l'expérience de pensée qu'il appelle "le grand échange de classes", dans lequel il cherche à contrer à la fois l'inégalité croissante et les tendances dysgéniques, est également très novateur. Il le décrit comme "un scénario dans lequel la richesse est redistribuée du haut vers le bas vers les masses tandis que la composition génétique de la tranche supérieure est également redistribuée vers le bas", avec des éléments à la fois de socialisme et d'eugénisme (les amis de Jouvenel peuvent bien sûr objecter ici que la redistribution et le socialisme sont deux choses différentes).
Dans l'ensemble, nous constatons donc que Stark représente un phénomène de dimension certes modeste mais intéressant. L'avenir nous dira si cette dernière tentative de dépasser la droite et la gauche débouchera sur quelque chose de concret, notamment si certaines classes moyennes blanches ont le sentiment d'être perdantes face aux pratiques hégémoniques actuelles et ont quelque chose à gagner des idées que Stark et d'autres mettent en avant. Ce qui n'est pas tout à fait improbable, Stark parle d'une partie de l'alt-middle comme "une niche démographique SWPL, des groupes issus de milieux plus cosmopolites en contraste avec la démographie traditionnelle du populisme, qui ont été attirés par des vues dissidentes en réaction à la surproduction de l'élite et aux excès de la politique du wok". Une évolution positive, non seulement parce qu'elle divise l'équipe adverse et apporte des compétences et des ressources à notre côté. L'alt-centrisme présente des défauts et des limites, notamment en raison de ses origines américaines, mais le phénomène peut s'avérer historiquement positif.
11:32 Publié dans Actualité, Sociologie, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : alt-center, robert stark, sociologie, théorie politique, politologie, sciences politiques, philosophie politique |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
vendredi, 21 janvier 2022
Une pensée méconnue : le manifeste de Troy Southgate pour le mouvement national-anarchiste

Une pensée méconnue : le manifeste de Troy Southgate pour le mouvement national-anarchiste
Par Pietro Missiaggia
Source: https://pietromissiaggia.blogspot.com/2022/01/un-pensiero-misconosciuto-il-manifesto.html?fbclid=IwAR3541n_aVYDVTI9hXtjW0eGVBf25vzZexYKp17AHuwdAvDaZOhVQr5BGco
Lorsqu'un spécialiste italien des doctrines politiques, lorsqu'un historien de la "droite radicale", ou de la soi-disant "gauche révolutionnaire" ou des mouvements anarchistes entend parler du national-anarchisme et de son principal idéologue, Troy Southgate, il est à la fois perplexe et dubitatif face à un tel penseur et à une vision du monde (Weltanschauung) aussi novatrice, mais complètement ignorés dans le contexte de l'Europe méditerranéenne ; l'Italie, cependant, fait exception à la règle à certains égards.
Troy Southgate est né à Londres en 1965, a obtenu un diplôme d'histoire et de théologie à l'université du Kent et est devenu l'idéologue d'un mouvement national-anarchiste qui vise à créer de nouvelles synthèses et à dépasser la droite et la gauche. En Italie, heureusement, la pensée de Southgate a été lue et connue, même si c'est de façon marginale, grâce à l'initiative de diffusion mise en place par les Edizioni Sì qui ont publié son Manifeste national-anarchiste (Edizioni Sì, Milano,2018) et grâce à l'intérêt de Libere Comunità, qui reprend en partie la pensée de Southgate dans son élaboration communautaire. Cet article a pour but de tenter d'illustrer objectivement la pensée de Southgate et de comprendre ce que le lecteur italien peut tirer de ses idées à notre époque de pure dissolution.
Commençons par le début ; par la signification du national-anarchisme ; qu'est-ce que cela signifie ? Que représente-t-il ? Un oxymore ? Absolument pas, car pour Southgate l'anarchisme doit se libérer des déformations dont la gauche l'a imprégné. La gauche est une idéologie fonctionnelle au système ; en effet, le jeune anarchiste qui se réclamera de la gauche en pensant être vraiment anarchiste restera un hédoniste qui critique la société au sein d'un simple mouvement plus ou moins "militant" mais en fait, ce mouvement fait partie intégrante du système car il ne peut pas dépasser le matérialisme de l'anarcho-communisme et ne peut séparer la pensée de penseurs comme Bakounine, Kropotkine ou Proudhon de celle du marxisme.
En effet, ils ne savent souvent même pas qui est Marx et se contentent de boire une bouteille de coca pour l'oublier. À cet égard, les propos de Nicolás Gómez Dávila sur le fait que les insignes délavés du parti communiste sont désormais oubliés et laissés dans un placard sombre et que l'avenir appartient à Coca Cola et à la pornographie (voir Pensieri Antimoderni, Edizioni di AR, Padoue, 2010) sont parfaitement d'actualité. Une autre erreur commise par la gauche, bien qu'elle ne l'admettra jamais selon Southgate: le fait d'avoir transformé l'anarchie, ainsi que toute idéologie qui est entrée en contact avec son substrat culturel, en un système dogmatique, paranoïaque et centralisé.
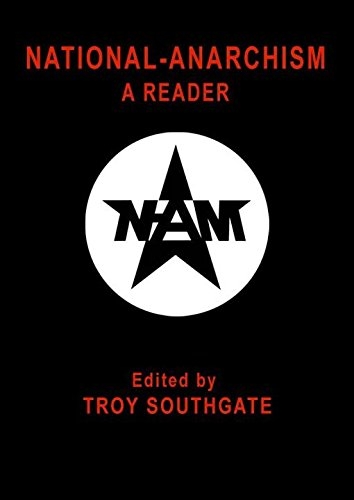
Actuels sont les mots de notre idéologue lorsqu'il déclare : "[...] la majorité des gens de gauche, ne pourront pas se reposer tant qu'ils ne seront pas capables d'organiser chaque minute de la vie des autres" (Op.cit. Milan, 2018 cit. p.30). "La gauche, tout comme la droite totalitaire, refuse de tolérer quiconque tente de s'opposer à sa vision d'une société inclusive" (Ibid). La gauche, pour Southgate, fait partie d'un système paranoïaque et obsessionnel-compulsif (nous citons à cet égard le texte de Kerry Bolton, The Psychopathic Left, Gingko Edizioni, Vérone, 2018); d'une mentalité totalitaire héritée en partie des totalitarismes du vingtième siècle et par ailleurs de son propre dogmatisme sécularisé qui ne peut pas penser au-delà du vingtième siècle qui est passé et bien passé.
La dialectique marxienne est aujourd'hui dépassée ; ses adeptes devraient couper leurs propres branches mortes pour faire pousser de nouveaux bourgeons à leur "arbre idéologique", mais très souvent ils ne le font pas parce qu'ils ont oublié les textes et les leçons de Marx et la façon de se renouveler.
Des observations similaires sur la mentalité de la gauche ont également été faites par Theodore Kaczynski dans son célèbre manifeste La société industrielle et son avenir, où il décrit, dès les premières pages, la nature paranoïaque de la gauche contemporaine qui, au lieu de critiquer la modernité libérale, se concentre sur la peur de l'"ennemi intérieur" (toute personne qui ne partage pas les idéaux de la gauche), comme si nous étions encore à l'époque de la révolution d'Octobre et que nos radicaux-chics étaient des révolutionnaires bolcheviques, ainsi que sur le fait qu'ils acceptent la modernité et en font partie; parce qu'elle ne sait pas dépasser le matérialisme et l'économisme pur pour atteindre de nouveaux sommets et de nouvelles synthèses, comme l'a également dit le philosophe français Alain De Benoist (Cf. Sull'orlo del baratro, Arianna Editrice, Bologne, 2014). Cela fait mal, mais c'est l'amère vérité.

Pour Southgate, l'anarchie ne consiste donc pas à "faire du désordre dans les rues", c'est-à-dire à exprimer de la simple protestation qui, aujourd'hui, souvent et volontairement, ne mène à rien sinon à rester dans le système, à faire de la "voix", comme on dit. Cependant il est nécessaire de rejeter le système, de faire entrer la liberté intérieure dans le monde terrestre, dans le monde extérieur, temporel et physique car c'est ce qui conduit à une sortie libre du système comme Nick Land l'a dit dans son Dark Enlightenment (Gog Edizioni, Rome, 2021) ; il est nécessaire d'être conscient de notre propre liberté et individualité qui nous conduit à construire et ériger une communauté (un nouveau tribalisme selon les mots de Southgate) qui rejette le centralisme de l'État-nation moderne.
La vision communautaire de Southgate n'est pas un anarchisme qui rejette l'autorité, comme on l'entend communément, mais un anarchisme qui se donne une autorité qui est naturelle : celle d'une communauté composée d'hommes différenciés, radicaux, unis par une même Weltanschauung (une vision commune du monde) ; à cet égard, plusieurs mots sont consacrés dans le Manifeste au facteur ethnico-racial et à l'identité d'une communauté nationale-anarchiste ; pour Southgate, contrairement à l'interprétation qu'en font ses détracteurs, le problème n'est pas tant d'être en faveur d'un ethno-nationalisme ou d'une communauté de différents groupes ethniques, mais de trouver un substrat commun pour s'organiser sur une vision plus spirituelle de la vie qui dépasse le simple biologisme ; pour lui, tant le suprémacisme racial que le multiculturalisme antiraciste restent des expédients très grossiers ; on peut dire que ces deux filons font partie du même paradigme néo-libéral, qui n'est ni ethno-national ni multiculturel, puisqu'il veut la destruction de toutes les cultures et de toutes les racines, qu'elles soient ethniques, sociales, ou de toute identité (car toute identité est désormais liquide pour paraphraser Bauman); la base du système est thalassocratique et a en commun la mentalité américaine, mais elle est aussi profondément mono-culturelle ; elle veut comme vision du monde la seule société libérale de marché, où précisément le seul modèle préconisé est celui de l'anéantissement de toutes les différences au profit de l'américanisme et enfin, le système prône la primauté de l'Économique sur le Politique (tel que définit par Carl Schmitt).
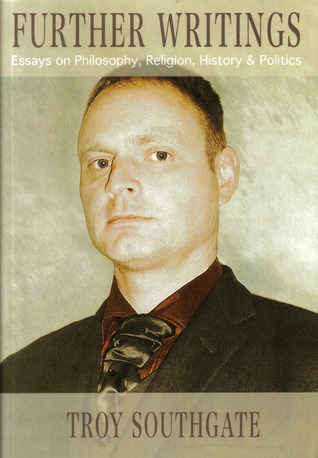
Un autre facteur inhabituel dans la philosophie de Southgate est le facteur de "liaison" entre les communautés nationales-anarchistes ; elles devraient d'une manière ou d'une autre se coordonner malgré leurs différences afin de combattre, au moins dans un premier temps, le centralisme étatique. "Nos communautés villageoises devront s'armer convenablement pour survivre" (cit. p.71) écrit notre auteur dans son Manifeste au chapitre neuf consacré à la Défense (pp.71-74). Il se pose, spontanément, la question de savoir si l'on voit le monde à partir d'une vision géopolitique schmittienne donnée par les grands espaces ; si les petites communautés et les réalités localistes peuvent rejoindre l'essor de l'ère des blocs continentaux et l'avenir de la multipolarité comme nouvel ordre mondial ; la vision géopolitique des grands espaces (par exemple les espaces européen, anglosphérique, africain, eurasien-russe, etc. ) peut être combiné avec, d'une part, un centralisme étatique et, d'autre part, de petites communautés autonomes qui, d'une manière ou d'une autre, se coordonnent entre elles pour former des espaces plus vastes en fonction de leur propre culture et de leur situation géographique dans le monde (évidemment, un national-anarchisme en Amérique latine sera différent d'un national-anarchisme dans l'Anglosphère ou en Europe centrale).
Avant d'en arriver à la conclusion et à quel type humain Southgate se réfère, je voudrais dire quelques mots sur sa vision de la droite radicale ; bien que son parcours politique soit typique de ce milieu, il critique le national-socialisme allemand et le fascisme italien, considérés comme lourds et totalitaires, semblables à bien des égards à la mentalité de la gauche, prenant comme point de référence les mouvements, composés en majorité d'intellectuels et dépourvus d'un véritable corpus idéologique commun, de la Révolution conservatrice (cit. p.40). Nous en venons maintenant au type humain et à la manière dont, à notre époque, les idéaux national-anarchistes peuvent être appliqués, au moins dans notre substrat spirituel. En partant du fait que les idées de Southgate, au fil des années, sont demeurées ouvertes à une synthèse ultérieure dans une direction traditionnelle, mais que malheureusement, nous, en Italie, n'avons pas été en mesure de lire et d'approfondir cela est dû au manque de connaissance de son travail dans le sud de l'Europe comme je l'ai mentionné au début de cette analyse.
Cela dit, quel est le type humain national-anarchiste ? Laissons notre auteur s'exprimer à ce sujet : "Nous recherchons un nouveau type d'individu, quelqu'un qui est prêt à faire passer ses idéaux avant tout le reste. C'est la marque qui identifie un véritable révolutionnaire ; un activiste au service désintéressé de sa nation et de son identité" (cit. p.80). "En particulier de la part des hommes dans leurs rangs qui sont prêts à mourir pour leur foi. Un tel héroïsme face à des forces aussi écrasantes ne peut que nous inspirer" (Ibid.). Enfin, "Nos idéaux doivent susciter en nous le même niveau d'engagement et de fanatisme, doivent nous donner la même force intérieure qui génère l'invincibilité. Ce n'est que si nous sommes capables d'y parvenir que nous pourrons devenir une force capable d'affronter nos ennemis" (cit. p.81).
Le type humain national-anarchiste est comparable à l'Homme différencié de Julius Evola ou au Sujet radical d'Aleksandr Dugin ou encore à l'Anarque de Jünger ; il doit être matériellement engagé dans le changement révolutionnaire ; dans la lutte permanente contre le Système actuel incarné par le globalisme libéral mais, il doit aussi être juste et mener sa propre guerre intérieure avant sa véritable vie militante. A cet égard ; je crois que l'Anarchisme National peut être une réponse conjugable à l'idée de Tradition, de l'idéal de l'unité des peuples dans un grand Espace comme évoqué par Carl Schmitt car il est, en plus d'être une voie politique, une voie intérieure, une manière d'être dans laquelle des hommes différenciés, armés de leur propre vision du monde, voient comme la seule voie capable d'unir pour faire se désintégrer le Système.
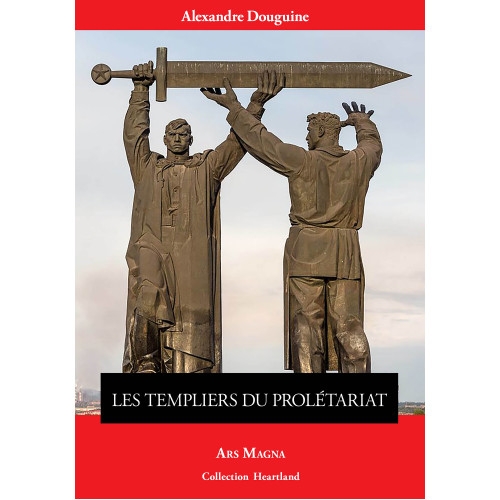
À cet égard, malgré les différences et les divergences entre la vision de Troy Southgate et celle d'Alexandre Douguine sur la Quatrième théorie politique, l'eurasisme et le national-bolchevisme, je voudrais terminer en citant des passages des Templiers du prolétariat écrits par le philosophe et activiste russe en 1997 (publiés par AGA, Milan, 2021) ; bien que ces textes se réfèrent à la réalité post-soviétique des années 1990, ils sont encore très pertinents pour notre époque: "Une fois de plus, [il] révèle un certain type commun, l'intellectuel [...], le national-révolutionnaire, radical et paradoxal, l'artiste engagé en politique, le conspirateur, le mystique et (dans son apparence extérieure) le pervers. On pourrait ajouter : le fou" (op. cit. p.108). "Le traditionalisme propre au national-bolchevisme, en général, est certainement un ésotérisme de gauche, dont les caractéristiques reprennent les principes du Kuala tantrique et la doctrine de la transcendance destructive. Le rationalisme et l'humanisme individualiste ont détruit de l'intérieur les organisations du monde moderne qui possédaient nominalement un caractère sacré. Il est impossible d'établir les conditions cérémonielles de la Tradition par une amélioration générale de la situation présente. Dans une phase eschatologique, cette voie de l'ésotérisme de droite est clairement vouée à l'échec. De plus, les appels à l'évolution et au gradualisme ne font que favoriser l'expansion libérale" (cit. p. 46).
Si l'on fait abstraction de la réalité russe de l'époque où ces discours ésotériques sur la Voie de la Main Gauche, décrite antérieurement par Evola, discours repris dans cet ouvrage par Douguine, il faut, à notre époque, non seulement chevaucher le Tigre et se tenir au-dessus des ruines, comme le disait Evola en son temps, être vraiment différencié, aller à contre-courant et être libre d'esprit afin de trouver notre chemin spirituel dans notre propre individualité ; seuls nous, les individus, pouvons le faire (ce qui a déjà été décrit par Jünger et dans les textes des différentes traditions ésotériques - voir le Zen du Maître Yoka Daishi à titre d'exemple) et, après cela, nous pourrons trouver d'autres hommes différenciés, dédiés à l'action matérielle et à la création de communautés et de nouveaux paradigmes étatiques qui conduiront à la Désintégration du Système (Edizioni di AR, Padova, 2010) selon le processus décrit par Franco Giorgio Freda dans les années 60 et 70 et à l'avènement de notre homme différencié, qui non seulement sera debout, mais dansera au-dessus des ruines de la civilisation capitaliste tandis que la dernière révolution sera menée par l'Acéphale, le porteur sans tête de la croix, de la faucille et du marteau, couronné par l'éternelle svastika solaire (Op. cit. p. 48).
La fin de notre monde ; elle partira de nous qui savons y résister et au bon moment de sa dissolution complète et donc de sa fin; nous danserons sur ses décombres parce que nous sommes partis de multiples synthèses ; une parmi toutes, il y a le national-anarchisme de Troy Southgate. En attendant le futur d'un nouvel âge d'or.
Pour se procurer les ouvrages de Troy Southgate:
1) https://www.amazon.fr/Tradition-Revolution-Collected-Writings-Southgate/dp/8792136028
2) https://www.amazon.co.uk/Radical-Tradition-Philosophy-Metapolitics-Conservative/dp/0473174979
3) https://www.goodreads.com/book/show/11064705-further-writings
Pour accéder à la boutique de Troy Southgate:
https://blackfrontpress.wordpress.com/publications/
Troy Southgate en langue espagnole:
https://editorialeas.com/?s=southgate (le Manifeste + Un ouvrage sur le Saint-Empire)
12:23 Publié dans Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : troy southgate, national-anarchisme, anarchisme, théorie politique, politologie, sciences politiques, philosophie, philosophie politique |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
samedi, 15 janvier 2022
Futurisme social et démocratie participative contre la loi d'airain de l'oligarchie financière

Futurisme social et démocratie participative contre la loi d'airain de l'oligarchie financière
par Francesco Carlesi
Ex: https://www.lavocedelpatriota.it/futurismo-sociale-e-democrazia-partecipativa-contro-la-legge-ferrea-delloligarchia-finanziaria/
Mosca, Pareto et Michels sont trois grands penseurs du début du 20e siècle qui ont étudié l'influence des oligarchies derrière les processus démocratiques. Michels a parlé de la "loi d'airain de l'oligarchie" selon laquelle les intérêts privés des groupes organisés et "cachés" s'affirmeraient toujours en fin de compte dans chaque parti et système politique. Ces concepts n'ont pas perdu leur validité ; au contraire, ils semblent décrire l'actualité brûlante de la crise de la politique et de la société. Ces dernières années, la démocratie libérale et représentative a exacerbé ces tendances négatives : l'individualisme et le mercantilisme ont réduit la relation entre l'autorité et le peuple à la production et à la consommation, désintégrant les idées de participation politique et d'esprit communautaire qui seules font avancer les communautés. Les masses sont de plus en plus isolées, apathiques, dépolitisées et incapables d'animer un débat sur les grandes questions de l'avenir.
C'est pourquoi l'apprentissage politique ne se fait plus dans les régions ou dans les écoles de parti, mais dans le monde des banques, de la finance et des multinationales. C'est ce même monde qui produit les oligarchies qui dictent la loi sans contestation, légitimées par l'idée de technologie, selon laquelle toute décision d'expert est objective, parfaite, presque obligatoire.
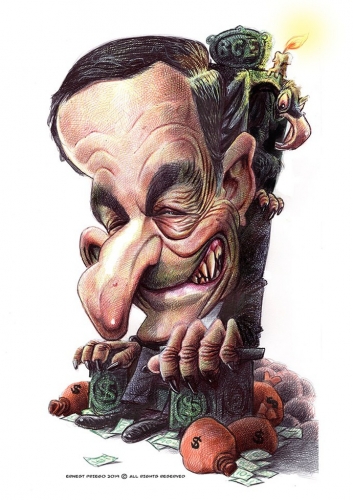
Face à cela, le citoyen ordinaire est désarmé ; s'il tente même de s'opposer aux décisions "techniques", il est qualifié de "souverainiste", d'ignorant ou de raciste. L'investiture de Draghi, encensée par les médias, la plupart du temps contrôlés par les oligarchies de pouvoir (des groupes bancaires à la famille Agnelli, voir le "Prepotere" de Flaminia Camilletti), a répondu précisément à ce diktat. L'ancien banquier de Goldman Sachs a ainsi été dépeint comme le sauveur du pays, comme une figure quasi divine qui s'est imposée par une "volonté extra-constitutionnelle", comme l'a candidement écrit Galli Della Loggia dans le Corriere della Sera. L'image qui se dessine est celle d'une démocratie représentative en crise profonde, avec un parlement de plus en plus marginalisé et incapable de représenter les demandes populaires, si l'on pense que le vote de 2018 avait clairement "parlé" dans un sens anti-eurocratique, alors qu'aujourd'hui nous trouvons l'ancien gouverneur de la BCE comme premier ministre. Notre démocratie froide et procédurale a laissé les décisions aux "administrateurs", vidant les partis et les possibilités de créer une culture, une opposition et des projets à long terme.
Spiritualité et futurisme social pour une démocratie participative
Pour sortir de ce marasme et limiter le pouvoir des oligarchies, la réponse ne peut être uniquement conservatrice ou défensive. Nous devrions oser aller dans le sens de la démocratie participative, qui ferait revivre l'idée de la patrie comme destin commun et de la participation politique comme élément vital de la société. De même, la participation doit être étendue à la sphère de l'entreprise, pour la mise en œuvre de l'article 46 de la Constitution italienne: "En vue de l'élévation économique et sociale du travail et en harmonie avec les besoins de la production, la République reconnaît le droit des travailleurs à collaborer, selon les modalités et dans les limites établies par la loi, à la gestion des entreprises". Il s'agirait d'une étape importante pour "piloter" l'innovation (qui sera autrement la prérogative des multinationales américaines et chinoises) par le biais de processus d'implication des travailleurs dans les mécanismes de gestion des entreprises, en favorisant la croissance, l'autonomisation et l'amélioration des connaissances des travailleurs.

Tout cela pourrait également contribuer à lier les entreprises à leur territoire (en endiguant les délocalisations qui ont eu un impact si négatif sur le tissu social national) et à ouvrir la voie à de nouvelles formes de relations industrielles et de croissance communautaire, qui sont essentielles si nous ne voulons pas être davantage pulvérisés par les influences des oligarchies nationales et internationales. Les catégories, les associations et le monde varié des "producteurs" et de l'économie réelle, souvent humiliés par le gouvernement et contournés par les groupes de travail, devraient être réévalués et impliqués, en pensant à une réforme du CNEL, voire à une véritable deuxième Chambre du travail qui "politiserait" les compétences dans un cadre de transparence, de responsabilité, de sacrifice et d'esprit communautaire qui tenterait de rendre enfin leur dignité aux citoyens.
Tout cela doit être animé par un véritable effort spirituel qui récupère la meilleure tradition qui plonge ses racines dans l'interclassisme de Mazzini et va jusqu'au nationalisme et au futurisme social d'hommes comme Enrico Corradini, Filippo Carli et Filippo Tommaso Marinetti.

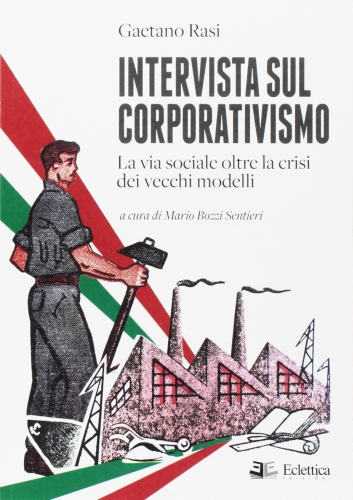
Gaetano Rasi (photo) et sa "droite sociale" d'après-guerre ont explicitement récupéré cet héritage, et dans l'un de ses articles d'il y a 50 ans consacré à Mazzini, nous pouvons trouver de nombreuses idées d'une extraordinaire pertinence:
"Le problème actuel de l'Italie est celui de la "reprise" et de "l'engagement". Il faut récupérer ces forces - souvent généreuses - qui aujourd'hui sont tournées vers la fureur destructrice, instrumentalisée bien sûr, mais aussi exprimée dans la haine de l'injustice, de la corruption, de l'inefficacité voulue ou permise par des oligarchies privilégiées, camouflées derrière le paravent de la tyrannie dominée par les partis. Sur ce chemin, la pensée hautement éducative de Mazzini peut être un guide, tout comme l'engagement de sa prédication doit être un exemple. Les Italiens d'aujourd'hui souffrent d'une forme de fatigue qui ne provient pas de la saturation des besoins, mais de l'insatisfaction et de l'intolérance. Le désengagement est né comme une philosophie prêchée par les partis "fondateurs" du régime et s'exprime à travers les gratifications individualistes, le choc des égoïsmes, la comparaison des possessions matérielles. La mesure des hommes, dans la considération mutuelle, est donnée exclusivement par la quantité de choses qui peuvent être exposées et le succès est évalué uniquement en termes de quantités monétaires".
La fonction publique est considérée comme un point d'arrivée pour la distribution de faveurs et de récompenses aux clients, au lieu d'un devoir et d'un service à la communauté. On parle d'"exercice du pouvoir" au lieu d'"exercice du commandement", en mettant l'accent sur les avantages des postes de haut niveau plutôt que sur les obligations de ceux qui dirigent et disposent. D'où l'insatisfaction et l'impatience qui produisent, dans la sphère sociale et économique, l'abandon du travail, la "désaffection" pour les activités entrepreneuriales, le refuge de catégories entières de travailleurs et d'entrepreneurs dans l'assistance des finances publiques. S'il n'y a pas de tension idéale dans la gestion des "affaires publiques" et d'adhésion convaincue à l'accomplissement quotidien des travaux communs, comment peut-il y avoir une société ordonnée et civilisée?". Notre avenir dépend toujours de la réponse.
Francesco Carlesi,
Président de l'Institut "Stato e Partecipazione".

11:18 Publié dans Actualité, Définitions, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, italie, définitions, participation, futurisme, théorie politique, politologie, sciences politiques, philosophie politique |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
jeudi, 06 janvier 2022
Nick Land et la pertinence des "Lumières sombres"

Nick Land et la pertinence des "Lumières sombres"
par Pietro Missiaggia
Le philosophe britannique Nick Land, né en 1962, connu comme le père de ce courant philosophique né dans les années 90, au moment de la crise des idéologies, et souvent appelé accélérationnisme, est peu connu en Italie et dans les pays de l'Europe méditerranéenne ; ce n'est que ces deux dernières années que deux de ses œuvres ont été traduites en italien Collasso. Scritti 1987-1994 édité par Luiss University Press, et L'Illuminismo Oscuro traduit et édité par Gog Edizioni. Nous voudrions analyser certains aspects de cette dernière œuvre, qui représentent les théories novatrices de Land et sont souvent utiles pour comprendre notre époque.
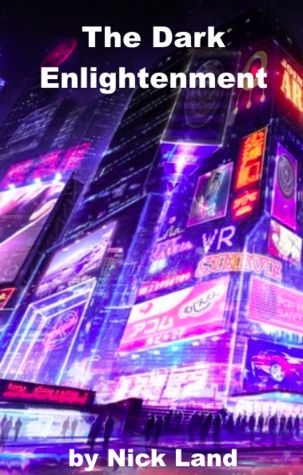 The Dark Enlightenment est un texte publié par le penseur britannique en 2013 par "épisodes" dans l'un des nombreux blogs internet fréquentés par les membres de la "droite alternative" ou Alt-Right. Le livre de Land a souvent été défini, par de nombreux commentateurs plus ou moins ignorants, de bonne ou de mauvaise foi ou simplement politiquement corrects (une erreur également commise par les éditeurs de Gog), comme un texte inspirateur du suprémacisme blanc, fortement apologétique envers l'eugénisme et considéré comme la somme d'une pensée irrationnelle, agressive, anti-égalitaire et purement cérébrale. Dans ce court texte, nous analyserons des extraits du texte de Land pour essayer de comprendre objectivement sa pensée et ce qui peut être utile en elle pour notre époque, qui est une époque de dissolution.
The Dark Enlightenment est un texte publié par le penseur britannique en 2013 par "épisodes" dans l'un des nombreux blogs internet fréquentés par les membres de la "droite alternative" ou Alt-Right. Le livre de Land a souvent été défini, par de nombreux commentateurs plus ou moins ignorants, de bonne ou de mauvaise foi ou simplement politiquement corrects (une erreur également commise par les éditeurs de Gog), comme un texte inspirateur du suprémacisme blanc, fortement apologétique envers l'eugénisme et considéré comme la somme d'une pensée irrationnelle, agressive, anti-égalitaire et purement cérébrale. Dans ce court texte, nous analyserons des extraits du texte de Land pour essayer de comprendre objectivement sa pensée et ce qui peut être utile en elle pour notre époque, qui est une époque de dissolution.
Commençons par dire que Land est très critique à l'égard des mouvements qui se réfèrent au suprémacisme blanc, au suprémacisme noir, etc. et qui considèrent l'histoire comme un phénomène de lutte entre les races (racisme), tout comme il est critique à l'égard de la nostalgie fasciste et nationale-socialiste et des apologistes du politiquement correct. Selon le Land: "Il est extrêmement commode, lorsqu'on construit des structures pseudo-capitalistes dirigées par l'État, ouvertement corporatistes et à troisième voie, de détourner l'attention des expressions de colère de la paranoïa raciale blanche, surtout lorsque celles-ci sont décorées par des insignes nazis maladroitement modifiés, des casques à cornes, une esthétique à la Leni Rienfenstahl et des slogans empruntés généreusement à Mein Kampf. Aux États-Unis - et donc, avec un décalage réduit, également à l'échelle internationale -, des draps blancs aux divers titres pseudo-maçonniques, avec croix brûlantes et cordes de suspension, ils ont acquis une valeur théâtrale comparable" (op. cit., Roma 2021, p. 68).
Pour Land, la paranoïa raciale des suprématistes blancs est extrêmement nuisible non seulement à la création d'un système alternatif mais aussi à eux-mêmes ; en effet, pour l'auteur "l'Übermensch racial est un non-sens" (ibid., p. 130) et il ajoute que "aussi extrêmement fascinants que soient les nazis [...] ils posent une limite logique à la construction programmatique et à l'engagement de la politique identitaire blanche". Se tatouer une croix gammée sur le front ne change rien". (ibid). Les suprémacistes blancs du monde anglophone, même s'ils ne le réalisent pas, alimentent le système dans son idiotie et son théâtre en manquant d'une ligne politique cohérente et en étant destinés, pour Land, à succomber comme notre monde vers l'épuisement. Pour Land, comme il le précise à la page 129 de son manifeste, sacrifier la modernité au nom de la race revient à se démoder soi-même ; plus que se démoder, c'est faire le jeu de la modernité elle-même, en l'alimentant de ce qu'elle voudrait voir comme une paranoïa raciale, qui se traduit par deux formes doubles : la paranoïa raciale du suprémacisme et la paranoïa anti-raciale typique de la pensée politiquement correcte.
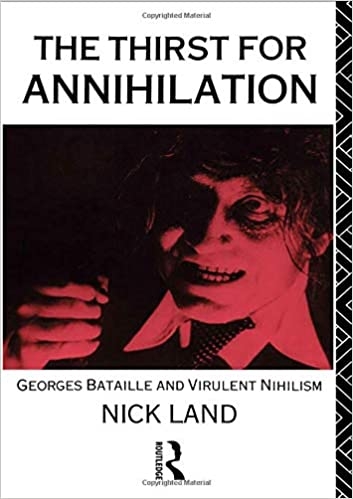 Pour Land, en effet, la référence constante à un croquemitaine qui voit dans le IIIe Reich le mal absolu est délétère, mais c'est aussi la force de la modernité qui, à partir de la seconde moitié du XXe siècle, fait "jaillir la force politique du monde globalisé exclusivement du cratère incinéré du IIIe Reich" (p. 72). Cette tendance conduit, pour notre auteur britannique, à délaisser la rationalité pour l'irrationalité ; cela n'a rien d'étonnant : les hommes rationnels sont rares, surtout à une époque comme la nôtre, caractérisée par l'émotivité et le manque d'analyse: "Toute tentative de nuance, d'équilibre et de proportion dans le cas moral contre Hitler revient à mal interpréter le phénomène " (p. 75). En effet, l'hitlérisme et le totalitarisme national-socialiste sont souvent interprétés non pas comme un phénomène politique lié à une période historique spécifique avec ses propres présupposés, mais comme quelque chose d'éternel aux accents religieux abrahamiques: l'antéchrist présentant le mal absolu. C'est ce que critique Land, comme en témoignent ses propos: "Si embrasser Hitler comme un Dieu est un signe de déplorable confusion politico-spirituelle (quand c'est bien), reconnaître sa singularité historique et sa signification sacrée est presque obligatoire, car tous les hommes de foi réfléchie le considèrent comme un complément précis du Dieu incarné - l'Anti-Messie détecté, l'Adversaire - et cette identification a la force d'une vérité évidente. (Quelqu'un s'est-il déjà demandé pourquoi le sophisme logique de la reductio ad Hitlerum fonctionne si bien ?)" (p. 77).
Pour Land, en effet, la référence constante à un croquemitaine qui voit dans le IIIe Reich le mal absolu est délétère, mais c'est aussi la force de la modernité qui, à partir de la seconde moitié du XXe siècle, fait "jaillir la force politique du monde globalisé exclusivement du cratère incinéré du IIIe Reich" (p. 72). Cette tendance conduit, pour notre auteur britannique, à délaisser la rationalité pour l'irrationalité ; cela n'a rien d'étonnant : les hommes rationnels sont rares, surtout à une époque comme la nôtre, caractérisée par l'émotivité et le manque d'analyse: "Toute tentative de nuance, d'équilibre et de proportion dans le cas moral contre Hitler revient à mal interpréter le phénomène " (p. 75). En effet, l'hitlérisme et le totalitarisme national-socialiste sont souvent interprétés non pas comme un phénomène politique lié à une période historique spécifique avec ses propres présupposés, mais comme quelque chose d'éternel aux accents religieux abrahamiques: l'antéchrist présentant le mal absolu. C'est ce que critique Land, comme en témoignent ses propos: "Si embrasser Hitler comme un Dieu est un signe de déplorable confusion politico-spirituelle (quand c'est bien), reconnaître sa singularité historique et sa signification sacrée est presque obligatoire, car tous les hommes de foi réfléchie le considèrent comme un complément précis du Dieu incarné - l'Anti-Messie détecté, l'Adversaire - et cette identification a la force d'une vérité évidente. (Quelqu'un s'est-il déjà demandé pourquoi le sophisme logique de la reductio ad Hitlerum fonctionne si bien ?)" (p. 77).
La critique par Nick Land du racisme biologique grossier et dépassé, typique de certains cercles de la droite alternative américaine et du monde anglophone en général, ainsi que des tendances à la reductio ad Hitlerum du politiquement correct sous toutes ses formes, est tout à fait claire ; il n'est pas nécessaire d'apporter d'autres précisions pour comprendre que Land critique sévèrement le racisme biologique ainsi que son opposé, l'antiracisme délirant.
Examinons maintenant ce que Land entend par "Lumières sombres" et pourquoi le concept qu'il propose peut être considéré comme profondément novateur. Land propose les Lumières comme le véritable nom de la modernité (p. 17) et considère implicitement comme son digne héritier les Lumières libérales qui, au cours du XXe siècle, ont triomphé des deux totalitarismes qui leur ont disputé la suprématie: le communisme/socialisme et le national-socialisme/fascisme, comme le dit aussi Alexandre Douguine dans sa Quatrième théorie politique (Nova Europa Edizioni, Rome 2018). Pour Land, "un Dark Enlightenment cohérent [est] dépourvu à ses débuts de tout enthousiasme rousseauiste pour l'expression populaire" (p. 23) et "Là où le progressive Enlightenment voit des idéaux politiques, le Dark Enlightenment voit des appétits" (ibid.).
Land considère la démocratie comme un cancer incurable, de même que l'expression populaire et les différents populismes. La démocratie n'est pas un idéal, c'est l'auge des politiciens. Pour Land, le modèle naturel serait un État qui permet une grande liberté économique et la gestion privée de sa propre vie, comme les technocraties asiatiques, avec une référence particulière à Hong Kong, Singapour, Taiwan, etc., où la démocratie est souvent absente et où ces États sont basés sur un modèle connu sous le nom de néo-caméralisme, l'État d'entreprise (Land définirait le modèle naturel de l'homme comme étant celui de l'Asie). Selon Land, dans le sillage de deux autres penseurs considérés comme des Américains libertaires (presque anarcho-capitalistes selon l'opinion populaire) : Hans Hermann Hoppe et Curtis Yarvin (alias Moldbug) (photo, ci-dessous) et dans le sillage du décisionnisme de Hobbes, il comprend que "l'État ne peut être supprimé mais il peut être guéri de la démocratie" (p. 27).

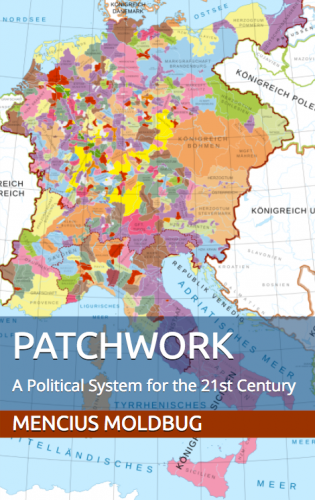
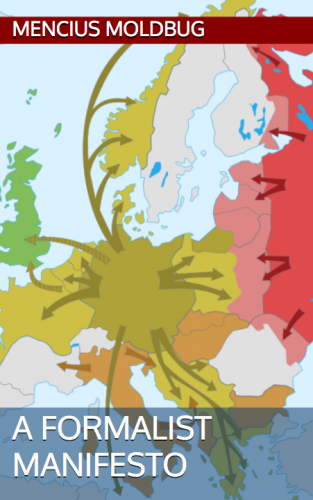
Un véritable libertarianisme selon Land doit cependant proposer de mettre en évidence, dans le sillage typiquement anglo-saxon, la supériorité de la liberté sur la démocratie: il faut pouvoir opter pour une sortie libre. Quiconque le souhaite doit être libre de créer son propre système et d'être laissé tranquille, ce que la démocratie moderne ne fait pas, avec ses chasses aux sorcières et son politiquement correct, avec ses guerres humanitaires pour la démocratie et avec sa rhétorique sur les droits de l'homme. Des droits de l'homme qui ne sont même pas respectés par ces mêmes démocraties qui tonnent haut et fort la parodie de progressisme et de liberté... Alors que la seule liberté de la démocratie est celle de la voix, du vote, c'est-à-dire la protestation pour obtenir plus de droits et de pain, mais qui en réalité ne mène à rien. Pas de voix mais un discours libre, telle est la devise du Land. Que faire de la démocratie ? Pour notre auteur, il nourrit "une population largement infectée par le virus zombie qui titube vers un effondrement social cannibale, l'option privilégiée devrait être la quarantaine" (p. 39).
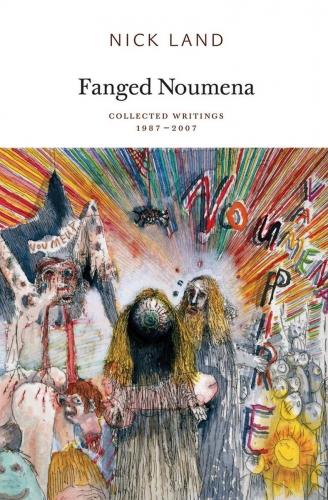
Avant de conclure sur l'utilité de s'inspirer de la pensée de Land dans notre époque historique actuelle, il est nécessaire de préciser ce que notre auteur pense de l'eugénisme. Land définit l'homme comme inégal, dans le sens où chaque homme est différent et où l'égalité totale n'existera jamais, mais il ne faut pas y voir un phénomène négatif, ni une suprématie du fort sur le faible, mais plutôt, pour reprendre une formule marxiste telle que "chacun selon ses capacités et chacun selon ses besoins", l'idéal pour l'auteur britannique serait une société basée sur la hiérarchie. Cette hiérarchie, cependant, ne doit pas devenir, comme l'a dit Julius Evola, un hiérarchisme, même s'il partait de prémisses très différentes; elle doit consister en un soutien mutuel sur la base d'une sorte d'état organique. En fait, Land conclut son texte en affirmant que "les nationalistes raciaux s'inquiètent de voir leurs petits-enfants se ressembler" (p. 149) et que lorsque l'on voit la réalité "depuis l'horizon bionique, tout ce qui émerge de la dialectique de la terreur raciale devient la proie des banalités". Il est temps d'aller au-delà de cela" (p. 150). C'est-à-dire que pour le Land, il est nécessaire d'aller au-delà des moyens grossiers de l'eugénisme et du racisme biologique. Selon lui, il est nécessaire de créer une nouvelle élite, en utilisant également les moyens technologiques des machines, et à ses yeux, les anciens moyens sont banals et obsolètes, ainsi que synonymes de stupidité. Ce qui peut et doit être critiqué et réprimandé à Land, c'est que, en bon anglo-saxon, il prend en considération le QI comme synonyme de jugement, mais qu'en penseur objectif, il en reconnaît les limites.
Ayant clarifié la stupidité de juger Land comme un penseur raciste ou comme un idéologue de la soi-disant Alt-Right, passons à ce que l'on peut tirer de bon de Land. Tout d'abord, dans sa conclusion avec l'horizon bionique, il propose que la seule façon de chevaucher le tigre de la post-modernité est d'utiliser la même technique, mais en prenant soin de la contrôler, et comme Carl Schmitt l'a dit dans son Dialogue sur le pouvoir (Edizioni Adelphi), la technique n'est ni bonne ni mauvaise mais neutre. L'homme doit l'utiliser sans en perdre le contrôle, sinon, comme le dit également le bon Theodore Kaczynski dans son ouvrage Industrial Society and its Future, si l'homme ne contrôle pas la technologie et la technologie qui en découle, il sera totalement insatisfait et incapable de satisfaire ses besoins. C'est-à-dire qu'il ne se sentira pas satisfait de la technique et de la technologie qui en découle et de leurs conclusions, mais complètement et perpétuellement insatisfait, incapable et souvent frustré, ce qui le conduira à un état d'épuisement nerveux.
Nick Land nous apprend à penser par nous-mêmes, à rejeter le style paranoïaque du système dans son ensemble, c'est-à-dire dans ses illusions, tant celles de ses ennemis qui ne font que l'alimenter que celles du système lui-même. C'est le sublime Trash, comme dirait le slovène Žižek. Que faire à la fin de nos jours ? Comme nous l'enseignent déjà Evola et le Jünger du Traité du Rebelle, nous devons nous y rendre pour nous défendre et attaquer selon la situation, en nous enracinant et en prenant des références stables dans le navire chancelant de la modernité qui s'approche de la postmodernité pour attendre une sortie libre espérée du système qui, comme l'espère Land, se produira parce que le système se nourrit jusqu'à l'éclatement non seulement à cause des problèmes générés par le substrat socio-économique mais surtout à cause de son éternelle idiotie, sa schizophrénie, en somme: par tous les déchets qu'elle produit. Le système, en bref, est un grand même. Land a déclaré : "Le même est mort. Vive le même!". A cela, nous devons répondre que le système n'est pas encore mort, mais qu'il va mourir et que nous ne nous soucions pas de savoir quand, nous vivons de notre libre individualité et de notre pouvoir parce que nous sommes simplement...
11:52 Publié dans Philosophie, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : nick land, philosophie, philosophie politique, théorie politique, lumières, lumières sombres, politologie, sciences politiques |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mardi, 28 décembre 2021
"Front transversal de théoriciens de gauche et de dextristes radicaux" ?
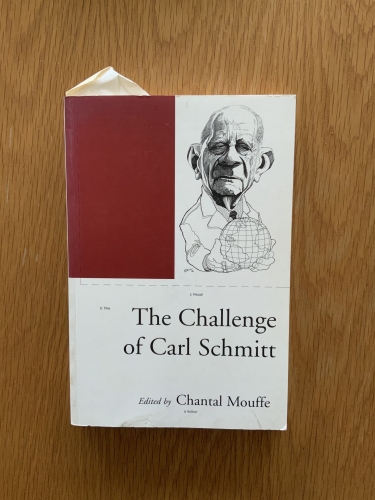
Front transversal de théoriciens de gauche et de dextristes radicaux?
par Klaus Kunze
Ex: http://klauskunze.com/blog/2021/12/27/querfront-von-linken-theoretikern-und-rechtsradikalen/
Gauche et fausse gauche
Pour un gauchiste classique, il ne fait aucun doute que les diverses catégories de la population ont des intérêts inégaux et que différentes classes sont en lutte les unes contre les autres. Lorsqu'un groupe humain a d'autres intérêts qu'un autre, il doit s'organiser pour les faire valoir efficacement. La solidarité au sein du groupe est alors très nécessaire : l'intérêt collectif de la classe prime sur tout intérêt individuel.
 L'individualisme libéral est en principe incompatible avec ce point de départ tendanciellement collectiviste. Pour l'individualiste radical, "rien ne passe avant moi", comme l'avait formulé Max Stirner de manière paradigmatique. Il est ainsi devenu l'ancêtre spirituel des anarchistes, des autonomes et des capitalistes ultralibéraux. Un individualiste radical ne se réfère qu'à lui-même : "Aucune chose, aucun soi-disant "intérêt suprême de l'humanité", aucune "chose sacrée" ne vaut que tu la serves, que tu t'en occupes à cause d'elle ; tu peux chercher sa valeur uniquement dans le fait de savoir si elle vaut pour toi à cause de toi" [1].
L'individualisme libéral est en principe incompatible avec ce point de départ tendanciellement collectiviste. Pour l'individualiste radical, "rien ne passe avant moi", comme l'avait formulé Max Stirner de manière paradigmatique. Il est ainsi devenu l'ancêtre spirituel des anarchistes, des autonomes et des capitalistes ultralibéraux. Un individualiste radical ne se réfère qu'à lui-même : "Aucune chose, aucun soi-disant "intérêt suprême de l'humanité", aucune "chose sacrée" ne vaut que tu la serves, que tu t'en occupes à cause d'elle ; tu peux chercher sa valeur uniquement dans le fait de savoir si elle vaut pour toi à cause de toi" [1].
Les gauchistes et les anarchistes ont en commun leur haine irréconciliable du capitalisme. De nombreux conservateurs estiment en revanche que le capitalisme est compatible avec la préservation de leurs valeurs et pensent, en tant que libéraux-conservateurs, pouvoir le dompter. Les gauchistes et les anarchistes ne le pensent pas. Ils veulent le surmonter. Mais ce faisant, les gauchistes se trouvent face à un dilemme argumentatif : dans leur zèle à détruire le capitalisme, de nombreux anciens gauchistes ont emprunté des prémisses constructivistes depuis les années 1980 : ils se nomment désormais postmarxistes.
Klaus-Rüdiger Mai fait remarquer avec malice :
"Au fond, il s'agit exclusivement de la question du pouvoir. Après que la gauche ait perdu le sujet de la lutte révolutionnaire, le prolétariat selon la doctrine marxiste classique, les libéraux autour du philosophe John Rawls, pour qui une société est considérée comme juste lorsque "les lois ont été conçues pour le bien du groupe le plus défavorisé", ont apporté leur aide. Tout ce qui est considéré comme opprimé : les people of color, les homosexuels, les membres des 666 genres sont élevés au rang de nouveau sujet révolutionnaire, de mesure de toute chose"[2] (Klaus-Rüdiger Mai).
C'est justement dans la lutte contre le capitalisme individualiste qu'ils se sont servis de l'arsenal du déconstructivisme. Le capitalisme serait un produit de la bourgeoisie dominante qui, pour le défendre, aurait recours, si nécessaire, à l'Etat répressif fasciste. Pour l'atteindre au cœur, on déconstruit ses fondements intellectuels et institutionnels: l'Etat est un instrument de répression, les peuples n'existent pas, les familles sont un foyer d'oppression patriarcale. Peu importe ce qui tenait à cœur au citoyen indolent et devait protéger son porte-monnaie: ce ne sont que des constructions, de pures inventions, des chimères dépassées.
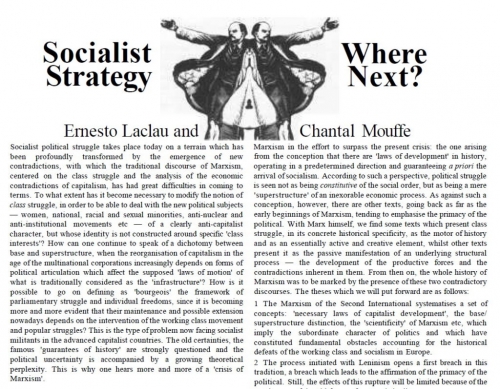
Marxism Today 1981
Le publiciste anglais Douglas Murray a trouvé le noyau de ce changement de paradigme dans les travaux du postmarxiste Ernesto Laclau [3], qui s'était détourné en 1981 du "discours traditionnel du marxisme", centré sur la lutte des classes et les contradictions économiques du capitalisme. Sous une image symbolique de Lénine, Laclau avait opéré un changement de cap qui a durablement divisé la gauche socialiste :
"Dans quelle mesure est-il devenu nécessaire de modifier le concept de lutte des classes pour être en mesure de s'occuper des nouveaux thèmes politiques - femmes, minorités nationales, raciales et sexuelles, mouvements anti-nucléaires et anti-institutionnels, etc. de nature clairement anticapitaliste, mais dont l'identité n'est pas construite autour d'un 'intérêt de classe' particulier ?" [4] (Ernesto Laclau / Chantal Mouffe).

Ernesto Laclau (1935-2014), époux de Chantal Mouffe.
Lorsque Laclau et Mouffe ont adopté une approche strictement constructiviste en 1981, ils ont décomposé mentalement l'entité collectiviste de la classe en ses éléments constitutifs et ont poursuivi la lutte anticapitaliste avec de nouvelles constructions : la femme, les opposants au nucléaire et toutes sortes de "sous-privilégiés" sont devenus des substituts de la classe ouvrière et de son échec décevant dans la lutte des classes. Mais en intégrant justement la méthode du déconstructivisme strict dans leur arsenal idéologique, les gauchistes anticapitalistes se sont eux-mêmes dépassés sur le plan argumentatif. Ils ne détruisaient pas seulement les bases de la représentation des classes ou des peuples en tant que totalités sociales. Un constructivisme conséquent devait également atomiser les nouvelles minorités et en faire des combattants individuels incapables de mener une lutte de classe. Mais leur désir de déconstruction n'est pas allé aussi loin.
Lorsque les postmarxistes font appel au constructivisme, ils ne remarquent souvent pas, dans leur zèle, qu'avec leur déconstruction des structures sociales, ils favorisent l'hypothèse de base du libéralisme pour laquelle seuls les individus sont réels. Toutes les institutions sociales supra-individuelles sont imaginaires. Certains aimeraient bien déconstruire l'Etat allemand et le peuple allemand, mais soulignent en même temps l'existence réelle d'entités sociales comme "les femmes", "les gays", "les Afro-Américains". Mais on ne peut pas, sans contradiction interne, frapper les entités sociales "blanches" avec une épée déconstructiviste sans faire éclater en même temps ses propres bulles de savon "colorées".
Le constructivisme correspond à l'expression la plus profonde de la modernité et à la version dominante du libéralisme qui avait émergé dans la société de masse. Il se représente fondamentalement la société comme une masse amorphe d'individus, de même nature les uns que les autres et en perpétuel flux social. Les idées de formations sociales seraient sans cesse oubliées et de nouvelles seraient développées comme des bulles de savon dans la mousse d'une baignoire. Il nie systématiquement l'existence de peuples, de familles et d'autres structures sociales, et même l'existence de sexes différents. Ce faisant, il se trouve toutefois sur une trajectoire de collision avec des croyances de la vieille gauche. S'il n'y a pas de peuples, il ne peut pas non plus y avoir de classes ou d'intérêts de classe objectifs. Cela ne convient pas à Ingo Elbe, un analyste amoureux de Marx : les intérêts et les identités politiques ne sont alors plus rien d'autre que des constructions discursives et une volonté politique qui doivent motiver une action commune [5]. Un constructivisme aussi radical ne peut finalement comprendre la structure de toutes les entités que comme un langage [6].
Front croisé des théoriciens de gauche et de certains dextristes radicaux
Du point de vue d'Elbe, le constructivisme repose sur deux mauvais piliers: celui qui imagine des entités sociales quelconques et les considère toutes comme équivalentes pourrait éventuellement aboutirà l'idée suivante: si la classe ouvrière est une construction sociale interchangeable et utilisable à volonté, alors quelqu'un pourrait éventuellement reconstruire quelque chose d'aussi abominable que la nation et l'élever au rang de sujet de la lutte politique. Les idées de Chantal Mouffe pourraient mener tout droit à un populisme de gauche. Un "front transversal de théoriciens de gauche et de dextristes radicaux menace au niveau de la description fondamentale des rapports sociaux" [7]. Elbe trouve la raison la plus profonde de cette "description fondamentale" dans l'archi-démon de tous les gauchistes et libéraux : Carl Schmitt, du point de vue d'Elbe un "maître à penser" de Mouffe. Elle partage avec lui la compréhension des distinctions conceptuelles et des forces actives de la politique. Elle ne conçoit pas la lutte des classes comme un épisode dans un événement historique qui s'achève de lui-même, mais comme une lutte antagoniste, comme une opposition entre amis et ennemis dont l'issue est ouverte. Leur motif est démocratique de gauche et anticapitaliste, mais leur structure de pensée est schmittienne :
"L'adversaire central de Mouffe, tant sur le plan de la théorie sociale que sur le plan politique, est 'l'hégémonie du libéralisme'. Du point de vue de la théorie sociale, le libéralisme est compris, tout à fait dans le style des analyses de Carl Schmitt dont Mouffe s'inspire à presque tous les égards, comme une conception dépassant les approches politiques les plus diverses, qui se caractérise, selon Mouffe, par ces composantes: le libéralisme est "une approche rationaliste et individualiste" qui ne reconnaît pas les "identités collectives" et part du principe que le pluralisme peut être coordonné de manière rationnelle, qu'il existe "de nombreux points de vue et valeurs que nous ne pourrons jamais faire nôtres dans leur totalité en raison de limitations empiriques, bien qu'ils forment un ensemble harmonieux et non conflictuel". [8] (Ingo Elbe).
En tant que démocrate de gauche radicale, Chantal Mouffe critique avec Carl Schmitt l'aveuglement du libéralisme pour le phénomène du politique. Il voit les formations sociales de manière constructiviste comme des produits de l'imagination humaine et de l'action communautaire. Mais elle ne leur dénie pas leur force d'action sociale lorsqu'elles se sont effectivement installées dans les têtes et les cœurs des hommes. L'une des caractéristiques fondamentales des êtres humains est de se distinguer en tant que "nous" construit contre un "eux" tout aussi construit. C'est précisément de cela que découle tout ce qui est politique. Pour une structure sociale, il importe peu de savoir si elle a un fondement et lequel, tant qu'elle domine la pensée des gens et génère un sentiment de "nous" puissant. En opposant leur "nous" à "l'autre" et en se démarquant, cette opposition est politique, ce qu'un libéral ne peut pas vraiment saisir, ne serait-ce que conceptuellement. Pour lui, il n'y a ni amis ni ennemis, mais seulement des partenaires commerciaux sur un marché mondial.
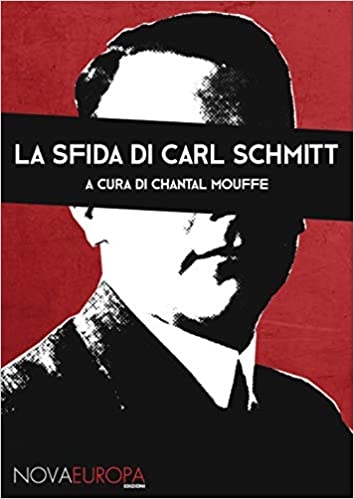

Chantal Mouffe (née en 1943) est professeur de théorie politique à l'université de Westminster à Londres.([9] Ingo Ende n'a pas compris Carl Schmitt : Ce dernier ne craignait ni ne combattait la résolution des conflits par la dépolitisation ou la neutralisation : Il avait ri de la croyance selon laquelle tout conflit pouvait être résolu par le discours : "Cela fait partie de la dialectique d'une telle évolution que l'on crée toujours un nouveau champ de bataille précisément en déplaçant le territoire central"[10].
Politique : le principe agonal
Le comportement affiliatif et le comportement agonal font partie des motivations fondamentales des êtres humains: nous nous comportons de manière amicale et attentionnée au sein de notre communauté sociale, notre "nous". Nous nous comportons de manière agonale et potentiellement combative vis-à-vis de l'extérieur [11]. Ces deux options de comportement ont chacune leur propre fonction de préservation de l'espèce. Si l'on veut faire de la distance agonale et de la proximité familiale des principes au sein d'un groupe, ils se contredisent mutuellement. En revanche, ces sentiments de base peuvent se combiner puissamment dans la confrontation de différents groupes. L'agressivité est alors tournée vers l'extérieur et l'attachement affectueux vers l'intérieur. "La lutte est le moment", admet ouvertement un anarchiste, "où l'individu ressent pour la première fois le sentiment de la force commune" [12].
Les théories politiques des temps modernes ont toujours été conscientes de l'opposition entre l'action affiliative et l'action agonale. Dans les formes de pensée chrétiennes traditionnelles, elle était perçue comme un comportement bon, aimant son prochain, par rapport à un comportement mauvais comme le meurtre. La réalité historique suggérait intuitivement que les hommes étaient capables des deux à tout moment, que l'homme oscillait donc de manière ambivalente entre le bien et le mal. C'est pourquoi il a besoin d'un État qui impose le bien et instaure la paix en son sein. Toutes les théories de l'État visaient à maintenir cette paix à l'intérieur et à l'extérieur. Le libéralisme a oublié tout cela. Il nie les possibilités d'hostilité existentielle et donc l'existence de la politique en tant que principe.

La compétition grecque (agon) a mis en évidence un principe interpersonnel qui est également à la base de la politique.
Chantal Mouffe reconnaît en revanche la possibilité de l'hostilité comme une caractéristique inhérente à l'être humain. Elle doit également pouvoir se manifester au sein d'une communauté, mais d'une manière qui ne fasse pas éclater ce qui est commun. La politique démocratique part du demos, le peuple de citoyens. S'ils entrent en guerre civile les uns avec les autres, cela signifierait la fin de cette démocratie. C'est pourquoi "la politique démocratique ne doit pas prendre la forme d'une confrontation entre amis et ennemis sans conduire à la destruction de la communauté politique". La "tâche fondamentale de la théorie de la démocratie consiste à trouver des possibilités d'expression de la dimension antagoniste constitutive de la politique qui ne détruisent pas la société politique" [13].
Le marxiste Ingo Elbe ne comprend pas "comment des adversaires avec des "points de vue" "irréconciliables" peuvent durablement "se battre avec acharnement" et en même temps "s'en tenir à un ensemble de règles communes" et "accepter comme légitimes" ces perspectives irréconciliables" [14]. La phrase historique de Guillaume II: "Je ne connais plus de partis, je ne connais plus que des Allemands !" est pour lui un non-sens inexplicable. Elle est pourtant la clé de voûte nécessaire de toute communauté. Elle doit maintenir la paix civile en son sein. L'hostilité politique ne doit pas aller jusqu'à l'extrême. Pour cela, il faut un sentiment d'appartenance qui place l'ensemble au-dessus des intérêts particuliers.
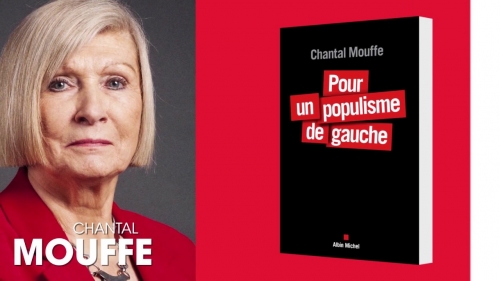
Que ce sentiment se manifeste sous la forme d'une conscience d'appartenir finalement au même peuple malgré tous les conflits ou sous la forme d'une construction purement civique d'un "nous" tangible, l'effet reste le même. Une conscience collective ne peut cependant pas naître d'un indvidualisme méthodologique et est étrangère au libéral moderne. Il est naturellement cosmopolite. Il lui est impossible de reconnaître les conflits politiques en tant que tels, de les maîtriser intellectuellement et de les intégrer dans la société. Leur gestion pacifique au sein d'un État exige une conscience communautaire d'appartenance fondamentale.
Un ordre social adapté aux personnes et à leurs besoins doit toujours permettre les deux possibilités fondamentales, la distance et l'attention, l'agonalité et l'affinité. L'individualisme émotionnel et l'amour de la communauté doivent être maintenus en équilibre. Les hommes doivent aimer la communauté humaine à laquelle ils appartiennent. Sinon, elle devient une société divisée dans laquelle la haine et la guerre civile peuvent éclater à tout moment. Une telle société, divisée et atomisée, est la quintessence du libéralisme.
Les philosophes de l'État des temps modernes ont toujours eu à l'esprit les massacres de la nuit de la Saint-Barthélemy et de la guerre de Trente Ans. Ils ont construit l'État comme l'incarnation du baldaquin pacificateur sous lequel l'hostilité existentielle était neutralisée. Les désirs égoïstes et agonaux y étaient contenus et inscrits dans un ordre communautaire. Le libéralisme brise ce baldaquin, conteste le droit à l'existence de la maison étatique, laisse libre cours aux égoïsmes et fanatismes débridés et rend à nouveau possible une société de guerriers civils individualistes. Il ouvre la voie qui va de l'ordre étatique au chaos anarchiste. Dans ce dernier, les dirigeants qui s'imposeront seront ceux qui disposent d'un capital permettant d'imposer le calme, notamment grâce à des "forces de sécurité" rémunérées. Après la fin du chaos libéral, des penseurs comme Oswald Spengler et Ernst Jünger ont prédit une époque de potentats et de dictatures d'un genre nouveau.
Littérature :
Kunze, Klaus, – Mut zur Freiheit, 1.Aufl.1995.
Mai, Klaus-Rüdiger, Das neue Subjekt des revolutionären Kampfes – Cancel Culture – Ein Angriff, der zur Rückeroberung führen könnte, Tichys Einblick 11.10.2020.
Laclau, Ernesto / Mouffe, Chantal, "Socialist Strategy: Where next", in: Marxism today, Januar 1981.
– Hegemonie und radikale Demokratie. Zur Dekonstruktion des Marxismus. 2., durchgesehene Aufl., Wien 2000.
Mouffe, Chantal, Über das Politische. Wider die kosmopolitische Illusion, 2005, 3.deutsche Auf., 2020, ISBN 978-3-518-12483-3.
Schmitt, Carl, Der Begriff des Politischen, 1932.
Stirner, Max (alias Johann Caspar Schmidt), Der Einzige und sein Eigentum, 1845, Stuttgart (Reclam) 1972.
Notes:
[1] Max Stirner (1845), p.392.
[2] Klaus-Rüdiger Mai, 11.10.2020.
[3] Douglas Murray (2019), p.79.
[4] Laclau / Mouffe, Socialist Strategy : Where next, in : Marxism today, janvier 1981.
[5] Ingo Elbe (2020), p.192.
[6] Ingo Elbe (2020), p.191, contrairement à Laclau / Mouffe (2000), p.144 et suivantes.
[7] Ingo Elbe (2020), p.180.
[8] Ingo Elbe (2020), p.181, d'après Mouffe (22007 = 32020), p. 17 s.
[9] Ingo Elbe (2020), p.181.
[10] Carl Schmitt (1932), p.89. sur les "domaines centraux" comme la religion, l'économie et ainsi de suite.
[11] Voir en détail Klaus Kunze (1995), p.214-218.
[12] Was ist eigentlich Anarchie? Karin Kramer Verlag Berlin, 1986, p.26.
[13] Chantal Mouffe (2020), p.69.
[14] Ingo Elbe (2020), p.183.
18:30 Publié dans Actualité, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, ernesto laclau, chantal mouffe, carl schmitt, théorie politique, philosophie politique, politologie, sciences politiques |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
lundi, 27 décembre 2021
Israel Lira - Critique épistémologique de l'"Ur-Fascisme" d'Umberto Eco
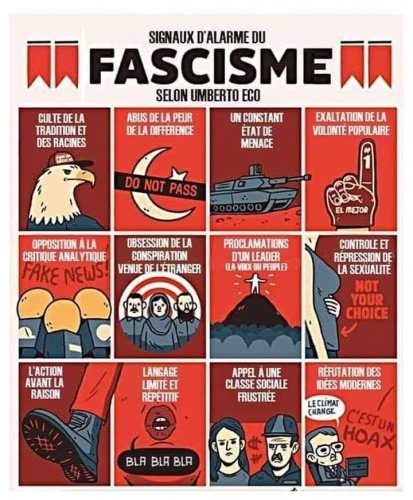
Critique épistémologique de l'"Ur-Fascisme" d'Umberto Eco
par Israël Lira (2017)
Ex: https://legio-victrix.blogspot.com/2021/01/israel-lira-critica-epistemologica-ao.html?fbclid=IwAR38npV79Y-qXvC19qMq0ICJdazVy8-XX-_xYOFJqilg83z6rfjMXrvVEck
"On remarque que, tel qu'il est utilisé, le mot "fascisme" n'a presque aucune signification. Dans la conversation, il est utilisé de manière encore plus insensée que dans la presse. D'après ce que j'ai entendu, elle s'applique aux agriculteurs, aux commerçants, au crédit social, aux châtiments corporels, à la chasse au renard, à la tauromachie, au comité de 1922, au comité de 1941, à Kipling, à Gandhi, à Chang Kai-Shek, à l'homosexualité, aux programmes de Priestley, aux auberges de jeunesse, à l'astrologie... aux femmes, aux chiens et à je ne sais quoi d'autre" [1]. Une citation orwellienne qui est plus pertinente aujourd'hui que jamais, car face à l'instabilité de la région, s'il semble y avoir plus de fascistes qu'à l'époque de la montée du fascisme, eh bien c'est parce que le terme a déjà été complètement vidé de son contenu.
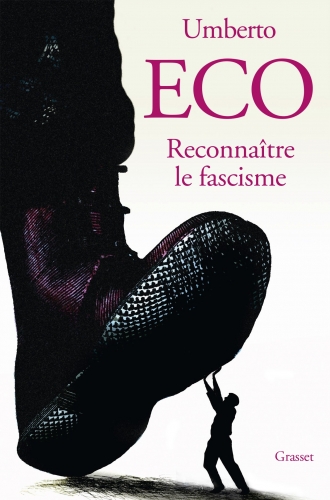
Umberto Eco, l'écrivain et philosophe italien, n'est certainement pas le genre de personne qui abandonne son objectivité juste pour soutenir un système de pensée ; au contraire, il s'est toujours caractérisé par sa grande sagesse sur de nombreux sujets, surtout lorsqu'il s'agit de sémiotique [2]. Sans préjudice de cela, et en hommage à l'amicus plato sed magis amicas est veritas [3], on ne peut manquer de remarquer que, concernant ses thèses traitant de la phénoménologie fasciste, et bien qu'elles ne manquent pas de révéler des positions intéressantes qui nécessiteraient un plus grand contraste empirique - en raison du manque général d'intérêt pour l'investigation objective du sujet - il y a certaines déficiences qui diminuent l'objectivité du discours d'Eco, ceci dans le cadre d'une critique strictement encadrée par l'épistémologie.
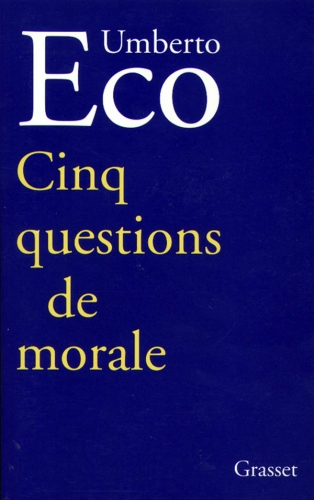
Eco, dans son œuvre Cinq questions de morale, nous présente une partie orientée vers l'analyse de ce qu'il considère comme les caractéristiques essentielles et imperturbables d'un concept de fascisme, dans laquelle il expose ses 14 points :
"Le terme "fascisme" convient à tout, car il est possible d'éliminer d'un régime fasciste un ou plusieurs aspects, et on peut toujours le reconnaître comme fasciste. Si l'on retire l'impérialisme du fascisme, on obtient Franco ou Salazar ; si l'on retire le colonialisme, on obtient le fascisme des Balkans. Ajoutez au fascisme italien un anticapitalisme radical (qui n'a jamais fasciné Mussolini) et vous avez Ezra Pound. Ajoutez le culte de la mythologie celtique et du mysticisme du Graal (complètement étranger au fascisme officiel) et vous obtenez l'un des gourous fascistes les plus respectés, Julius Evola. Malgré cette confusion, je pense qu'il est possible d'indiquer une liste de caractéristiques typiques de ce que j'aimerais appeler "Ur-Fascisme", ou "fascisme éternel". Ces caractéristiques ne peuvent être encadrées dans un seul système ; beaucoup se contredisent et sont typiques d'autres formes de despotisme ou de fanatisme, mais il suffit que l'une d'entre elles soit présente pour que se coagule une nébuleuse fasciste.
1. La première caractéristique d'un Ur-Fascisme est le culte de la tradition. (...) En conséquence, il ne peut y avoir de progrès de la connaissance. La vérité a été annoncée une fois pour toutes, et la seule chose que nous pouvons faire est de continuer à interpréter son message obscur.
2. Le traditionalisme implique le rejet du modernisme. (...) Le rejet du monde moderne était camouflé en une condamnation du mode de vie capitaliste, mais il s'agissait surtout du rejet de l'esprit de 1789 (ou 1776, évidemment). Les Lumières, l'âge de la raison, sont considérées comme le début de la dépravation moderne. Dans ce sens, l'Ur-Fascisme peut être défini comme un "irrationalisme".
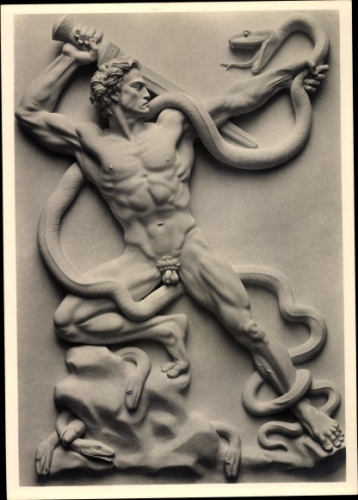
3. L'irrationalisme repose également sur le culte de l'action pour l'action. L'action est belle en soi, et il faut donc agir d'abord, sans aucune réflexion. Penser est une forme de castration. C'est pourquoi la culture est suspecte dans la mesure où elle est identifiée à des attitudes critiques.
4. (...) Pour l'Ur-Fascisme, la dissidence est une trahison.
5. Le désaccord est également un signe de diversité. L'Ur-Fascisme se développe et cherche le consensus en exploitant et en exacerbant la peur naturelle de la différence. Le premier appel d'un mouvement fasciste, ou prématurément fasciste, est contre les intrus. L'Ur-Fascisme est donc raciste par définition.
6. L'Ur-Fascisme naît d'une frustration individuelle ou sociale. Cela explique pourquoi l'un des traits typiques des fascismes historiques a été l'appel aux classes moyennes frustrées, découragées par une crise économique ou une humiliation politique, effrayées par la pression des groupes sociaux subalternes.
7. (...) la racine de la psychologie Ur-Fasciste réside dans l'obsession du complot, éventuellement international. Les sbires doivent se sentir assiégés. Le moyen le plus simple de faire apparaître un complot est de faire appel à la xénophobie.
8. Les hommes de main doivent se sentir humiliés par la richesse et la force ostentatoires des ennemis. (...) les ennemis sont simultanément très forts et très faibles.
9. Pour l'Ur-Fascisme, il n'y a pas de lutte pour la vie, mais "la vie pour la lutte". Le pacifisme est alors une connivence avec l'ennemi ; le pacifisme est mauvais car la vie est une guerre permanente.
10. L'élitisme est un aspect typique de toute idéologie réactionnaire, en ce sens qu'elle est fondamentalement aristocratique. Tout au long de l'histoire, tout élitisme aristocratique et militariste a impliqué le mépris des faibles. L'Ur-Fascisme ne peut éviter de prêcher un élitisme populaire.
11. Dans cette perspective, tout le monde est éduqué pour devenir un héros. (...) Ce culte de l'héroïsme est étroitement lié au culte de la mort... (...).
12. La guerre permanente et l'héroïsme étant des jeux difficiles à jouer, l'Ur-Fasciste transfère sa volonté de puissance sur les questions sexuelles. C'est l'origine du machisme (qui implique le mépris des femmes et une condamnation intolérante des mœurs sexuelles non-conformistes, de la chasteté à l'homosexualité).
13. L'Ur-Fascisme est basé sur un populisme qualitatif. (...) Pour l'Ur-Fascisme, les individus en tant que personnes n'ont aucun droit, et le peuple est conçu comme une qualité, une entité monolithique exprimant la volonté commune.
14. L'Ur-Fascisme parle la Novilangue. La novlangue a été inventée par Orwell dans 1984 comme la langue officielle de l'Ingsoc, le socialisme anglais, mais des éléments de l'Ur-Fascisme sont communs à diverses formes de dictature. Tous les textes scolaires nazis ou fascistes étaient basés sur un lexique pauvre et une syntaxe élémentaire afin de limiter les outils de raisonnement complexe et critique. Mais nous devrions être prêts à identifier d'autres formes de novlangue, même lorsqu'elles prennent la forme innocente d'une émission de télé-réalité populaire" [4].
Cependant, les 14 hypothèses d'Eco semblent n'être qu'une liste exhaustive des aspects négatifs, - dans la forme où elles sont exposées, elles ressemblent presque à des apothéismes - caractéristiques d'une étape antérieure à celle d'une théorisation scientifique, puisqu'elles n'ont pas été mises en contraste avec les aspects positifs du fascisme, car en ne l'affirmant pas, on pécherait en biaisant les variables au détriment d'une vision objective, puisqu'il faut peser les aspects positifs et négatifs pour porter un jugement scientifique, qui nous permettra de tirer des conclusions sur les caractéristiques essentielles d'un phénomène ou d'un fait recherché ou étudié : "Pour combattre [5] le fascisme, il faut le comprendre, ce qui implique de reconnaître qu'il contient certaines bonnes choses ainsi que de nombreuses mauvaises" [6] ; ce parti pris d'Eco est encore plus évident lorsque George Orwell [7], antifasciste convaincu, fait preuve d'une plus grande objectivité que son homologue italien dans son traitement du sujet, puisque certaines des affirmations qu'Eco prend pour acquises - dans ses 14 points, et même dans une logique pars pro toto - indiquent qu'un de ces 14 points suffit à configurer le concept, nous conduisant à un anarchisme sémantique dans lequel tout ce qui tombe dans l'un de ces 14 points est fasciste - dans une approche orwellienne, ces 14 points ne seraient pas entièrement corrects, ce qui sape l'objectivité de l'argument d'Eco, sans lui enlever sa potentialité en tant que contre-pied empirique ultérieur :
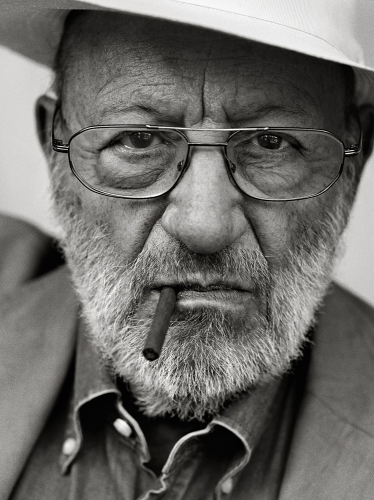
"De toutes les questions en suspens de notre époque, la plus importante est peut-être : qu'est-ce que le fascisme ? L'une des organisations qui réalisent des études sociologiques aux États-Unis a récemment interrogé une centaine de personnes à ce sujet et a obtenu des réponses allant de la "démocratie pure" au "diabolisme pur". Dans ce pays, si vous demandez à l'homme de réflexion moyen de définir le fascisme, il répond généralement en donnant l'exemple des régimes qui ont régné jadis en Allemagne et en Italie. Mais ce n'est pas satisfaisant, car même les grands États fascistes diffèrent grandement en termes de structure et d'idéologie. Il n'est pas facile, par exemple, d'inclure l'Allemagne et le Japon dans le même schéma, et il est encore plus difficile d'y inclure certains des petits États qui peuvent être décrits comme fascistes. On suppose, par exemple, que le fascisme est intrinsèquement belliciste, qu'il s'épanouit dans une atmosphère d'hystérie guerrière et qu'il ne peut résoudre ses problèmes économiques qu'en dépensant pour préparer des guerres ou conquérir des pays étrangers. Mais cela est clairement faux si l'on prend l'exemple du Portugal ou des différentes dictatures d'Amérique du Sud. Ou d'un autre côté, l'antisémitisme est censé être l'un des signes distinctifs du fascisme ; mais certains mouvements fascistes ne sont pas antisémites" [8].
De ce qui a été dit, on peut conclure que ces caractéristiques d'un fascisme éternel exposées par Eco dans ses 14 points, ne sont pas en accord avec la téléologie de la même re-signification qu'Eco a cherché à soutenir, de sorte que nous serions face à une incohérence apparente, puisque le concept ne serait pas fidèle à son fondement (Bunge, 2009), en cela, le concept d'Ur-Fascisme, serait sans rapport avec son fondement dans des caractéristiques qui ne se produisent tout simplement pas - en général -, ou ne se produisent pas dans tous les fascismes, comme Orwell l'a mentionné, concernant le bellicisme inhérent, l'appel aux classes frustrées, la xénophobie et l'antisémitisme. Étant donné que, pour ces raisons, le fascisme éternel d'Eco ne serait pas configuré comme une théorie scientifique sur la phénoménologie fasciste, mais simplement comme un ensemble d'hypothèses lâches qui n'ont pas atteint un degré de théorisation, nécessaire pour traiter le phénomène que l'on essaie d'expliquer d'une manière objective: "(...) au-delà des détails historiques du fascisme, il y a quelque chose d'éternel. L'écrivain italien Umberto Eco l'a appelé "Ur-Fascisme", ce qui signifie "primitif" ou "original". Malheureusement, ses "quatorze points" irréguliers étaient trop axés sur le totalitarisme descendant des grands dictateurs fascistes et de leurs collaborateurs. Leur "Ur-Fascisme" n'était pas assez "primitif". Ce n'était pas du tout "éternel" [10].
Pourtant, il vaut la peine de sauver des enfermements conceptuels d'Eco, la vérité qu'il a réellement essayé de présenter et qu'il n'a pas réussi à systématiser - étant donné les limites de son expertise académique - et qui est de rechercher l'essence même du fascisme, de ce fascisme primitif et original, de ce fascisme vraiment éternel.
"La plupart des gens associent les "maux" du fascisme à une institution bureaucratique descendante, mais pour moi les fasces semblent symboliser une idée ascendante"[11].
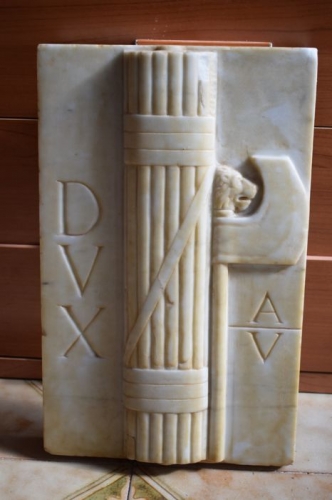
Dans le faisceau de fasces ou fascio littorio, on trouve l'essence même du fascisme le plus primitif :
"Les bâtons du fasces représentent la force et l'autorité d'un collectif uni. C'est leur attrait "primitif". La véritable unité tribale ne peut être imposée d'en haut. Il s'agit d'un phénomène organique. L'unité profonde vient d'hommes liés par un ruban rouge de sang. Le sang de la nécessité catastrophique qui lie la bande des frères devient le sang de l'héritage et du devoir qui lie la famille, la tribu, la nation. Les fasces captent l'imagination humaine car ils semblent symboliser la volonté unifiée des hommes. Les hommes préfèrent croire qu'ils offrent leur loyauté par choix, qu'ils le fassent réellement ou non. La libre association - ou sa simple apparence - est la différence entre les hommes libres et les esclaves. Si vous ne pouvez pas partir, vous êtes un prisonnier. Si vous choisissez de rester, si vous choisissez d'aligner votre destin sur celui du groupe et de vous soumettre à l'autorité collective du groupe, vous êtes un membre et non un esclave. En tant que membre, vous devez apporter le poids de votre masculinité à une confédération unifiée d'hommes" [12].
Notes:
[1] ORWELL, George, "Qu'est-ce que le fascisme ?" The Collected Essays, Journalism and Letters of George Orwell".1968 : "On remarque que, tel qu'il est utilisé, le mot "fascisme" n'a presque aucune signification. Dans la conversation, il est utilisé de manière encore plus insensée que dans la presse. D'après ce que j'ai entendu, elle s'applique aux agriculteurs, aux commerçants, au crédit social, aux châtiments corporels, à la chasse au renard, à la tauromachie, au comité de 1922, au comité de 1941, à Kipling, à Gandhi, à Chang Kai-Shek, à l'homosexualité, aux programmes de Priestley, aux auberges de jeunesse, à l'astrologie, aux femmes, aux chiens et je ne sais quoi encore."
[2] Sémiotique (del gr. semeiotike) n. Science qui étudie les symboles en général. Une branche de cette science est la linguistique, qui étudie le langage, le système des signes linguistiques.
[3] "Platon est un ami, mais la vérité est un meilleur ami." Dire contre le magister dixit, c'est-à-dire l'autorité des fondements par la seule notoriété et la transcendance de l'auteur.
[4] ECO, Umberto. Cinco Escritos Morales. Editorial Lumen. 1997. Pág.47-56.
[5] Ou en tout cas, étudier et/ou approfondir.
[6] ORWELL, George, The Road to Wigan Pier. 1937. Partie II, chapitre 12 : "Pour combattre le fascisme, il faut le comprendre, ce qui implique d'admettre qu'il contient à la fois du bien et du mal."
[7) Eric Arthur Blair ou plus connu sous son nom de plume "George Orwell", écrivain et journaliste britannique d'une grande importance pour la littérature universelle, non seulement pour son style basé sur une excellence critique, mais aussi pour son utilisation d'analogies et de parallélismes pour la présentation de dystopies ou de réalités humaines. Parmi ses œuvres les plus célèbres figurent La ferme des animaux (1945) et 1984 (1949).
[8] ORWELL, George, "Qu'est-ce que le fascisme ? The Collected Essays, Journalism and Letters of George Orwell" (1968).
[10] DONOVAN, Jack, Anarcho-Fascisme In : Un ciel sans aigles Dissonant Hum, 2014.
[11] Ibidem.
[12] Ibidem.
13:13 Publié dans Définitions | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : définition, ur-fascisme, fascisme, umberto eco, philosophie, philosophie politique |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Leo Strauss critique la "vie nue" dans le libéralisme 2.0
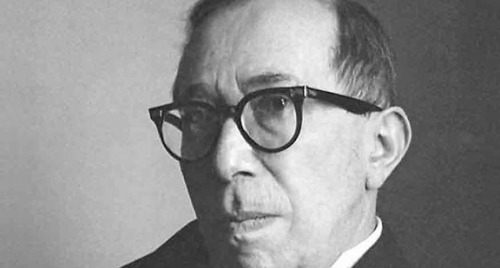
Leo Strauss critique la "vie nue" dans le libéralisme 2.0
Michael Kumpmann
Ex: https://www.geopolitica.ru/de/article/leo-strauss-kritik-am-nackten-leben-im-liberalismus-20
Dans mon dernier article, le rapport de Leo Strauss à la raison et à la religion a été mis en lumière. La deuxième partie traite de sa thèse des "Anciens" et des "Modernes", du déclin du libéralisme et de la manière dont cette thèse peut s'appliquer au concept de "libéralisme 2.0" de Dugin (voir sur ce site: http://euro-synergies.hautetfort.com/archive/2021/10/19/leo-strauss-liberalisme-1-0-et-revolution-conservatrice-6344800.html ).
Il convient toutefois de préciser au préalable que Strauss utilise un concept de libéralisme qui est plus qu'étrange. Il ne considère pas le libéralisme comme la première théorie politique de l'époque moderne, née des Lumières et des influences protestantes, mais il considère plutôt toute la philosophie européenne comme "libérale", à commencer par Platon et Aristote. En revanche, Strauss critique massivement les fondateurs plus récents du libéralisme, comme John Locke, et la plupart des autres libéraux actuels, qu'il considère comme des traîtres à l'idée libérale. En particulier dans le contexte où Douguine critique à juste titre le libéralisme tout en réclamant un retour à Platon, l'approche de Strauss semble plutôt bizarre. Elle offre néanmoins quelques conclusions intéressantes.
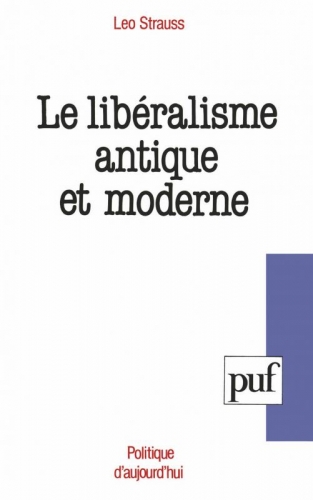
Pour Strauss, l'approche eudémoniste des humanistes classiques (qu'il appelle les "Anciens") constitue le noyau antique du libéralisme. Ce faisant, il défend une conception positive de la liberté : la liberté ne signifie pas que l'on peut faire tout ce que l'on veut, jeter sa vie aux orties, ne passer ses journées qu'à boire, manger de la malbouffe, regarder la télévision trash, regarder du porno, etc. Cette "liberté" n'est pas digne d'un être humain et ne conduit qu'à le faire dégénérer. Au lieu de cela, les humanistes classiques pensaient que l'homme possédait une sorte d'"étincelle divine" qui lui permettait d'aspirer à la grandeur. L'homme n'est pas parfait, c'est un être avec des faiblesses et des défauts, mais il peut reconnaître ses erreurs, se relever après chaque défaite, affronter des charges et des difficultés toujours plus grandes pour devenir la meilleure version possible de lui-même. Et même s'il échoue une fois, c'est toujours mieux que de ne jamais avoir essayé. La liberté positive est nécessaire pour que l'homme puisse mener exactement une telle vie. Et ce n'est que par cette vie que l'homme peut être libre. Une vie sans problèmes ni difficultés, où l'on obtient tout ce que l'on veut, comme le proverbial asticot, n'est pas une véritable liberté.
Selon Leo Strauss, cette eudaimonia est ce qui a fait le bien du libéralisme, mais le déclin et la chute du libéralisme ont commencé parce que les philosophes libéraux, à commencer par Machiavel, Hobbes et John Locke, ont commencé à se détourner de cette idée. On pensait qu'il était faux d'avoir des idéaux et des exigences envers les hommes et qu'il fallait accepter l'homme comme fondamentalement mauvais et corrompu.
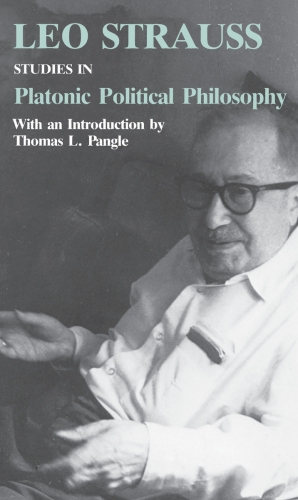
Les libéraux ont ainsi sacrifié l'idée de vertu, d'eudaimonia et de courage pour arriver au nouvel idéal de "survie nue". Et ce changement de paradigme a conduit à une redéfinition de la morale. Désormais, la morale ne consistait plus à rechercher la meilleure vie possible, mais tout ce qui assurait la survie de l'individu et de l'État était soudain moral. Pour Hobbes, l'homme n'avait fondamentalement aucun désir plus grand ou plus élevé que celui de simplement survivre. Et c'est de là qu'est né le concept des droits de l'homme, qui réduisait la morale à la phrase "Fais ce que tu veux, mais ne dérange pas et ne mets pas les autres en danger en le faisant".
Selon Strauss, cette orientation vers la "survie nue" était toutefois le germe du totalitarisme.
En ce qui concerne la thèse de Leo Strauss selon laquelle le (vrai) libéralisme a périclité à cause de l'idée de "survie pure" et a "accouché" d'idées totalitaires, il est bien sûr désormais macabre que Giorgio Agamben, un autre élève de Carl Schmitt, affirme que c'est précisément cette "vie nue" qui est le paradigme derrière la "dictature née du coronavirus". Il y a plus de 50 ans, un philosophe a averti qu'à cause de l'idée de "survie nue", l'idée d'une société libre se meurt. Et c'est au nom de cette idée que nous avons aujourd'hui des interdictions de contact, l'obligation de porter un masque, des mesures de surveillance, la censure de scientifiques critiques comme Sucharit Bhakdi, des violences policières contre les manifestants et certains politiciens discutent même de "camps de quarantaine".
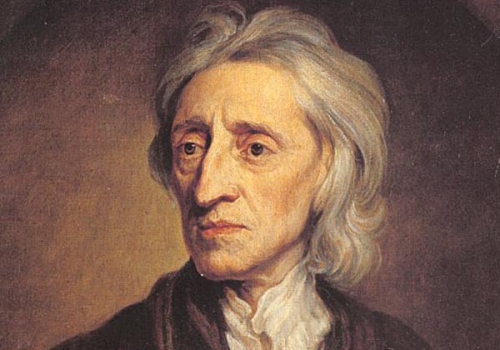
Le plus drôle dans tout cela, c'est que cela révèle en fait le caractère non libre de la morale lockienne des droits de l'homme. D'habitude, on considère ce mantra de "ne pas déranger ni mettre en danger d'autres personnes" comme le garant de la liberté. Mais dans la pandémie, les aspects sociaux élémentaires de l'être humain tels que l'amitié, l'amour, la tendresse, le contact, l'échange avec d'autres personnes et ainsi de suite deviennent tous des perturbations potentielles et des menaces pour la paix, raison pour laquelle l'État, afin de protéger la "vie nue", sépare l'être humain de son prochain et tente de l'enfermer chez lui, car c'est la seule façon de garantir une sécurité absolue.
Selon Strauss, cette idée de la vie nue conduit finalement à ce que seuls le confort, la sécurité, la richesse, la croissance économique, etc. soient considérés comme des vertus politiques, tandis que le courage et le goût du risque sont érigés en vices (et indirectement, cela conduit à un renversement des valeurs, où le "crétin consumériste paresseux et lâche" est alors en toute apparence moralement supérieur à l'homme courageux). Selon Strauss, le militarisme des Soviétiques et des fascistes consistait en une révolte contre l'idée libérale de "survie nue". On a vu dans la volonté de mourir pour la bonne cause l'antithèse de la "vie à tout prix", propre de l'idéologie libérale.
Mais Strauss voyait dans le retour à l'éducation classique, qui mettait l'accent sur l'eudaimonia et l'apprentissage des compétences comme moyen de formation du caractère, plus qu'un effort pour être purement utilisable et utile au capitalisme (pour le reste, Strauss ne voulait malheureusement pas se débarrasser de la démocratie libérale, mais simplement la réformer de l'intérieur pour qu'elle corresponde à nouveau davantage à l'idéal antique; bien qu'il ne s'agisse que d'une approche en demi-teinte, l'idée de Strauss pourra peut-être aider à surmonter complètement le monde moderne à l'avenir).
L'approche de Strauss est en tout cas une bonne explication de ce qu'Alexander Dugin appelle le "libéralisme 2.0". On voit bien que le libéralisme a abandonné ses prétentions au courage, à l'excellence et à la vertu (au sens aristotélicien du terme) et qu'il s'est réduit à une fausse promesse de sécurité. Le libéralisme 2.0 est le "cauchemar achevé", la conséquence de la chute dans le nihilisme.
De nombreux événements de l'histoire indiquent que Strauss avait raison sur ce point.
L'école autrichienne, Ayn Rand et Franz Josef Schumpeter ont encore célébré l'entrepreneur génial qui s'impose contre les résistances et supporte courageusement toutes les hostilités comme l'adversité pour réaliser sa vision. (Chez Jack Parsons et Ayn Rand, un tel état d'esprit "courageux" correspondait aussi indirectement à la virilité qui rend les hommes attrayants aux yeux des femmes). Karl Raimund Popper a, quant à lui, diabolisé tous les illibéraux et présenté le libéralisme comme un rempart contre eux. On peut déjà y voir une position de lâcheté. La recherche de l'excellence s'est transformée en choix du moindre mal.
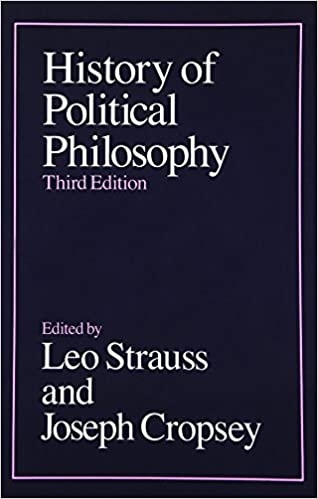
Aujourd'hui, dans le libéralisme 2.0, la peur prend les traits d'une paranoïa développée. Le meilleur exemple en est le débat sur le prétendu discours haineux (hate speech). Les libéraux classiques qui défendent l'homosexualité se prononceraient éventuellement en public pour les droits des homosexuels. Mais on n'aurait pas pu en déduire que d'autres trouvent cela bien. On leur aurait plutôt répondu qu'une personnalité forte et surtout libre doit pouvoir supporter que des choix de vie entraînent des conséquences négatives et qu'ils puissent être critiqués par d'autres. Mais aujourd'hui, on essaie de protéger les minorités de toute critique et de toute conséquence négative de leurs actes. Même lorsqu'il s'agit de quelque chose d'anodin comme une "remarque stupide". Et le droit des religieux à rejeter l'homosexualité aurait également mérité d'être protégé.
En matière de morale sexuelle, la permissivité des anciens soixante-huitards et des hippies a totalement disparu pour laisser place à une paranoïa omniprésente vis-à-vis de la culture du viol, de la masculinité toxique et autres. Tout partenaire sexuel potentiel (ou même un homme qui ose tenir la porte à une femme) est d'abord considéré comme un agresseur potentiel, contre lequel l'État doit déployer un parapluie protecteur. Des formes de sexualité complètement irréelles/virtuelles comme la consommation de pornographie fleurissent, car elles n'ont pas besoin de partenaires et représentent donc les seules formes de sexualité totalement sûres.
En Occident, les enfants sont souvent empêchés de jouer à l'air libre par des parents surprotecteurs trop zélés, parce que cela pourrait être trop dangereux.
En Occident, le débat politique se résume à "Oh mon Dieu, nous allons tous mourir". Qu'il s'agisse de l'énergie nucléaire, de la grippe porcine, du SRAS, de Corona, de la droite si méchante, du changement climatique, de Donald Trump, des prétendus Etats voyous ou d'autres scénarios d'horreur, le peuple est maintenu dans une peur permanente.

Les professeurs d'université doivent désormais assortir même les classiques de la littérature mondiale comme MacBeth d'avertissements moralisateurs, quand on ne finit pas par réécrire ces classiques ou par les interdire complètement au nom du politiquement correct. Entre-temps, chaque philosophe ayant vécu en Allemagne entre 1933 et 1945 est publiquement ostracisé, parce que l'on craint que son œuvre ne contienne quelque pensée nazie cachée et n'incite donc d'autres personnes à devenir elles aussi des nazis.
Il règne une mentalité "tous risques", où il est considéré comme bon de se prémunir contre toute éventualité. Et au lieu de mener une bonne vie ici et maintenant, il vaut mieux se préparer à un éventuel effondrement du système de retraite.
La loi impose d'étiqueter les produits avec des avertissements exagérés, même si ces "dangers" sont évidents pour le bon sens. On connaît par exemple un cas aux États-Unis où un fabricant d'allumettes a dû avertir que les allumettes étaient inflammables.
Outre le courage, l'excellence a également disparu. On le voit par exemple aux choses dont on devrait être fier selon les libéraux de gauche. Autrefois, on devait être fier d'avoir accompli quelque chose de grand, d'avoir des compétences particulières, etc. Aujourd'hui, ce n'est plus une chose dont on peut être fier qui compte. Au lieu de cela, on doit être fier d'être gay, trans, handicapé ou d'avoir une maladie mentale. Aujourd'hui, celui qui a réussi quelque chose dans la vie n'est plus digne d'admiration, mais un soi-disant méchant, privilégié, qui discrimine certainement les autres en permanence.
Les gens qui, comme Donald Trump, risquent tout, mais se battent pour remonter la pente après un échec, ne sont plus considérés comme des modèles, mais comme des idiots dangereux pour la société.
Le fait que la survie à l'état brut soit aujourd'hui devenue un idéal était déjà perceptible avant la crise du coronavirus. Chez les féministes libérales et le libéralisme 2.0, clairement marqué par le féminisme, prévaut une drôle de conception de la liberté, qui se concentre uniquement sur l'indépendance économique et sur la capacité à pouvoir subvenir seul à ses besoins, et qui considère donc le travail et la consommation comme les choses les plus importantes de la vie, tout en faisant des sentiments humains élémentaires comme l'amour un "luxe sans importance", car on n'en a pas forcément besoin pour la simple survie. Des choses comme l'esprit d'entreprise créatif, dont les "libéraux 1.0" parlaient volontiers, ont également complètement cédé la place à un matérialisme primitif.
Après avoir examiné la principale critique du libéralisme de Strauss, la dernière partie de cette série sera consacrée à Michael Anton et à sa réaction au "libéralisme 2.0" inspirée par Strauss.
12:39 Publié dans Actualité, Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : leo strauss, philosophie, philosophie politique, libéralisme, libéralisme 2.0, actualité |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
vendredi, 24 décembre 2021
Honneur à Terminus, le dieu des frontières

Honneur à Terminus, le dieu des frontières
Diego Fusaro
Ex: https://www.geopolitica.ru/es/article/honor-terminus-el-dios-de-las-fronteras
Terminus : c'était le nom de la divinité limite adorée par les Romains dans un temple spécial sur la colline du Capitole. En son honneur, des pierres ont été plantées pour marquer les limites des fermes. Ovide le célèbre en vers dans les Fastos (II, vv. 640-650) : " Que le dieu dont la présence marque les limites des champs soit dûment célébré. O Terme, qu'il s'agisse d'une pierre ou d'un poteau planté dans le champ, tu as un pouvoir divin (numen) depuis l'antiquité". Hegel n'a pas tort lorsque, dans ses Leçons sur la philosophie de la religion, il affirme que la religion des Romains, à la différence de la religion grecque, fondée sur la beauté, est la " religion de la finalité extérieure ", dans le panthéon de laquelle les dieux sont compris comme des moyens pour la réalisation de fins entièrement humaines : le Terminus n'échappe pas non plus à cette logique, car il incarne la nécessité très matérielle et même banale de subdiviser la terre.
Les Terminalia étaient aussi les fêtes dédiées au dieu, introduites par Numa Pompilius pour le 23 février : à l'occasion de la fête, les deux propriétaires des frontières adjacentes couronnaient de guirlandes la "statue" du dieu, une simple pierre fichée dans le sol, et érigeaient un autel grossier. La fête publique s'est déroulée à la borne du kilomètre VI de la voie Laurentienne, identifiée à la limite originelle du territoire de l'Urbs.
On peut raisonnablement affirmer que l'essence de la frontière, outre la figure de Terminus, peut également être déchiffrée à travers un autre dieu romain, Janus, la divinité dont les deux visages font allusion au passage. Du dieu Janus dériverait la même devise ianua, qui renvoie à la "porte" comme figure par excellence d'un passage réglementé et qui remplit donc de manière paradigmatique la fonction de frontière entre l'intérieur de la domus et son extérieur. La ville de Gênes elle-même devrait, selon certains, devoir son nom à sa position particulière d'ianua régulatrice du transit biunivoque entre les puissances thalassiques et telluriques.
De ce point de vue, le "con-fino" indique une vérité aussi simple que profonde : à savoir que séparer et relier sont deux faces différentes d'un même acte, représenté par ce seuil par excellence qu'est la porte, dont l'ontologie fondamentale (par rapport à celle du pont) fait d'ailleurs l'objet d'une importante étude de Simmel. Une maison sans portes et sans accès n'est plus une maison, mais une forteresse, un espace clos inaccessible et, pour ceux qui y sont enfermés, une prison oppressante. Contrairement au mur, qui est hermétiquement fermé, la frontière sépare en unissant et unit en séparant : son essence est relationnelle, car elle favorise la relation dans l'acte même de veiller à ce que les personnes liées restent distinctes.

Le mur, par son essence même, est un finis matérialisé, sans le "avec" du cum-finis : l'autre est exclu et caché, refusé au toucher et à la vue, expulsé dans sa forme la plus radicale. L'autre est exclu et caché, privé du toucher et de la vue, expulsé dans sa forme la plus radicale. Le mur érigé par Israël en Cisjordanie, avec sa volonté explicite de se désengager, même visuellement, des Palestiniens, en est un sinistre exemple, parmi tant d'autres. En tant que seuil et limite osmotique, la con-fine est au contraire un seuil relationnel : elle reconnaît l'altérité de l'autre et le rend égal à nous en tant que sujet, acceptant et confirmant ainsi cette variété irréductible de l'être et du monde que le mur et la traversée voudraient nier.

Dans sa logique sous-jacente, la frontière est donc le non-reniement de l'autre et, en outre, le fondement de toute relation possible avec l'autre, puisqu'elle présuppose toujours - cela va de soi - que l'autre est. On dit souvent, sur un ton désormais proverbial, que nous avons besoin de ponts et non de murs. C'est vrai, à condition d'apporter une double précision, qui n'est pas oiseuse : a) tout pont n'est pas relationnel, puisque nous savons, depuis Les Perses d'Eschyle, que le pont a aussi une possible fonction martiale et agressive ; b) le pont existe tant qu'il y a deux rives différentes qui se relient, ce qui nous permet de comprendre le pont lui-même comme un cas spécifique de frontière et, donc, de relation entre des identités différentes.
Il ne faut pas oublier que la génération elle-même a lieu sous la forme d'une relation à double sens, et aussi sous la forme d'un choix d'ouverture à l'autre et de relation avec lui sans perdre sa propre différence : la frontière qui marque la différence de genre entre le masculin et le féminin et la différence ontologique entre le Je et le Tu ne nie pas la relation, mais la garantit. En garantissant la différence, elle rend possible la relation et la reconnaissance de manière fructueuse.
Source première: https://avig.mantepsei.it/single/onore-a-terminus-il-dio-del-confine
12:58 Publié dans Actualité, Philosophie, Traditions | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : rome, rome antique, diego fusaro, philosophie, philosophie politique, traditions, terminus |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
vendredi, 03 décembre 2021
Vers un renouveau du conservatisme ? (Armin Mohler)
12:19 Publié dans Nouvelle Droite, Révolution conservatrice, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : allemagne, suisse, révolution conservatrice, armin mohler, nouvelle droite, nouvelle droite allemande, théorie politique, philosophie politique, sciences politiques, politologie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
jeudi, 25 novembre 2021
Marx le Messie
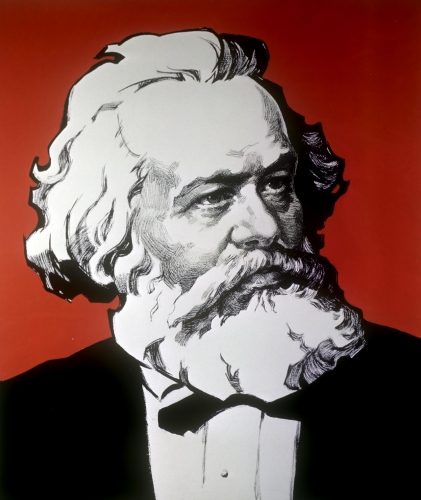
Marx le Messie
Luca Bistolfi
Trop d'intellectuels laqués, laquais du pouvoir, citent Marx au hasard. C'est pourquoi le grand vieillard de Trèves s'avère très nécessaire à relire dans le moment terrible et marquant que nous vivons.
SOURCE : https://www.lintellettualedissidente.it/controcultura/filosofia/marx-berlin/
Bien conscient de l'inanité de certains de ses thuriféraires-charlatans contemporains et notamment des professeurs d'université, Schopenhauer a été contraint, dans la Préface de la deuxième édition de son livre Welt, de tremper sa plume plus que de coutume dans l'acide pour fustiger l'habitude d'un certain public de recourir à des exposés de seconde main au lieu de lire les textes originaux. C'est l'"affinité élective, par laquelle une nature commune se sent attirée par ses semblables", tout comme les enfants "apprennent mieux d'autres enfants". Et qui sait ce qu'il écrirait aujourd'hui face à des coupures de presse et des "tutoriels" philosophiques !
Cependant, il ne faut pas être trop rigide, et si l'on souhaite mordre dans les idées et les auteurs avec la dureté d'un autodidacte, afin d'éviter le moule académique, on peut certainement recourir aux travaux préparatoires. C'est dans ce sens que je veux attirer l'attention du lecteur sur deux Karl Marx.
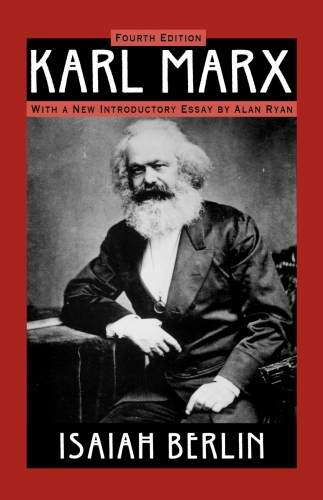 Le premier est publié ces dernières semaines par Adelphi et est signé par Isaiah Berlin. Il s'agit en fait d'une réédition du texte paru en 1969 pour La Nuova Italia, mais avec un appareil critique plus efficace. Berlin n'est pas le premier penseur antimarxiste à écrire un ouvrage honnête, lucide et informé sur le "docteur de la terreur rouge", comme on l'appelait en son temps : pensons, par exemple, aux connaissances considérables dont firent preuve Giovanni Gentile, le premier professeur d'Antonio Gramsci, et Benedetto Croce, un élève du marxiste Antonio Labriola. L'étude du travail de Berlin ne manque pas de nous faire découvrir quelques imprécisions terminologiques, quelques citations irréfléchies - auxquelles les éditeurs remédient néanmoins - et quelques jugements un peu hâtifs ; mais ces péchés sont somme toute négligeables face à une étude rigoureuse et surtout honnête, même si elle est datée puisqu'elle remonte à 1938. Ceux qui souhaitent avoir un aperçu général de Marx en tant que penseur, érudit et activiste politique trouveront ici satisfaction. Il s'agit d'une sorte de vaste entrée d'encyclopédie, du genre qui n'est plus composé nulle part.
Le premier est publié ces dernières semaines par Adelphi et est signé par Isaiah Berlin. Il s'agit en fait d'une réédition du texte paru en 1969 pour La Nuova Italia, mais avec un appareil critique plus efficace. Berlin n'est pas le premier penseur antimarxiste à écrire un ouvrage honnête, lucide et informé sur le "docteur de la terreur rouge", comme on l'appelait en son temps : pensons, par exemple, aux connaissances considérables dont firent preuve Giovanni Gentile, le premier professeur d'Antonio Gramsci, et Benedetto Croce, un élève du marxiste Antonio Labriola. L'étude du travail de Berlin ne manque pas de nous faire découvrir quelques imprécisions terminologiques, quelques citations irréfléchies - auxquelles les éditeurs remédient néanmoins - et quelques jugements un peu hâtifs ; mais ces péchés sont somme toute négligeables face à une étude rigoureuse et surtout honnête, même si elle est datée puisqu'elle remonte à 1938. Ceux qui souhaitent avoir un aperçu général de Marx en tant que penseur, érudit et activiste politique trouveront ici satisfaction. Il s'agit d'une sorte de vaste entrée d'encyclopédie, du genre qui n'est plus composé nulle part.
Il ne faut donc pas s'attendre à y trouver un exposé des découvertes de Marx dans les Grundrisse ou le Capital. La marque de ce Karl Marx réside dans la capacité d'Isaiah Berlin à ancrer le sujet dans son époque et, surtout, à décrire certains fondements philosophiques cruciaux avec une compétence et une clarté d'exposition exemplaires, qui ressortent particulièrement à certains moments, comme les pages magistrales consacrées à Hegel et au rapport fondamental du jeune Marx avec sa philosophie, et le chapitre sur le "Matérialisme historique", un sujet, comme chacun sait, plutôt dur, mais Berlin montre qu'il sait "manier avec soin" les concepts hégélo-marxistes, sans générer de malentendus embarrassants, qui seraient dus à un excès d'orthodoxie, ou peut-être à à un défaut d'orthodoxie, qui émaillent malheureusement les pages de nombreux marxistes, réels ou supposés.
Toutefois, permettez-moi de faire deux suggestions pour tous ceux qui envisagent d'aborder cette étude. Tout d'abord, il est nécessaire de lire attentivement la "Préface de l'éditeur à la cinquième édition", l'une des rares prémisses utiles en circulation. Deuxièmement, ne lisez pas la quatrième de couverture : elle semble clairement avoir été écrite soit dans l'intention de mettre en garde contre Marx, soit a plutôt été écrite sans avoir lu le livre, en tenant pour acquis que le Berlin n'était qu'un libéral doctrinaire, type humain que l'on rencontre dans maintes rédactions.
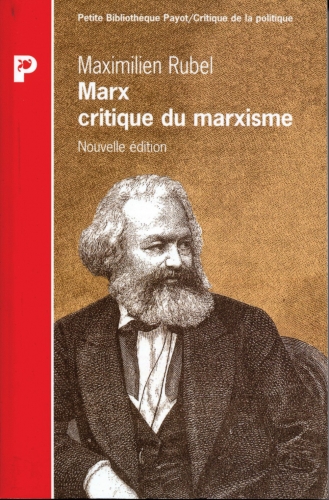 Différent à tous égards, le Karl Marx de Maximilien Rubel, sorti il y a vingt ans, en 2001, mais toujours disponible chez l'éditeur milanais Colibri, est l'un des outils les plus indispensables pour qui veut étudier sérieusement le Grand Ancien de Trêves. Contrairement à Berlin, qui est connu de tous, le nom de Rubel sera inconnu de la plupart des gens : mais, pour ce que cela vaut, je peux vous assurer que nous avons affaire à l'un des chercheurs les plus intelligents, les plus aigus et les mieux préparés du marxisme européen, capable de traiter un sujet très complexe avec habileté et dextérité. Afin de fournir le stimulus nécessaire pour inviter le lecteur à lire le livre, il faut partir du deuxième sous-titre de l'ouvrage : Prolegomeni per una sociologia etica (Prolégomènes pour une sociologie éthique), que l'auteur a ajouté à la seule édition italienne, bien meilleure à tous égards que l'original français. Il est également doté d'une chronologie raisonnée et minutieuse de plus de cent pages et d'un solide appareil critique.
Différent à tous égards, le Karl Marx de Maximilien Rubel, sorti il y a vingt ans, en 2001, mais toujours disponible chez l'éditeur milanais Colibri, est l'un des outils les plus indispensables pour qui veut étudier sérieusement le Grand Ancien de Trêves. Contrairement à Berlin, qui est connu de tous, le nom de Rubel sera inconnu de la plupart des gens : mais, pour ce que cela vaut, je peux vous assurer que nous avons affaire à l'un des chercheurs les plus intelligents, les plus aigus et les mieux préparés du marxisme européen, capable de traiter un sujet très complexe avec habileté et dextérité. Afin de fournir le stimulus nécessaire pour inviter le lecteur à lire le livre, il faut partir du deuxième sous-titre de l'ouvrage : Prolegomeni per una sociologia etica (Prolégomènes pour une sociologie éthique), que l'auteur a ajouté à la seule édition italienne, bien meilleure à tous égards que l'original français. Il est également doté d'une chronologie raisonnée et minutieuse de plus de cent pages et d'un solide appareil critique.
L'intention principale de Rubel est de libérer Marx des lectures économistes arides, en saisissant la continuité, de sa jeunesse à sa mort, d'une instance éthique pré-politique et pré-économique. Mais écoutons les mots éloquents de l'auteur:
"Non seulement il n'y a pas, chez Marx, d'intention spécialiste, mais il faut aussi s'abstenir d'y voir une tentative philosophique de s'élever au-dessus des diverses spécialisations en vertu de l'activité systématique et médiatrice de la pensée : une telle "philosophie", pour lui, avait elle-même un caractère fragmentaire, était un pur produit de la division du travail et de son aliénation. Ou du moins, cela ne lui semblait concevable - puisque philosopher est nécessaire - que si elle était surmontée et réalisée dans la pratique, c'est-à-dire rendue inutile en tant que projet. Les raisons de Marx étaient d'un autre ordre, que je crois pouvoir définir comme éthiques, dans la mesure où l'éthique est précisément ce qui, dans la pensée d'un homme, fuit instinctivement toute particularisation réductrice pour embrasser la diversité des activités dans une vision d'ensemble toujours plus élevée et les rapporter sans cesse à la vérité pratique [...]. Marx n'a pas créé, ni eu l'intention de créer, un nouveau système d'économie politique. Il voulait donner aux hommes luttant pour la transformation radicale de la société une explication théorique et critique du mode de production capitaliste. Karl Marx a voulu orienter la connaissance scientifique de la société vers une cause éminemment révolutionnaire : le renversement du capitalisme et la construction d'une société libérée de l'exploitation et de l'oppression".
Cette libération permettra aux individus de se réaliser enfin sans aucune contrainte, de devenir des êtres humains intégraux parce que libérés de la lutte des classes et de la domination, qui enserrent et concourent au libre développement visant à la connaissance - progressive et pourtant nécessairement asymptotique - tant du cerveau individuel que du cerveau social, une expression qui n'est pas présente chez Rubel mais que j'emprunte au vocabulaire d'Amadeo Bordiga, l'un des plus grands théoriciens révolutionnaires du 20ème siècle.
Mais pourquoi aborder Marx ?
Depuis quelques années, une fois que la démoralisation consécutive aux événements européens de 1989-1991 s'est estompée, et parfois à l'occasion de quelques anniversaires, Karl Marx revient de temps en temps sur le devant de la scène, mais soit comme une pose intellectuelle, soit comme une figure reproposée par quelques merluchons de la télévision avides d'argent et aux boucles parfumées, et précisément pour cette raison sans être vraiment familier avec lui, ou encore moins conscient de ses prémisses et surtout de ses conclusions révolutionnaires. Cependant, la crise structurelle anormale du système mondial actuel, à laquelle s'ajoute la catastrophe hautement probable et imminente, obligera le prolétariat - ancien et nouveau - et les masses en général à s'orienter dans la direction indiquée par l'agitateur de Trêves et ceux qui, au cours des décennies, ont maintenu vivants son enseignement et ses encouragements.
Seuls les cerveaux abrutis par l'idéologie dominante qui les instille et les asservit, et seuls les parasites sociaux du monde, de tout ordre et de tout degré, ignorent le moment terrible et épocal que nous vivons et la catastrophe vers laquelle nous avons déjà fait les premiers pas. Et sans instruments politiques adéquats, le sort des classes subalternes - pas moins que celui de la bourgeoisie ! - est scellé de la manière la plus fatale. Même les simulacres de revendications écologiques et gendéristes, aussi mal posés et mal préparés soient-ils, marquent un changement de cap qui, toutefois, s'il n'est pas bien guidé, risque de n'être qu'une énième fausse solution, vide face à des drames concrets et immanents qui ne peuvent être résolus que par le renversement du système politique et économique actuel.
Bien sûr, il ne faut pas commettre la très grave erreur de considérer le marxisme comme une idéologie et, encore moins, comme une idéologie enfermée dans un système relégué au 19ème siècle et dont la teneur s'avère "incommunicable" avec le monde actuel, comme beaucoup de gens des deux côtés parviennent admirablement à le faire et comme une position explicitement niée par Berlin et Rubel. Avec ses sodalistes et ses disciples, Marx est l'arme critique efficace essentielle avec laquelle il faut s'entraîner en attendant de passer des armes de la critique à la critique des armes.
Luca Bistolfi
10:00 Publié dans Actualité, Philosophie, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : karl marx, marxisme, philosophie, philosophie politique, politologie, sciences politiques, théorie politique |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mardi, 23 novembre 2021
"Discipline du chaos" : les illusions brisées du libéralisme

"Discipline du chaos": les illusions brisées du libéralisme
Par Alessio Mannino
Ex: http://osservatorioglobalizzazione.it/osservatorio/disciplina-del-caos-le-illusioni-infrante-del-liberalismo/
Parmi les différents courants qui ont animé la modernité, le libéralisme est devenu le dogme de base qui soutient aujourd'hui la domination des seigneurs de l'argent, grâce à la sournoise escroquerie idéologique séculaire selon laquelle il n'y aurait pas de liberté en dehors d'une quête individualiste du succès économique, la politique étant réduite à un esclavage auxiliaire d'un "bien-être" non seulement injuste et inégal, mais en fait de plus en plus renversé en malaise social et existentiel. Actuellement, la morale libérale est une anti-éthique de masse au service de ceux qui contrôlent le cycle mondial de l'argent par le biais du pouvoir des États. La généalogie de la morale libérale montre, d'une part, comment la morale libérale a bouleversé le sens premier de la libéralité et, d'autre part, comment il est possible de s'extraire du piège mental de la fausse liberté.
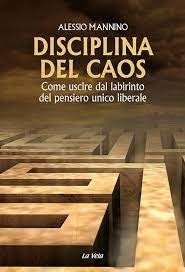 Dans l'essai Disciplina del caos publié par "La Vela" et récemment édité, dont nous présentons aujourd'hui un extrait, Alessio Mannino trace un itinéraire qui va de la démystification des grands théoriciens pour descendre dans les bas-fonds du quotidien aliéné, jusqu'à l'hypothèse d'une discipline fondamentale pour lutter dans le chaos de la triste époque. L'essai est complété par des entretiens avec Franco Cardini, Paolo Ercolani, Fabio Falchi, Thomas Fazi, Carlo Freccero et Marco Gervasoni.
Dans l'essai Disciplina del caos publié par "La Vela" et récemment édité, dont nous présentons aujourd'hui un extrait, Alessio Mannino trace un itinéraire qui va de la démystification des grands théoriciens pour descendre dans les bas-fonds du quotidien aliéné, jusqu'à l'hypothèse d'une discipline fondamentale pour lutter dans le chaos de la triste époque. L'essai est complété par des entretiens avec Franco Cardini, Paolo Ercolani, Fabio Falchi, Thomas Fazi, Carlo Freccero et Marco Gervasoni.
L'auteur - Alessio Mannino (1980), journaliste indépendant. Professionnellement né à Voce del Ribelle fondé par Massimo Fini, il a édité les journaux en ligne La Nuova Vicenza et Veneto Vox. Il écrit pour Il Fatto Quotidiano, L'Intellettuale Dissidente (où il tient une chronique, "Sott'odio"), The Post Internazionale, Kritika Economica et Mondoserie.it. Il collabore avec la chaîne youtube Vaso di Pandora et est l'auteur de Contro. Considerazioni di un antipolitico (Maxangelo, 2011), Mare monstrum. Immigrazione : bugie e tabù (Arianna Editrice, 2014), Contro la Constituzione. Attacco ai filistei della Carta '48 (= Contre la Constitution. Attaque contre les philistins de la Charte de 48) (Edizioni Circoli Proudhon, 2016). Son dernier ouvrage Disciplina del caos. Come uscire dal labirinto del pensiero unico liberale (= Comment sortir du labyrinthe de la pensée unique libérale) (La Vela), est sorti le 11 octobre 2021.
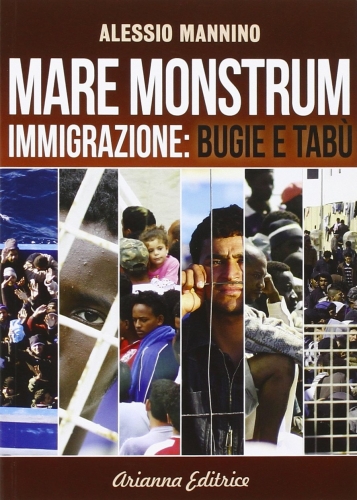
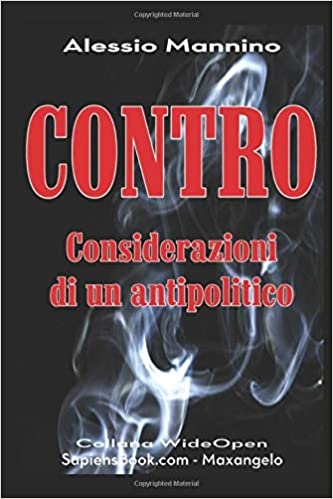
Quand la liberté se dévore elle-même
Extrait de "Discipline du Chaos" - pages 385-389.
L'individualisme, l'âme du libéralisme, peut être défini comme le principe de la solitude. Après avoir démoli la stabilité en tant que valeur, "nous nous sommes tous retrouvés terriblement seuls". C'est là qu'il faut repartir : de la plénitude des liens qui réconcilient les individus avec eux-mêmes.
Le libéralisme a été bien plus que la coquille de légitimation du capitalisme. Elle a représenté une césure anthropologique : pour la première fois dans l'histoire, la dimension économique est devenue le centre de la vie humaine. Alors que dans l'Antiquité, et dans une certaine mesure encore au Moyen Âge, l'économie, du moins dans l'idéal, restait une partie de l'ensemble, et de surcroît pas la plus noble (le marchand était digne d'être honoré, non pas en tant que marchand ni en tant que prêteur d'argent), avec l'époque moderne, la sphère productive et commerciale se détache du cadre communautaire et, devenant autonome dans la société civile, l'emporte sur toutes les autres. Le projet moderne répudie la nature législative et l'historia magistra vitae et les remplace par la calculabilité, selon laquelle tout phénomène est mesurable, quantifiable et programmable (l'entreprise capitaliste moderne, écrit Weber, "est entièrement basée sur le calcul"). Ce qui intéresse la modernité libérale, c'est la sécurité du commerce privé. Par conséquent, il n'y a plus besoin d'une théorie de l'État, car l'État n'est pas un sujet primaire, mais un dérivé, un instrument dangereux contre lequel il faut se défendre. Il n'y a donc plus de sens à parler de gouvernement : il vaut mieux parler de gouvernance, d'administration bureaucratique en pilotage automatique.
 La liberté comme domination sur l'excès est abandonnée pour faire place à l'excès comme vertu, la soif de pouvoir tournant entièrement autour du nervus rerum de l'argent ("la technique qui unit toutes les techniques"). Le véritable objectif du capitalisme libéral, cependant, n'est pas l'argent lui-même : c'est l'appropriation du futur par l'argent ("il n'y a pas de passé et il n'y a pas de présent, seulement le futur"). Spéculation et exploitation : patient de l'accumulation, le capitaliste livré à lui-même, quelles que soient ses intentions, est un criminel éthique. La monétisation de la réalité a agi comme un acide solvant dans le comportement humain, le dévorant comme dans "une fièvre qui augmente d'abord le métabolisme et accélère la croissance d'un organisme, pour ensuite affecter sa forme et miner son existence même".
La liberté comme domination sur l'excès est abandonnée pour faire place à l'excès comme vertu, la soif de pouvoir tournant entièrement autour du nervus rerum de l'argent ("la technique qui unit toutes les techniques"). Le véritable objectif du capitalisme libéral, cependant, n'est pas l'argent lui-même : c'est l'appropriation du futur par l'argent ("il n'y a pas de passé et il n'y a pas de présent, seulement le futur"). Spéculation et exploitation : patient de l'accumulation, le capitaliste livré à lui-même, quelles que soient ses intentions, est un criminel éthique. La monétisation de la réalité a agi comme un acide solvant dans le comportement humain, le dévorant comme dans "une fièvre qui augmente d'abord le métabolisme et accélère la croissance d'un organisme, pour ensuite affecter sa forme et miner son existence même".
Partant du principe que la rationalité utilitaire est un critère plus rationnel que l'imprévisibilité de la raison politique, l'intérêt privé et économique a colonisé l'imaginaire, affaiblissant le concept même de public. Et finir, aujourd'hui, par considérer la méfiance envers les autres comme un fait tout à fait normal ("75,5% des Italiens ne font pas confiance aux autres, convaincus que nous ne sommes jamais assez prudents pour entrer en relation avec les gens", comme le note le Censis dans son rapport 2019).
Les armes de la distorsion libérale ont été la science technique et l'économie néoclassique. Il serait plus correct de la qualifier de marginaliste, puisqu'elle est née contre celle, classique, de David Ricardo (contrairement au laissez-faire), idéalisant la marge, c'est-à-dire la contribution que chaque sujet apporte à la production du revenu. Les marginalistes prétendent démontrer non seulement une lecture simpliste de la loi de Say - selon laquelle l'offre non régulée générerait magiquement la demande - mais aussi que le plein emploi est possible grâce à une flexibilité contractuelle massive. Loin d'être scientifique, cette école doit être considérée comme "une théorie politique en quête d'hégémonie" qui passe sous silence la surproduction structurelle qui conduit le capitalisme à des crises cycliques de la demande (ce qui signifie que l'on produit plus que l'on ne consomme).
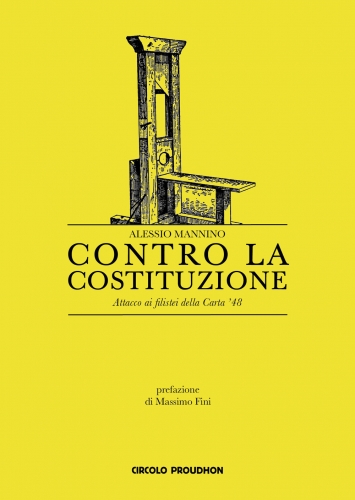
La liberté en tant qu'exemption d'impositions, et donc d'impôts, a d'abord légitimé la relève de la garde entre l'aristocratie du sang et l'aristocratie des affaires. Dans un deuxième temps, toujours en cours, elle a éradiqué le concept même de hiérarchie de l'effort et du mérite. Historiquement justifiée par le déclin de la noblesse et l'inefficacité de l'absolutisme, l'émancipation des 18ème et 19ème siècles des chaînes de la tradition (ancien régime) est réitérée aujourd'hui comme s'il existait encore une sainteté résiduelle, qui a depuis longtemps été rasée. Les libéraux du dernier mètre, ceux que l'on appelle les néo-libéraux, raisonnent comme si Adam Smith était parmi nous. David Boaz, vice-président du Cato Institute à Washington, a déclaré que "le libéralisme a d'abord conduit à la révolution industrielle et, dans une évolution naturelle, à la nouvelle économie [...]. D'une certaine manière, nous avons repris le chemin tracé au début du 18ème siècle, à la naissance du libéralisme et de la révolution industrielle [...]. L'idéal libéral n'a pas changé depuis deux siècles. Nous voulons un monde dans lequel les hommes et les femmes peuvent agir dans leur propre intérêt [...] parce que c'est ainsi qu'ils contribueront au bien-être du reste de la société. Plus clair que ça...
"Les institutions libérales cessent d'être libérales dès qu'il est impossible de les obtenir : il n'y a rien ensuite qui nuise plus terriblement et plus radicalement à la liberté que les institutions libres".
Friedrich Nietzsche
Le libéralisme a déclaré inacceptable le besoin de pierres angulaires communes autres que les règles de procédure. Il est ainsi devenu l'ennemi public numéro un de la liberté dont il prétend avoir l'exclusivité. C'est là une fraude intellectuelle. L'individu, au lieu de se penser comme un nœud de relations, flotte dans l'isolement (ce qui est techniquement l'affaire des manuels psychiatriques). En conséquence, les valeurs sont considérées comme relevant uniquement de la sphère individuelle, "où il n'y aurait plus le problème de s'accorder éthiquement sur quoi que ce soit". Un point commun éthique devient alors irrationnel. Pire: un fardeau. "Nous ne savons plus comment aimer, croire ou vouloir. Chacun de nous doute de la vérité de ce qu'il dit, sourit de la vérité de ce qu'il affirme et présage de la fin de ce qu'il proclame". Constant a écrit ceci au début du 19ème siècle. C'était vrai alors comme c'est vrai aujourd'hui.
Pour mieux servir le veau d'or, on nourrit un hédonisme de mendiant, qui paie pour profiter du peu de vie accordé par le retour d'impôt. Brocardé et stigmatisé déjà lors de l'essor de la raison libérale, l'homo oeconomicus appartient désormais au passé. Mais cela ne peut pas durer éternellement. La normalité sociale (comprise comme la norme dominante) et la naturalité psychobiologique (l'ensemble des caractéristiques propres à l'espèce humaine) réclament la restauration de leurs canons. Et ils le feront, que ça leur plaise ou non, par la manière forte ou la manière faible. Redevenir humain, et non rester humain, sera la gaie science d'un monde post-libéral.
10:27 Publié dans Actualité, Définitions, Livre, Livre, Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : livre, définition, libéralisme, philosophie, philosophie politique, alessio mannino |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
vendredi, 19 novembre 2021
Le règne de l’homme-masse, une fatalité? (Jose Ortega y Gasset)
17:39 Publié dans Philosophie | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : josé ortega y gasset, espagne, philosophie, philosophie politique |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
jeudi, 18 novembre 2021
Le nouveau capitalisme absolu-totalitaire, enfant de 68
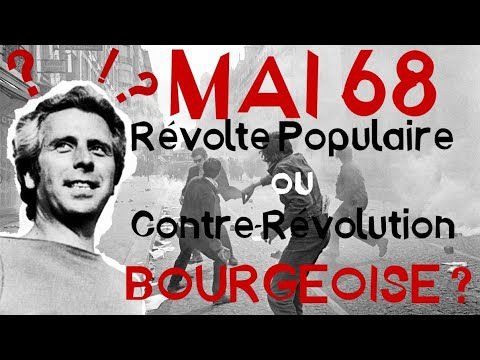
Le nouveau capitalisme absolu-totalitaire, enfant de 68
Diego Fusaro
Ex: https://www.geopolitica.ru/es/article/el-nuevo-capitalismo-absoluto-totalitario-hijo-del-68
Le nouvel esprit du capitalisme est a) totalitaire, car il occupe la réalité matérielle et immatérielle de manière totale et absolue, devenant comme l'air que nous respirons, saturant l'espace du monde (globalisation) et celui de la conscience, avec une colonisation de l'imaginaire, où tout est pensé sous forme de marchandise (dettes et crédits scolaires, location d'utérus, investissements affectifs, etc.). Il est également b) absolu, puisqu'il est désormais parfaitement "complet" (absolutus), c'est-à-dire réalisé dans son propre concept (tout, sans résidu, est devenu une marchandise): et il est parfaitement complet précisément parce qu'il est "libéré" (solutus ab) de toute limitation qui pourrait encore entraver, empêcher ou même ralentir son développement.
Malencontreusement salué comme un processus révolutionnaire d'opposition à l'ordre capitaliste, 1968 - comme le montre L'avenir nous appartient - doit être interprété, de manière diamétralement opposée, comme le mythe de la fondation du turbo-capitalisme: et, plus précisément, comme le point de passage décisif de la phase dialectique à la phase spéculative, et donc comme un moment entièrement inscrit dans la logique dialectique du capitalisme lui-même. En une formule, 1968 marque l'émancipation non pas du capitalisme [dal capitalismo, dans l'original italien], mais du capitalisme lui-même [del capitalismo, dans l'original ; Fusaro joue avec les mots dal et del en italien] : le capitalisme se débarrasse, uno motu, de la conscience bourgeoise malheureuse (remplacée par l'inconscience heureuse du consommateur plus-satisfait) et des luttes pour la reconnaissance du travail servile.
Ces dernières sont remplacées par les nouvelles luttes pour la libéralisation individualiste de la consommation et des mœurs (qui renforcent l'ordre de production au lieu de l'affaiblir) et pour l'économisation des conflits, c'est-à-dire par des luttes qui ne contestent pas le capitalisme, mais qui, en réclamant simplement de meilleures conditions salariales en son sein, l'assument comme un horizon indéfendable. Compris de cette façon, 1968 est le moment génétique du nouveau et terrifiant capitalisme absolu-totalitaire, qui dissout toutes les identités - y compris celle de classe - et produit une masse amorphe de consommateurs qui se rapportent à l'essentiel dans sa totalité sous forme de consommation : c'est le tournant vers l'individualisation post-bourgeoise, post-prolétarienne, ultra-capitaliste d'aujourd'hui.
Les soixante-huitards, en luttant contre la bourgeoisie, sa conscience malheureuse et ses héritages éthiques, ne luttaient pas, du même coup, contre le capitalisme, mais pour lui, si l'on considère qu'il était conforme à la logique même du développement dialectique du capitalisme de détruire à la fois la bourgeoisie et le prolétariat en tant qu'obstacles à l'extension illimitée de la forme marchandise et de ses pathologies. Plus précisément, le mouvement de 1968, en promouvant un ordre politique de type anarchique et libertaire, opposé aux grandes organisations comme intrinsèquement oppressives, a favorisé plutôt que contrarié la genèse de la dérégulation libérale et la nouvelle figure dialectique du capitalisme absolu-totalitaire, par laquelle il a été rapidement réabsorbé. C'était d'ailleurs l'une des nombreuses preuves du fait que, comme Marx le savait déjà, le capital est protéiforme et adaptable, tant que les formes d'extorsion de la plus-value sont garanties.
Le capitalisme surmonte dialectiquement les exigences antagonistes du prolétariat (lutte des classes, esprit de scission, organisations de partis, passion révolutionnaire) et, en même temps, la conscience bourgeoise malheureuse. Cette dernière représente également une contradiction au sein du capitalisme, non moins que les revendications antagonistes et potentiellement révolutionnaires du prolétariat, si l'on considère que la bourgeoisie a) a sa propre vocation universaliste qui peut la conduire - comme dans le cas de Marx - à remettre en cause le monde capitaliste historique dans lequel elle est la classe dominante, et b) dispose d'une sphère de valeurs et d'éthique qui ne peut être marchandisée et qui est donc en définitive incompatible avec les processus d'omni-mercantilisation propres au capitalisme absolu.
La bourgeoisie et le prolétariat, dans leur conflit dialectique, s'étaient développés dans le cadre de l'éthicité (Sittlichkeit) au sens hégélien, c'est-à-dire dans l'espace réel et symbolique des "racines" solides et solidaires de la vie communautaire, liées à la famille et à l'école, au syndicat et à l'État national souverain. Le capitalisme absolu-totalitaire dés-éthicise le monde de la vie, annihilant toute communauté résiduelle autre que celle, intrinsèquement communautaire, de l'éphémère contrepartie marchande : il déconstruit la famille et les syndicats, l'école et l'État national souverain, produisant l'espace ouvert du monde réduit au marché et habité seulement par des consommateurs déracinés et homologués, sans conscience antagoniste prolétarienne et sans conscience malheureuse postmoderne.
Dés-éthicisée, la société devient une simple société de consommation, un marché cosmopolite peuplé non pas de citoyens d'États-nations, de pères et de mères, mais uniquement de concurrents ; des concurrents qui, en l'absence de tout esprit communautaire, n'ont de rapports que sur la base des principes théorisés par la Richesse des nations d'Adam Smith - la dépendance omnilatérale de la nécessité et l'égoïsme acquisitif - par rapport au brasseur, au boucher et au boulanger.
Plus fort maintenant parce qu'il a traversé "l'immense puissance du négatif" de la scission et du conflit révolutionnaire entre la bourgeoisie et le prolétariat, le capitalisme devient un capitalisme absolu-totalitaire: absolu, parce que - comme on l'a dit - il correspond pleinement à son Begriff [concept] ; totalitaire, parce qu'il a subsumé sous lui toutes les sphères de la production, de l'existence et de l'imagination, du réel et du symbolique.
De même, du côté de la production intellectuelle, la "conscience malheureuse" s'est dissoute et, à la place de la classe dialectique de la bourgeoisie, a pris place une classe globale, qui n'est plus bourgeoise mais ultra-capitaliste, encline à accepter avec désinvolture le "polythéisme des valeurs" et les styles de vie à l'intérieur de la "cage d'acier" du monothéisme idolâtre du marché.
Source première: https://avig.mantepsei.it/single/il-nuovo-capitalismo-assoluto-totalitario-figlio-del-68
11:23 Publié dans Actualité, Philosophie, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : capitalisme, globalisme, actualité, philosophie, philosophie politique, théorie politique, mai 68, politologie, diego fusaro, sciences politiques |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mercredi, 17 novembre 2021
L'ère de l'égocratie libérale
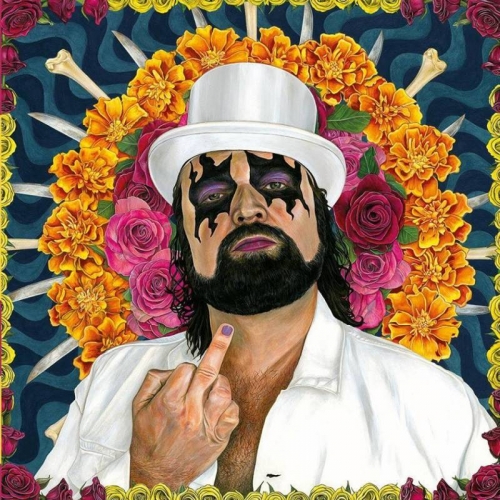
L'ère de l'égocratie libérale
Diego Fusaro
Ex: https://www.geopolitica.ru/es/article/la-epoca-de-la-egocracia-liberale
Selon Adorno, "l'état de choses dans lequel l'individu disparaît est en même temps celui de l'individualisme débridé, dans lequel 'tout est possible'". C'est là que réside le paradoxe souligné par Adorno d'une société qui s'est légitimée sur la base de l'expansion souveraine et libre des individus et qui s'accomplit maintenant dans son anéantissement complet sur l'autel du marché absolu.
Le nôtre se confirme ainsi comme le temps égocratique, l'ère de Narcisse comme paradigme d'un sujet qui se suffit à lui-même et qui ignore l'altérité et l'amour comme ouverture à la différence. C'est la tragédie égoïque, la tragédie de se perdre dans sa propre image, la tragédie du monde réduit à l'image du moi et, encore une fois, de l'affirmation cynique du moi individuel.
Contrairement aux formations communautaires traditionnelles, le marché qui a désormais comblé le vide laissé par Dieu n'encourage pas l'établissement d'identités stables et d'un moi fort. Au contraire, elle doit les déconstruire, de sorte que le soi reste en permanence précaire et instable, manipulable et incapable de dire non, et donc réduit à un soi façonné de temps à autre par les courants et les offres du marché, ainsi que par les flux d'informations gérés par la fabrique du consensus et l'industrie de l'imaginaire.
Le flux héraclitéen de la circulation des marchandises redéfinit la subjectivité humaine dans des formes instables et précaires, inconditionnellement ouvertes à tous les stimuli et à toutes les demandes. Elle détruit toute capacité résiduelle de contestation et donc de résistance aux pressions des consommateurs par des identités dispersées.
Dans la phase absolue, le sujet, réduit à un atome hédoniste de jouissance sans tête et potentiellement illimité, est désormais dépourvu d'esprit critique et de personnalité, délesté de tout lien symbolique autre que le code de la forme marchandise.
Comme l'a démontré Hegel dans ses Esquisses de la philosophie du droit (1821), le fondement de la vie éthique bourgeoise réside précisément dans la stabilité ou, si l'on préfère, dans la consolidation temporaire des formes existentielles, affectives et professionnelles garanties. En particulier, en tant que moment culminant de l'Esprit objectif (qui est lui-même une manifestation sub specie temporis de l'Esprit absolu), l'éthique est, pour Hegel, le dépassement et l'inversion au plus haut niveau de la synthèse du "droit abstrait" (abstraktes Recht) comme moment de la formalité extérieure pure et abstraite et de la "moralité" (Moralität) comme loi de l'intériorité individualisée.
L'homme égoïste, acquisitif, rapace et anti-communautaire n'est pas le fruit de la nature humaine, comme le comprend à tort Hobbes: il est au contraire, pour Hegel, le résultat du processus socio-économique de dé-éternisation du système des besoins ("Je considère l'homme dans son concept, non dans l'état de nature").
La solidarité de classe est désormais remplacée par l'individualisme compétitif, selon ce qu'on a appelé le mythe de l'individu: le salut n'est plus compris comme la libération chorale de la classe du capitalisme, mais comme l'affirmation entrepreneuriale du soi individuel dans les structures capitalistes et au milieu du pillage des autres. Pour cette raison, comme nous ne nous lasserons jamais de le répéter, il est nécessaire de proposer à nouveau sans hésitation le socialisme comme paradigme anthropologique et social, sans jamais oublier que le terme a été introduit par Pierre Leroux avec la claire intention de s'opposer à l'individualisme moderne.
Source première: https://avig.mantepsei.it/single/l-epoca-dell-egocrazia-neoliberale
13:02 Publié dans Actualité, Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philosophie, philosophie politique, libéralisme, diego fusaro |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mardi, 16 novembre 2021
Carl Schmitt en Chine

Carl Schmitt en Chine
Le livre de Jan-Werner Müller, A Dangerous Mind : Carl Schmitt in Post-War European Thought, en traduction chinoise.
par Flora Sapiová
Ex: https://deliandiver.org/2017/08/carl-schmitt-v-cine.html
Les idées de Carl Schmitt (1888-1985), connu sous le nom de "juriste de la couronne du Troisième Reich" (Kronjurist), jouissent d'une immense popularité auprès des intellectuels chinois depuis le début du 21ème siècle. Le travail d'universitaires de premier plan comme Liu Xiaofeng 刘小枫, Gan Yang 甘阳 et Wang Shaoguang 王绍光 sur la diffusion des idées de Schmitt, ainsi que le fait que ses théories sur l'État contribuent à légitimer le régime de parti unique, ont rendu le discours "schmittien" à la fois à la mode et rentable en Chine (les politiques habituellement strictes des censeurs ne touchent que légèrement aux articles et aux livres inspirés par Schmitt).
Schmitt a rejoint le NSDAP en 1933, lorsque Adolf Hitler est devenu chancelier du Troisième Reich, et a participé avec enthousiasme aux purges des Juifs et de l'influence juive dans la vie publique allemande. Antilibéral et antisémite, Schmitt était un ardent partisan d'un gouvernement national-socialiste et aspirait à devenir le théoricien officiel du droit du Troisième Reich. Vers la fin de 1936, cependant, il est accusé d'opportunisme et de récidive catholique dans un article du journal officiel SS Das Schwarze Korps. Malgré la main protectrice de Hermann Göring, il doit renoncer à ses grandes ambitions et se concentrer sur l'écriture et l'enseignement.
Dans le milieu universitaire euro-américain, la vision pragmatique de la politique de Schmitt a été sévèrement critiquée. Les penseurs de gauche sont ambivalents quant à son héritage - en effet, malgré le léger arrière-goût de son passé nazi, il reste populaire parmi les théoriciens universitaires. En dépit des lacunes des idées de Schmitt, ils reconnaissent la perspicacité de son analyse et étudient son œuvre pour sa compréhension des manquements de la politique libérale, qu'ils ne font eux-mêmes que critiquer de manière impuissante depuis les confins confortables et forcés de la Realpolitik gouvernementale contemporaine.
La réception chinoise de la pensée de Schmitt pourrait être décrite comme beaucoup plus simple ; en effet, même Adolf Hitler a joui d'une certaine popularité incontestée en Chine après la mort de Mao. Les théoriciens chinois (continentaux) cherchant à consolider le système de parti unique ont trouvé dans l'œuvre de Schmitt des arguments utiles pour renforcer à la fois le rôle de l'État et la position du chef souverain (ou démiurge chinois) dans le maintien de l'unité et de l'ordre national.
Les disciples intellectuels chinois de Schmitt ont jusqu'à présent quelque peu négligé certains des concepts clés de son œuvre qui conviendraient aux ambitions d'un parti d'État dirigé par le timonier Xi Jinping. Nous pensons ici en particulier aux vues de Schmitt sur le Großraum (Grand Espace) ou la sphère d'influence. Le Großraum de Schmitt - inspiré par son interprétation de la doctrine Monroe promue par les Américains dans le but d'asseoir leur hégémonie sans entrave sur le Nouveau Monde - était destiné à justifier les ambitions de l'Empire allemand en Europe et à légitimer sa domination. Avec l'initiative de la Chine vers la création d'une Communauté de destin partagé 命运共同体 en Asie et dans le Pacifique (voir notre Annuaire 2014 sur ce sujet), la notion de sphères d'influence a retrouvé les faveurs de certains théoriciens des relations internationales. À titre d'exemple, considérons l'analyse de l'Australien Michael Wesley dans Restless Continent : Wealth, Rivalry and Asia's New Geopolitics (Black Inc., 2015).
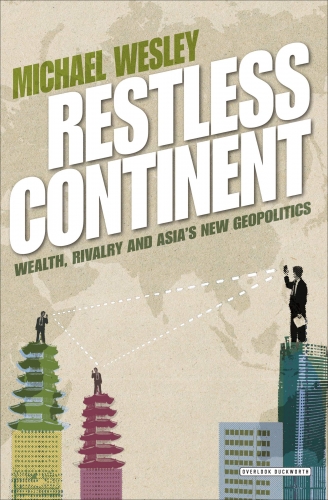
Dans le cadre de son travail au Centre australien sur la Chine dans le monde, vers la fin de l'année, la juriste Flora Sapiovà a organisé un séminaire sur Schmitt en Chine. Elle a eu la gentillesse d'accéder à notre demande et a rédigé l'essai suivant sur cette importante évolution "étatiste" de la culture intellectuelle chinoise pour The China Story.
Flora Sapiovà est chargée de mission au Centre australien pour la Chine et le monde. Ses travaux portent sur le droit pénal et la philosophie du droit. Elle a écrit Sovereign Power and the Law in China (Brill, 2010) ; et a coédité The Politics of Law and Stability in China (Edward Elgar, 2014) ; et Detention and its Reforms in China (Ashgate, 2016) - Éditeurs.
___________________
Nous avons établi la forme idéale (eidos),
que nous considérons comme le but (telos),
et nous le faisons,
afin de les réaliser. (1)
L'intellectuelle schmittienne aime jouer à la roulette russe avec une innovation intéressante : elle croit qu'il y a une balle dans le barillet du revolver, mais elle sait aussi que ce n'est pas forcément le cas. Le seul à connaître réellement la vérité est le Souverain, une figure dont l'intellectuel ne peut percevoir la profondeur de la volonté. Le Souverain décide qui joue le jeu et combien de fois. Si la schmittienne refuse une offre qui ne l'est pas, elle sera déclarée ennemie et abattue. Si l'on considère à quel point ce brouillage intellectuel - maquillé en attitude - oblige à se soumettre à tout moment aux diktats du Souverain, on peut se demander pourquoi plusieurs intellectuels chinois de premier plan ont choisi le professeur Carl Schmitt, le juriste suprême du Troisième Reich, comme saint patron intellectuel.
La poursuite des rêves de richesse et de pouvoir fait partie intégrante de l'histoire et de la vie intellectuelle de la Chine depuis la fin du 19ème siècle. Les rêves de la Chine, qu'il s'agisse de ceux du Mouvement du Quatrième Mai (1919) ou des visions qui ont enflammé l'imagination du chef du Parti, de l'État et de l'armée, Xi Jinping, près d'un siècle plus tard, sont ancrés dans la conviction que la Chine était dotée d'une essence nationale distinctive : 国粹. Elle est à la Chine ce que l'âme est à l'homme. Et tout comme l'homme (religieux) cherche à monter au ciel en cultivant et en purifiant son âme, la Chine ne peut acquérir richesse et puissance que si son essence nationale est renforcée et purifiée des influences polluantes. Le mouvement des Nouvelles Lumières qui a émergé du dégel politique de la fin des années 1970 a accusé le traditionalisme et le féodalisme d'être à l'origine du retard de la Chine. Puis, dans les années 1980, les intellectuels chinois ont réfléchi à la manière de faire revivre le véritable caractère national de la Chine. Beaucoup voyaient la solution dans l'utilisation éclectique des valeurs, des théories et des modèles occidentaux (2). Après le massacre de Pékin en 1989, cependant, la fortune du mouvement s'est détournée et le sentiment nationaliste, en partie encouragé par l'État et en partie suscité par une réaction aux inégalités de la réforme du marché, a prévalu dans les années 1990. La réaction du public aux événements extérieurs a également joué un rôle.
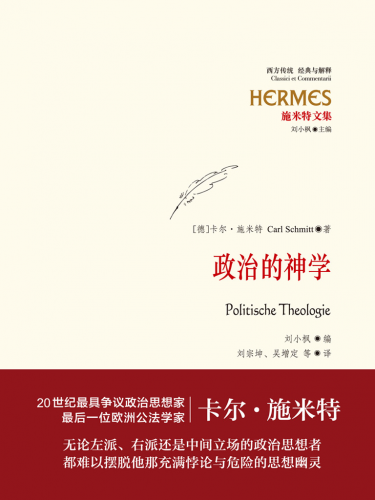
Comment distinguer un ami d'un ennemi
C'est dans le contexte de ces changements et développements rapides que nous devons donc évaluer l'obsession de la Chine pour Carl Schmitt (3). La réception de Carl Schmitt par les intellectuels chinois, dont beaucoup sont des membres influents de la Nouvelle Gauche, n'a été possible que grâce au travail acharné de l'influent universitaire Liu Xiaofeng 刘小枫 (qui enseigne à l'Université Renmin de Pékin), qui a traduit, commenté et promu les œuvres rassemblées de Schmitt. Titulaire d'un doctorat en théologie de l'université de Bâle, sa thèse préconisait de séparer le christianisme de ses dimensions "occidentales" et ecclésiastiques, afin que la pensée chrétienne puisse être traitée uniquement comme un objet de recherche universitaire. Ainsi conçue, la pensée chrétienne pourrait alors entrer en dialogue avec d'autres disciplines et contribuer, entre autres, à la modernisation de la société chinoise. Liu compare le développement du christianisme au développement des nations et de leur identité, en s'inspirant largement de Max Weber et de ses thèses dans Protestant Ethics and the Spirit of Capitalism, dont la traduction chinoise était à la fois très lue et influente dans les cercles intellectuels chinois dans les années 1980.
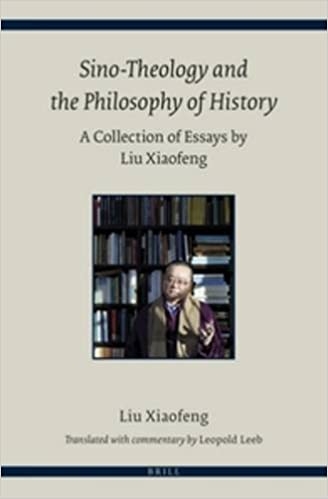 Selon Liu, le christianisme s'est implanté en Chine sous une forme unique, indépendamment des efforts d'évangélisation des missionnaires occidentaux. Les débuts de la théologie chrétienne ont ainsi permis le développement d'un discours sino-chrétien visant à résoudre les "problèmes de la Chine" (4), en abordant des questions telles que le développement économique, la justice sociale, la stabilité et, surtout, la légitimité politique du gouvernement du Parti communiste.
Selon Liu, le christianisme s'est implanté en Chine sous une forme unique, indépendamment des efforts d'évangélisation des missionnaires occidentaux. Les débuts de la théologie chrétienne ont ainsi permis le développement d'un discours sino-chrétien visant à résoudre les "problèmes de la Chine" (4), en abordant des questions telles que le développement économique, la justice sociale, la stabilité et, surtout, la légitimité politique du gouvernement du Parti communiste.
Liu se décrit comme un "chrétien culturel", c'est-à-dire un chrétien sans affiliation religieuse : un chrétien qui étudie les arguments et les concepts théologiques pour le bien-être de sa nation. Avec une telle approche de la recherche, il n'est pas surprenant que Liu ait rapidement trouvé un penchant pour Carl Schmitt. Car selon lui, l'État a une origine théologique et doit être traité comme une entité de type divin s'il veut réussir à contenir le chaos et le désordre et assurer la sécurité et la prospérité du peuple. Schmitt suggère également que tous les concepts politiques modernes sont, au fond, enracinés dans la théologie. Le revers de la médaille est donc la possibilité de travailler avec la théologie comme une forme d'art politique (5). Liu a accepté très ouvertement les idées schmittiennes dès le début. Nous devrions également nous arrêter sur la facilité avec laquelle l'œuvre de Schmitt a trouvé un public enthousiaste en Chine. Contrairement au segment du monde intellectuel chinois qui s'inspire des modèles démocratiques libéraux occidentaux et qui, jusqu'à ce jour, souffre souvent de l'intervention de la censure, les partisans du clivage ami-ennemi de Schmitt et de sa critique de la démocratie parlementaire n'ont pas eu à faire face à des problèmes similaires.
En tant que catholique conservateur, Schmitt comprenait la politique (qu'il appelait, pour tenter d'en saisir l'essence, "le politique") comme étant ancrée dans la distinction ami/ennemi. Parmi les intellectuels chinois qui ont grandi entourés de la rhétorique marxiste (6), et donc familiers avec l'utilisation de la dyade ami-ennemi 敌我 aux fins de la politique post-maoïste (7), cette distinction fondamentale de Schmitt a eu une forte résonance. En effet, elle peut être utilisée pour délimiter n'importe quelle paire d'adversaires dès lors que l'on peut démontrer que les valeurs des deux parties sont si incommensurables qu'elles les amènent à tenter de détruire leur adversaire dans le but de préserver leur propre identité.
La distinction ami/ennemi est au cœur de la théorie politique et constitutionnelle de Schmitt, et elle est également à la base de sa critique de la démocratie parlementaire et des idées d'"état d'exception" et de souveraineté. Il a cherché à montrer que les démocraties libérales étaient piégées dans leurs fausses catégories politiques: en ignorant la distinction fondamentale entre ami et ennemi, elles risquaient de devenir des instruments de protection des intérêts de riches individus et de cliques qui utiliseraient ensuite l'État pour servir leurs propres intérêts au détriment du bien-être général. Selon Schmitt, les sociétés libérales font comme si le gouvernement et la nation étaient soumis aux diktats de normes juridiques fiables - mais ce faux-semblant se dissipe rapidement dès qu'un ennemi extérieur ou intérieur menace la nation et sa sécurité. Par conséquent, selon Schmitt, une dépendance excessive à l'égard des débats parlementaires et des procédures juridiques peut mettre le pays en danger de chaos en empêchant une action efficace et immédiate en réponse à une crise.
Selon Schmitt, la souveraineté ne réside pas dans l'État de droit, mais dans une personne ou une institution qui a le pouvoir de suspendre la loi afin de rétablir la normalité lorsqu'une crise grave éclate. Ainsi, un souverain ayant le pouvoir de déclarer l'état d'urgence (Ausnahmezustand) jouit d'une légitimité incontestable, qu'elle soit inscrite ici explicitement (c'est-à-dire dans la constitution) ou implicitement. Mais comment un pouvoir souverain opérant en dehors et au-dessus de la loi peut-il bénéficier d'une légitimité ? Ce pouvoir ne serait-il pas auto-renforcé et basé sur la violence pure ? Schmitt répond que la légitimité d'un tel pouvoir peut être défendue avec succès si l'on sépare les concepts de libéralisme et de démocratie. Pour lui, elles sont loin d'être identiques, et Schmitt décide d'élaborer sa propre définition de la démocratie.
Pour lui, un système politique basé sur l'opinion inconstante du peuple peut difficilement être légitime. Il a donc fait appel aux idées d'égalité et de volonté populaire (8). Pour Schmitt, l'égalité politique signifie une relation de "co-égalité" entre le gouvernant et le gouverné. Tant que les uns et les autres appartenaient au même groupe - ou étaient "amis" - avec une vision identique de l'ennemi, l'arrangement politique restait démocratique. Lorsque la volonté de la nation se reflétait dans les décisions du dirigeant, le peuple gouvernait selon cette métrique schmittienne. La volonté du peuple, ainsi conçue, n'avait pas besoin d'être façonnée ou exprimée par le suffrage universel: les demandes formulées en assemblée publique pour traduire la volonté du peuple étaient un instrument suffisamment efficace (9).
La définition éclectique que Schmitt donne de la volonté du peuple l'amène à considérer la démocratie comme une dictature démocratique. Cette façon de penser a fortement impressionné les intellectuels qui privilégiaient les solutions étatistes et nationalistes aux questions et problèmes politiques et internationaux (10).
Pourquoi Schmitt ?
Les raisons de la fascination des intellectuels chinois pour Carl Schmitt sont assez simples et directes. Les concepts interdépendants de "(la) division entre ami et ennemi", d'"état d'urgence" et de "décisionnisme" sont simples et exploitables. Ainsi, les concepteurs de programmes et leurs conseillers peuvent facilement les utiliser pour analyser la situation. Le langage de Schmitt peut également fournir un soutien théorique aux propositions de réforme, devenir une source d'inspiration ou fournir des briques imaginaires dans la construction d'arguments pro-étatiques dans les sciences politiques et les études constitutionnelles. En outre, la division schmittienne entre ami et ennemi complète et justifie bon nombre des interprétations nationalistes et exceptionnalistes de la culture qui ont récemment gagné en influence parmi les intellectuels chinois. S'il ne s'agit pas, bien sûr, d'un phénomène uniquement chinois, n'oublions pas non plus qu'ils contrastent fortement avec les aspects universalistes et internationalistes de la doctrine d'État du communisme chinois. L'argument central des schmittiens chinois est que le monde n'est pas une unité politiquement homogène, mais un plurivers dans lequel des systèmes politiques radicalement différents existent côte à côte dans une relation antagoniste. La Chine a donc non seulement le droit de suivre sa propre voie vers la puissance et la prospérité, mais elle doit surtout la trouver et la défendre.
Ce raisonnement des schmittiens chinois justifie la position de l'État-parti selon laquelle la démocratie parlementaire occidentale, une forme robuste d'État de droit, la société civile ou les valeurs et institutions du constitutionnalisme occidental ne conviennent pas à la Chine. Les thèses de Schmitt permettent aux partisans de ces positions d'affirmer que ces idées appartiennent à un cosmopolitisme libéral "étranger", finalement nuisible au mode de vie chinois. En 2013, un règlement d'État appelé "Document 9" a identifié ces idées comme une menace sérieuse pour le "domaine idéologique" de la Chine (11).
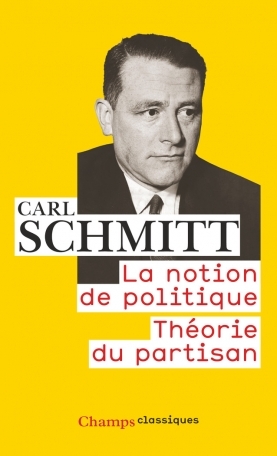 Les idées de Carl Schmitt ont gagné en influence parmi les intellectuels chinois et il est souvent cité comme une autorité étrangère pour s'opposer au "libéralisme" et aux modèles occidentaux ou américains de développement économique et politique. Dans le discours intellectuel chinois, cependant, vous n'entendrez jamais la philosophie de Schmitt fondée sur le principe de la politique comme exclusion et même élimination physique de l'ennemi (si cela était jugé nécessaire pour atteindre un objectif idéologique). La distinction entre ami et ennemi encourage une forme implacable de pensée binaire. On a beau essayer de définir la catégorie de l'ami, il y a toujours une projection de son contraire. "Ami" prend un sens par la reconnaissance de ce que signifie "ennemi". On peut utiliser, comme Schmitt lui-même l'a souligné, toutes sortes de caractéristiques pour définir un "ami" : la religion, la langue, l'ethnicité, la culture, le statut social, l'idéologie, le sexe, et en fait tout ce qui peut devenir un élément essentiel d'une distinction donnée entre ami et ennemi.
Les idées de Carl Schmitt ont gagné en influence parmi les intellectuels chinois et il est souvent cité comme une autorité étrangère pour s'opposer au "libéralisme" et aux modèles occidentaux ou américains de développement économique et politique. Dans le discours intellectuel chinois, cependant, vous n'entendrez jamais la philosophie de Schmitt fondée sur le principe de la politique comme exclusion et même élimination physique de l'ennemi (si cela était jugé nécessaire pour atteindre un objectif idéologique). La distinction entre ami et ennemi encourage une forme implacable de pensée binaire. On a beau essayer de définir la catégorie de l'ami, il y a toujours une projection de son contraire. "Ami" prend un sens par la reconnaissance de ce que signifie "ennemi". On peut utiliser, comme Schmitt lui-même l'a souligné, toutes sortes de caractéristiques pour définir un "ami" : la religion, la langue, l'ethnicité, la culture, le statut social, l'idéologie, le sexe, et en fait tout ce qui peut devenir un élément essentiel d'une distinction donnée entre ami et ennemi.
La distinction ami/ennemi est une distinction publique : elle parle d'amitié et d'hostilité entre des groupes, et non des individus. (Il est toujours possible d'admirer en privé un membre d'un groupe ennemi). La délimitation de l'identité est toutefois assez souple, car une communauté politique se forme par l'identification partagée d'une menace présumée (13). En d'autres termes, une communauté n'acquiert un sens au sens d'un groupe membre (in-group) qu'en distinguant "ceux qui se tiennent à l'extérieur". De cette façon, la manière schmittienne de définir "le peuple" évite la nécessité d'une délimitation ou d'une définition juridique. "Le peuple" en tant que communauté politique au sens schmittien se préoccupe avant tout de savoir si une autre communauté politique (ou des individus capables de former une telle communauté) constitue une menace pour son propre mode de vie. Pour Schmitt, le clivage ami-ennemi est un clivage purement politique, et doit donc être entièrement dissocié de l'éthique (14). Puisque la préoccupation première est la survie du "groupe membre" en tant que "peuple" et communauté politique, les thèses de Schmitt suggèrent la possibilité de justifier l'élimination de l'ennemi comme une nécessité pratique (15). Les personnes qui se définissent comme des intellectuels schmittiens devraient donc noter que les arguments de Schmitt sont construits sur la notion de nécessité. Tant qu'il y a une cause qui doit être défendue, n'importe quel nombre de morts peut être justifié.
De plus, cette nécessité est fondée sur l'antagonisme. Toutes les idées de Schmitt sur la politique et le constitutionnalisme sont basées sur la division entre ami et ennemi. Mais c'est précisément la raison pour laquelle nombre des analyses les plus utiles de la politique et du constitutionnalisme chinois ont émergé de ses concepts. La vision de Schmitt du souverain, qui doit avoir la liberté d'intervenir à volonté pour le bien de l'ensemble du pays, correspond au "courant intellectuel étatiste" 国家主义思潮 dans le discours chinois, dont Wang Shan 王山 et Wang Xiaodong 王小东 ont été et restent les principaux représentants...
Ce mouvement a contribué à l'élaboration de l'argument autour de la signification de la "capacité de l'État". Dans leur ouvrage influent de 2001, les politologues Wang Shaoguang 王绍光 et Hu Angang 胡鞍钢 ont identifié la "capacité de l'État" comme la clé de la bonne gouvernance et de la politique. Ils ont critiqué les processus de décision démocratiques en mettant en évidence leurs concomitants défavorables. En effet, selon eux, ils s'accompagnent inévitablement de débats interminables qui entraînent des retards dans la mise en œuvre des mesures nécessaires, voire une paralysie politique et institutionnelle. Ils considèrent que la "capacité de l'État à mettre en œuvre sa volonté" est essentielle pour protéger le bien-être de la nation (16). Depuis lors, la défense de la "capacité de l'État" et de ses suppléments corollaires de contrôle social et de légitimité basée sur la performance comme alternative viable à la démocratie parlementaire est apparue dans de nombreuses publications universitaires chinoises.
Idées utiles et citables
Dans un ouvrage intitulé de manière provocante Quatre chapitres sur la démocratie (17), Wang Shaoguang rend un hommage tacite aux Quatre chapitres sur la doctrine de la souveraineté de Schmitt. Comme le juriste allemand, Wang rejette la démocratie représentative pour des raisons utilitaires et pragmatiques, affirmant que le système ne parvient pas à élever le niveau de bien-être de l'ensemble de la population. Dans l'esprit des arguments de Schmitt sur l'abus du parlementarisme par les groupes d'intérêt, Wang soutient que le suffrage universel fait le jeu des riches tout en poussant les pauvres dans le rôle de spectateurs passifs.
Wang avance également la notion de "peuple", basée sur la pensée de Schmitt, comme base de la démocratie responsable (responsive), puisque, selon lui, les pays ayant une grande capacité d'assimilation et de gouvernance (c'est-à-dire une nation unie sous un leader fort) ont également une meilleure qualité de démocratie. Une partie de la terminologie de Wang est basée sur le travail du théoricien politique démocratique Robert Dahl, mais le raisonnement soutenant la notion de démocratie responsable de Wang est similaire à celui de Schmitt (18).
L'argument de la "capacité de l'État" avancé par Wang, Hu et d'autres a été examiné de près par les sinologues occidentaux contemporains pendant plus d'une décennie. Il est régulièrement cité dans les publications universitaires sur l'économie chinoise, l'économie politique et l'administration publique.
Dans nombre de ces publications (en anglais et dans d'autres langues européennes), les auteurs attribuent à la doctrine de la "capacité de l'État" le mérite d'avoir permis à l'État chinois de prendre des mesures plus efficaces pour accélérer le développement économique du pays. La preuve de la réussite économique de la Chine a ensuite encouragé un certain nombre d'universitaires à aller jusqu'à déclarer que les gouvernements autoritaires peuvent atteindre la croissance économique avec une plus grande efficacité que les gouvernements démocratiques libéraux. Étonnamment, certaines de ces personnes sont également, selon leurs propres termes, "favorables à la transformation de la Chine en une société plus ouverte, fondée sur l'État de droit et les droits de l'homme" (19). Si, par société "plus ouverte", ils entendent plus de liberté dans le sens de la démocratie libérale, alors cet objectif est en contradiction avec leur argument selon lequel le système chinois de parti unique (communiste) doit être renforcé par une série de mesures (étatiques) de renforcement de ses capacités.
Les thèses de Schmitt ont également eu une influence non négligeable sur la théorie constitutionnelle chinoise. Après Mao, l'État à parti unique avait besoin - et dans une certaine mesure a toujours besoin - d'une ontologie politique typiquement chinoise. Cette façon de conceptualiser et de comprendre le monde doit impliquer un système politique bipartite (bipartisan) dans lequel un vaste appareil de parti existe à la fois à l'intérieur et à l'extérieur des normes juridiques et exerce son pouvoir souverain sur l'État. En outre, ce système d'État-parti doit être cohérent sur le plan interne: il doit être capable de s'auto-préserver dans la mesure où il ne perd pas sa légitimité aux yeux de la nation chinoise et à l'étranger. Les juristes chinois tels que Qiang Shigong 強世功, qui considèrent le droit constitutionnel dans cette perspective, ont commencé dans la première décennie de ce siècle à utiliser tout l'arsenal de la philosophie schmittienne pour défendre leurs vues. Le résultat a été la trinité des concepts d'"état d'exception", de "pouvoir constituant et constitué" et de "représentation politique par consensus général" (représentés par les termes "État, mouvement et peuple" utilisés par Schmitt dans son ouvrage de 1933, Staat, Bewegung, Volk), que ce courant d'universitaires a exaltés comme la véritable essence du droit chinois.
Dans le cas des citations directes, l'influence de Schmitt n'est pas contestée, mais certains intellectuels comme Cui Zhiyuan 崔之元 s'inspirent implicitement de ses idées dans leur théorisation de la politique et de la gouvernance chinoises. En effet, son influence peut être discernée assez clairement dans la perception de Cui de la Chine comme un "système constitutionnel mixte" de "trois niveaux politiques" (20). De même, la conception de Chen Ruihong 陈瑞洪 de "l'inconstitutionnalité vertueuse" (21); Han Yuhai 韩毓海 et sa doctrine du "constitutionnalisme dans un État prolétarien" (22); Hu Angang 胡鞍钢 rebaptisant le Politburo en "présidence collective" (23) ou le modèle 强世功 de Qiang Shigong de "souveraineté partagée sous la direction de l'État-parti" (24) peuvent être décrites comme les thèses phares des deux dernières décennies, basées sur la pensée de Schmitt. Bien que ces théories appartiennent à différents domaines de la recherche constitutionnelle chinoise (25), elles revêtent toutes uniformément le souverain schmittien dans l'habit de l'État-parti chinois. Plus précisément, chacune de ces théories défend la notion de représentation politique en liant le consensus à l'acceptation générale des diktats du parti étatique. D'une manière ou d'une autre, ils qualifient aussi uniformément "l'Occident" et ses institutions politiques et juridiques d'inappropriés pour la Chine.
La recherche juridique occidentale n'a pas encore abordé en profondeur ces arguments influents ou leurs implications juridiques et politiques. Mais certains chercheurs suggèrent que ces thèses pourraient être pertinentes pour la Chine. Par exemple, Randall Pereenboom a produit une analyse utile du système juridique chinois en tant que plurivers de différentes conceptions de l'état de droit (26). Michael Dowdle, issu des positions de la Nouvelle Gauche, soutient que la conception libérale du constitutionnalisme a des limites au-delà desquelles il est possible de légitimer l'Etat par d'autres moyens (27). Larry Catà Backer, quant à lui, a avancé l'idée que le Parti et l'Etat constituent une entité unitaire. Inspirée par les réalités des institutions chinoises, cette construction théorique permet un lien shuanggui 双规 juridiquement justifiable (28). D'une certaine manière, ces œuvres peuvent aussi être comprises comme une façon de verser du sel sur les blessures de nos propres contradictions. Si nous pouvons critiquer le système juridique chinois pour défendre un modèle idéalisé du système juridique occidental, nous ne pouvons pas éviter le droit chinois tel qu'il est débattu et tel qu'il existe en République populaire de Chine.
Certains intellectuels chinois ont remarqué que si leurs compatriotes aiment bien s'en prendre à l'Occident, ils ne comprennent plus pourquoi ils s'appuient sur un penseur politique allemand pour le faire (29). Si cette critique est valable, elle ne tient pas compte d'un problème plus général: les partisans des modèles et des concepts indigènes, les défenseurs de la "troisième voie" et les libéraux de type occidental ont tous refusé jusqu'à présent d'aborder leur propre préférence pour une logique qui appartient à la métaphysique occidentale plutôt qu'à la pensée chinoise indigène (le confucianisme ou d'autres formes de pensée dérivées de sources préchinoises). Selon cette logique occidentale, il faut créer un modèle idéal de la forme d'un système politique ou juridique, d'une société, ou même de toute autre chose, puis essayer de "faire entrer" la réalité dans ce modèle, souvent sans trop se soucier des conséquences.
D'une manière ou d'une autre, nous assistons, dans la recherche juridique chinoise, à la montée en puissance des concepts schmittiens par rapport aux concepts libéraux. Des modérés politiques comme He Baogang 何包钢 (30) ont tenté de concilier les arguments des deux camps en proposant, par exemple, que la Cour constitutionnelle ait le pouvoir de décider de ce qui constitue l'"état d'exception" qui sous-tend l'autorité absolue du souverain schmittien. Ces efforts, cependant, ne font qu'illustrer la faiblesse des positions libérales par rapport aux positions schmittiennes. Le professeur He illustre ainsi le dilemme et la difficulté de la tâche de ceux qui tentent de concilier des éléments du modèle démocratique libéral (comme l'indépendance de la branche judiciaire du gouvernement) avec les concessions de la formule ami-ennemi de Schmitt.

Schmitt et Xi
Depuis l'accession de Xi Jinping au poste de chef suprême de l'État en novembre 2012, la distinction ami-ennemi si centrale dans la philosophie de Carl Schmitt a pris une importance accrue en Chine, tant dans la "théorie du parti" que dans la vie académique. La reprise sélective de la rhétorique de combat maoïste dans l'introduction de la nouvelle campagne d'éducation de masse le 18 juin 2013 peut nous servir de bon exemple de l'adaptation de la distinction ami-ennemi aux conditions du régime actuel de parti unique.
Pour voir les conséquences de la pensée de Schmitt, il ne faut pas oublier les raisons pour lesquelles il a mis l'accent sur la distinction ami-ennemi et la souveraineté absolue. Schmitt pensait que sa théorie garantirait le plus grand bien. Nous pouvons à juste titre qualifier sa philosophie de théologie politique, car elle était fondée sur le concept biblique de katekhon (du grec τὸ κατέχον, "ce qui retient" ou ὁ κατέχων "celui qui retient"), la puissance qui retient la venue de l'Antéchrist (31). Schmitt a fait entrer le katekhon dans le registre politique lorsqu'il l'a défini comme le pouvoir qui maintient le statu quo (32). Il peut être exercé par une institution (par exemple, un État-nation) ou par un souverain (qu'il s'agisse d'un dictateur ou d'un défenseur de la constitution). L'aboutissement logique de la croyance de Schmitt dans le katekhon était la fusion des idées religieuses et politiques. Pour lui, les forces opposées à une souveraineté donnée ne sont donc rien d'autre que des agents du mal et des ennemis qui sèment les graines du chaos et de la perturbation. Protéger sa propre nation ou son propre souverain est donc devenu un devoir sacré et une voie de salut.
Nous pouvons être fondamentalement en désaccord avec les intellectuels chinois qui ont adopté une vision schmittienne du monde. Mais si nous voulons défendre le pluralisme intellectuel, nous devons accepter la liberté des personnes de choisir leur propre perspective. Par conséquent, la montée du discours schmittien chinois dans le monde universitaire élargit en fait la portée des arguments d'inspiration schmittienne des universitaires de gauche et de droite américains et européens.
Ajoutons qu'en Chine, comme ailleurs, les distinctions politiques entre la gauche et la droite ou entre la nouvelle gauche et les libéraux émergent et restent pour la plupart prisonnières d'un milieu partagé que l'on pourrait appeler, avec Schmitt, un paradigme politico-théologique commun. Les différences politiques ont un sens dans un environnement commun dans lequel les personnes acquièrent et développent leurs schémas mentaux, leur vocabulaire politique et tout l'univers des concepts nécessaires à la pensée politique. Grâce au paradigme politico-théologique du parti unique en République populaire de Chine, les intellectuels chinois doivent s'accrocher bon gré mal gré aux schémas mentaux, au vocabulaire et aux concepts que cet environnement a permis de faire émerger. Mais nous devons nous rappeler que les idées occidentales doivent également s'y adapter.
Le fait de vivre dans un pays qui a connu une forte augmentation de sa richesse matérielle et de sa puissance mondiale au cours des trois dernières décennies a conduit les intellectuels schmittiens en Chine à l'idée de combiner une philosophie dont les origines et le développement remontent à l'Allemagne de l'entre-deux-guerres avec les idées d'État qui ont commencé à se répandre en Chine dans les années 1980. Ce mélange de pensée schmittienne et d'"étatisme" est aujourd'hui très influent dans les cercles universitaires chinois, même si peu d'entre eux semblent s'inquiéter du potentiel destructeur de la philosophie de Schmitt.
Notes :
(1) François Jullien, Traité de l'efficacité : entre pensée occidentale et pensée chinoise, Honolulu : University of Hawai'i Press, 2004, p. 1.
(2) Sur le mouvement des Nouvelles Lumières, voir Xu Jilin, "The Fate of an Enlightenment - Twenty Years in the Chinese Intellectual Sphere (1978-1998)", dans Geremie R Barmé et Gloria Davies, East Asian History, no 20 (2000) : pp 169-186. De manière plus générale et critique, voir Zhang Xudong, ed, Whither China : Intellectual Politics in Contemporary China, Durham : Duke University Press, 2001, partie 1.
(3) L'étude de la philosophie européenne n'était pas une priorité du neuvième plan quinquennal de recherche en sciences sociales et en philosophie 国家哲学社会科学研究九五规划重大课题, qui couvrait la période 1996-2000 ; et le premier livre de Liu sur Carl Schmit, une critique de Carl Schmitt and Authoritarian Liberalism de Renato Cristi, date de 1997. Voir Liu Xiaofeng 刘小枫, 'Shimite gushide youpai jiangfa : quanwei ziyouzhyi?' 施米特故事的右派讲法: 权威自由主义 ? , 28 septembre 2005, en ligne : http://www.aisixiang.com/data/8911.html. Sur le neuvième plan quinquennal, voir Guojia Zhexue Shehui Kexue Yanjiu Jiuwu (1996-2000) Guihua Bangongshi 国家哲学社会科学研究九五 规划办公室, Guojia Zhexue Shehui Kexue Yanjiu Jiuwu (1996-2000) Guihua 国家哲学社会科学研究九五 (1996-2000) 规划, Beijing 北京 : Xuexi chubanshe 学习出版社, 1997.
(4) Liu Xiaofeng 刘小枫, 'Xiandai yujing zhongde hanyu jidu shenxue' 现代语境中的汉语基督神学, 2 avril 2010, en ligne : http://www.aisixiang.com/data/32790.html. Sur la théologie sino-chrétienne, voir également Yang Huiling et Daniel HN Yeung, eds, Sino-Christian Studies in China, Newcastle : Cambridge Scholars Press, 2006 ; Pan-chiu Lai et Jason Lam, eds, Sino-Christian Theology : A Theological Qua Cultural Movement in Contemporary China, Frankfurt am Main : Peter Lang, 2010 ; et Alexander Chow, Theosis, Sino-Christian Theology and the Second Chinese Enlightenment : Heaven and Humanity in Unity, New York : Peter Lang, 2013. Pour un commentaire du courant dominant sur l'influence de Carl Schmitt en Chine, voir Mark Lilla, " Reading Strauss in Beijing ", The New Republic, 17 décembre 2010, en ligne : http://www.newrepublic.com/article/magazine/79747/reading-leo-strauss-in-beijing-china-marx.
(5) Carl Schmitt, Théologie politique : quatre chapitres sur le concept de souveraineté, trans. George Schwab, Chicago : University of Chicago Press, 2005 p. 36.
(6) Mao Tse-tung, "On the Correct Handling of Contradictions Among the People", Selected Works of Chairman Mao Tsetung, Volume 5, édité par le Comité d'édition et de publication des œuvres du président Mao Tsetung, Comité central du Parti communiste chinois, Beijing : Foreign Language Press, 1977, pp. 348-421.
(7) Pour une discussion de son utilisation dans le domaine de la politique de sécurité, voir Michael Dutton, Policing Chinese Politics : A History, Durham : Duke University Press, 2005.
(8) Carl Schmitt, Dictature : de l'origine du concept moderne de souveraineté à la lutte des classes prolétarienne, trad. Michael Hoelzl et Graham Ward, Cambridge : Polity Press, 2014.
(9) Carl Schmitt, La crise de la démocratie parlementaire, trans. Ellen Kennedy, Cambridge et Londres : MIT Press, 2000 ; et Carl Schmitt, Constitutional Theory, trans. Jeffrey Seitzer, Durham : Duke University Press, 2008.
(10) Sur les tendances intellectuelles étatistes et nationalistes, voir Xu Jilin 许纪霖, " Jin shinianlai Zhongguo guojiazhuyi sichaozhi pipan " 近十年来中国国家主义思潮之批判, 5 juillet 2011, en ligne : http://www.aisixiang.com/data/41945.html.
(11) "Communiqué sur l'état actuel de la sphère idéologique". A Notice from the Central Committee of the Communist Party of China's General Office", en ligne : http://www.chinafile.com/document-9-chinafile-translation.
(12) Comme la relation d'agonisme, où l'ennemi schmittien devient l'adversaire. Dans ce contexte, voir Chantal Mouffe, "On the Political. Londres et New York : Routledge, 2005.
(13) Carl Schmitt, Le concept du politique.
(14) Schmitt, Le concept du politique.
(15) Schmitt, Le concept du politique.
(16) Wang et Hu entendent par là : "le rapport entre le degré réel d'intervention que l'État est capable d'entreprendre et le degré d'intervention que l'État espère atteindre. Voir Wang Shaoguang et Hu Angang, The Chinese Economy in Crisis : State Capacity and Tax Reform, New York : ME Sharpe, 2001, p. 190.
(17) Wang Shaoguang 王绍光, Minzhu sijiang 民主四讲, Beijing 北京 : Sanlian shudian 三联书店, 2008.
(18) Wang Shaoguang, 'The Problem of State Weakness', Journal of Democracy 14.1 (2003) : 36-42. Par le même auteur, voir "Democracy and State Effectiveness", dans Natalia Dinello et Vladimir Popov, eds, Political Institutions and Development : failed expectations and renewal hopes, Londres : Edward Elgar, 2007, pp.140-167.
(19) "Dialogue UE-Chine sur les droits de l'homme", disponible en ligne à l'adresse suivante : http://eeas.europa.eu/delegations/china/eu_china/political_relations/humain_rights_dialogue/index_en.htm.
(20) Cui Zhiyuan 崔之元, "A Mixed Constitution and a Tri-level Analysis of Chinese Politics" 混合宪法与对中国政治的三层分析, 25 mars 2008, en ligne à l'adresse : http://www.aisixiang.com/data/18117.html.
(21) Chen Ruihong 陈瑞洪, 'Une coupe du monde pour les études de droit constitutionnel : A Dialogue between Political and Constitutional Scholars on Constitutional Power' 宪法学的知识界碑 - 政治学者和宪法学者关于制宪权的对话, 5 octobre 2010, en ligne : http://www. aisixiang.com/data/36400.html ; et aussi Xianfa yu zhuquan 宪法与主权, Beijing 北京 : Falü chubanshe 法律出版社, 2007.
(22) Han Yuhai 韩毓海, " La Constitution et l'État prolétarien " 宪政与无产阶级国家 en ligne.
(23) Hu Angang, La présidence collective de la Chine, New York : Springer, 2014.
(24) Qiang Shigong 强世功, "The Unwritten Constitution in China's Constitution" 中国宪法中的不成文宪法, 19 juin 2010, en ligne : http://www.aisixiang.com/data/related-34372.html.
(25) Voir également le numéro spécial "The Basis for the Legitimacy of the Chinese Political System : Whence and Whither ? Dialogues entre universitaires occidentaux et chinois VII', Chine moderne, vol. 40, n° 2 (mars 2014).
(26) Randall Peerenboom, China's Long March Towards the Rule of Law, Cambridge : Cambridge University Press, 2002.
(27) Michael Dowdle, " Constitutional Listening ", Chicago Kent Law Review, vol. 88, no 1, (2012-2013) : p. 115-156.
(28) Larry Catá Backer et Keren Wang, " The Emerging Structures of Socialist Constitutionalism with Chinese Characteristics : Extra Judicial Detention (Laojiao and Shuanggui) and the Chinese Constitutional Order ", Pacific Rim Law and Policy Journal, vol. 23, no. 2 (2014) : pp. 251-341.
(29) Liu Yu 刘瑜, 'Have you read your Schmitt today?' 你今天施密特了吗?, Caijing, 30 août 2010, en ligne : https://web.archive.org/web/20170725205823/http://blog.caijing.com.cn:80/expert_article-151338-10488.shtml option=com_content&view=article&id=189:2010-10-08-21-43-05&catid=29:works&Itemid=69&lang=fr
(30) He Baogang 何包钢, 'In Defence of Procedure : a liberal's critique of Carl Schmitt's theory of exception' 保卫程序 一个自由主义者对卡尔施密特例外理论的批评, 26 décembre 2003, en ligne :
(31) Nouveau Testament 2, Thessaloniciens 2 : 3-8 : Ne vous laissez tromper par personne, car cela n'arrivera pas avant qu'il y ait rébellion contre Dieu et que l'homme de l'illégalité, le Fils de la Perdition, apparaisse. Il résistera et s'élèvera au-dessus de tout ce qui porte le nom de Dieu ou à qui l'honneur divin est rendu. Il s'assiéra même dans le temple de Dieu et prétendra être Dieu. Tu ne te souviens pas que je t'ai dit ça quand j'étais avec toi ? Vous savez ce qui l'empêche d'apparaître avant son heure. Cette iniquité est déjà à l'œuvre, mais seulement en secret, jusqu'à ce que celui qui l'entrave soit écarté du chemin.
(32) Pour une illustration simple, voir Gopal Balakrishnan, The Enemy : An Intellectual Portrait of Carl Schmitt, London : Verso, 2002, ch. 17. Pour un résumé du débat sur le rôle du kathechon et la généalogie de la conception de Schmitt en matière de théologie politique, voir Julia Hell, 'Katechon : Carl Schmitt's Imperial Theology and the Ruins of the Future', The Germanic Review, vol. 84, no. 4, (2009) : pp. 283-325.
La réflexion de Flora Sapiovà, Carl Schmitt en Chine, a été publiée sur The China Story le 7 octobre 2015.
13:23 Publié dans Actualité, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : carl schmitt, chine, asie, affaires asiatiques, théorie politique, philosophie politique, politologie, sciences politiques |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
lundi, 15 novembre 2021
Pourquoi le "De Monarchia" de Dante reste d'actualité

Pourquoi le "De Monarchia" de Dante reste d'actualité
par Roberto Russano
Ex: https://www.barbadillo.it/101632-perche-resta-attuale-il-de-monarchia-di-dante/
Le texte de Dante révèle, surtout à ceux qui l'examinent à la lumière des principes intemporels de la Tradition, sa valeur métapolitique et, par conséquent, nettoyé des contingences historiques qui ont accompagné sa naissance, il montre sa pertinence substantielle à une époque de crise profonde où notre avenir apparaît incertain et voilé d'ombres menaçantes
Parmi les œuvres composées par Dante Alighieri, la Monarchia, ou De Monarchia comme on l'appelle sans cérémonie, est un traité politique en trois livres datant des dernières années de la vie du génie florentin dans lequel il intervient pour soutenir l'origine divine et directe du pouvoir impérial contre les prétentions papales qui reconnaissaient l'empereur comme un simple potestas indirecta in temporalibus. Le pape Boniface VIII, quelques années seulement avant la rédaction de l'œuvre de Dante, avait réaffirmé la thèse papale avec la bulle Unam Sanctam, tandis que Dante, en bon Gibelin, avait épousé, avec quelques aménagements formels, la "théorie des deux soleils", formulée à la fin du cinquième siècle de notre ère par le pape Gélase Ier dans une lettre à l'empereur d'Orient Anastase et l'avait défendue, avec une foule d'arguments tirés principalement de l'autorité des Saintes Écritures, dans le troisième livre de son traité, arrivant à la conclusion que "la faculté de conférer le pouvoir dans la sphère temporelle est contraire à la nature de l'Église" (III, XIV, 9).

Gélase I, pape de 492 à 496.
L'Empire et l'Eglise catholique
Une lecture superficielle du texte de Dante peut donner au lecteur l'impression d'être en présence d'une œuvre inévitablement datée, destinée aux spécialistes de la pensée politique médiévale au même titre que la masse ostensible d'écrits qui, au cours du Moyen Âge, ont plaidé en faveur de l'une ou l'autre institution dans la longue dispute pour la suprématie impliquant la papauté et l'empire, ou, tout au plus, en présence d'un texte certes fondamental pour reconstruire la pensée politique de Dante mais, sur le fond, dépourvu d'actualité.
Sans aucun doute, de l'époque de Dante à nos jours, des transformations historiques radicales ont eu lieu : d'une part, l'un des deux objets du litige, le pouvoir impérial, qui était déjà entré en crise dans la phase finale du Moyen Âge avec la naissance des États nationaux, l'opposition de l'Église et des Communes, après un long et irrépressible déclin, a définitivement cessé d'exister au début du siècle dernier avec la disparition des derniers empires de l'histoire pouvant être définis comme tels, à savoir les empires austro-hongrois, ottoman, russe et chinois ; d'autre part, l'Église catholique elle-même, dont la papauté est l'institution faîtière, après avoir perdu son unité avec la Réforme protestante et, par la suite, tout pouvoir temporel avec la naissance de l'État italien, lutte aujourd'hui pour survivre, en préservant sa propre nature et sa mission, dans une société séculaire qui a remplacé la parole chrétienne par la parole scientiste et relativiste, tandis que les églises se vident de plus en plus et que les belles cathédrales médiévales, autrefois symbole du pouvoir de la foi, sont transformées de lieux de culte en complexes muséaux destinés à recevoir des hordes de visiteurs distraits du monde globalisé.

A la lumière de la Tradition
Cependant, une lecture plus attentive du texte de Dante révèle, surtout à ceux qui l'examinent à la lumière des principes intemporels de la Tradition, sa valeur métapolitique et, par conséquent, nettoyé des contingences historiques qui ont accompagné sa naissance, montre sa pertinence substantielle à une époque de crise profonde dans laquelle notre avenir apparaît incertain et voilé par des ombres menaçantes.
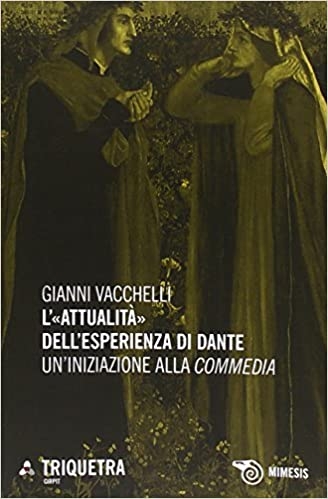 Entre-temps, l'un des éléments fondateurs sur lesquels se construit toute l'œuvre de Dante est la vision que - en adaptant à la pensée du poète suprême un concept cher au théologien Raimon Panikkar, comme le propose Gianni Vacchelli dans sa belle "initiation" à Dante - nous pourrions définir comme cosmo-théandrique en ce qu'elle articule, dans une perspective trinitaire, théologie, cosmologie et anthropologie. Selon cette vision traditionnelle, dont Dante est le porte-parole et que nous connaissons bien à travers la Divine Comédie, l'homme ne naît pas par hasard et n'est pas non plus jeté de manière inexplicable dans une existence dénuée de sens dont le seul but est la mort, mais il a été créé par Dieu à son image et à sa ressemblance, comme l'élément central d'un cosmos ordonné au sein duquel, en utilisant la liberté qui est un élément essentiel de sa personne, il traverse son existence terrestre pour rejoindre son Créateur à la fin de celle-ci.
Entre-temps, l'un des éléments fondateurs sur lesquels se construit toute l'œuvre de Dante est la vision que - en adaptant à la pensée du poète suprême un concept cher au théologien Raimon Panikkar, comme le propose Gianni Vacchelli dans sa belle "initiation" à Dante - nous pourrions définir comme cosmo-théandrique en ce qu'elle articule, dans une perspective trinitaire, théologie, cosmologie et anthropologie. Selon cette vision traditionnelle, dont Dante est le porte-parole et que nous connaissons bien à travers la Divine Comédie, l'homme ne naît pas par hasard et n'est pas non plus jeté de manière inexplicable dans une existence dénuée de sens dont le seul but est la mort, mais il a été créé par Dieu à son image et à sa ressemblance, comme l'élément central d'un cosmos ordonné au sein duquel, en utilisant la liberté qui est un élément essentiel de sa personne, il traverse son existence terrestre pour rejoindre son Créateur à la fin de celle-ci.
Les pouvoirs politiques et spirituels ont pour tâche de l'aider dans ce transit, plus ou moins bref, en réveillant en lui, tout d'abord, la conscience de ses origines extraterrestres et en le guidant vers le but final. En particulier, selon Dante, "la Monarchie temporelle, qui se définit comme Empire, est la principauté unique et étendue sur tous les hommes dans leur durée terrestre, ou plutôt dans le domaine et sur les questions qui ont une dimension terrestre" (I, II, 2).
L'action des deux pouvoirs requiert donc une investiture supérieure qui tire sa légitimité d'en haut, de Dieu lui-même, et doit s'inspirer de principes et de comportements d'origine sacrée et transcendante qui ont fait l'objet d'une révélation à travers les Écritures mais qui, par respect pour l'analogia entis qui façonne l'univers, sont en même temps également présents dans la configuration créaturelle de l'homme et de la nature.
La légitimation d'en haut reste aux représentants des deux pouvoirs dans la mesure où ils se conforment aux principes sacrés ainsi établis afin de remplir la mission spirituelle et métapolitique qui leur est confiée : selon Dante, l'empire est, précisément en vertu de sa structure constitutive dans laquelle le pouvoir est conçu comme missio et servitium, la forme politique capable de garantir cette correspondance, assurant paix, justice et bonheur à ses gouvernés. A cet égard, le poète suprême s'exprime en ces termes "...le genre humain est plus heureusement ordonné quand il est réglé, quant à ses mouvements et à ses moteurs, par un seul prince qui agit comme un seul moteur et selon une seule loi en fonction d'un seul mouvement... Donc, la présence d'une Monarchie, ou de cette principauté unique appelée Empire, paraît indispensable au bonheur terrestre" (I, IX, 2-3).
La nostalgie de l'Empire
Après avoir connu au siècle dernier les désastres du nationalisme et la crise continue de la démocratie parlementaire de plus en plus à la merci d'un pouvoir économique qui ne connaît pas de limites dans la recherche du profit, aujourd'hui, même face à l'urgence migratoire et aux excès de la souveraineté, nous revenons sur nos pas et regardons avec intérêt et un peu de nostalgie les empires du passé qui ont su assurer la coexistence pacifique d'ethnies aux histoires, langues et religions différentes: il est significatif qu'un chercheur faisant autorité comme Remi Brague (2), face au risque réel d'un échec de l'idée d'Europe et du déclin définitif de l'Occident, ait proposé comme exemple possible à imiter la "voie romaine", le modèle impérial romain contaminé et fécondé par le christianisme, dont la caractéristique est représentée, selon le chercheur français, par la "nature secondaire", c'est-à-dire la capacité d'accueillir dans un véritable écoumène les cultures précédentes ou, en tout cas, d'autres cultures, tout en conservant sa propre identité. Pour présenter sa thèse suggestive, Brague se réfère à Dante qui, dans le livre II du De Monarchia, discute de la mission universelle de l'Empire romain.
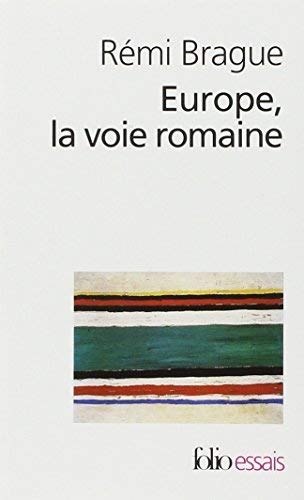 La proposition de Brague pose naturellement une série de problèmes et de nœuds à résoudre, dont celui d'identifier une forme d'investiture pour un gouvernement néo-impérial capable de concilier la participation populaire et le caractère sacré de la fonction et des objectifs : dans ce cas aussi, on pourrait s'inspirer de l'expérience romaine-chrétienne avec des modifications et des ajouts appropriés pour l'adapter au présent.
La proposition de Brague pose naturellement une série de problèmes et de nœuds à résoudre, dont celui d'identifier une forme d'investiture pour un gouvernement néo-impérial capable de concilier la participation populaire et le caractère sacré de la fonction et des objectifs : dans ce cas aussi, on pourrait s'inspirer de l'expérience romaine-chrétienne avec des modifications et des ajouts appropriés pour l'adapter au présent.
Enfin, les mots avec lesquels Dante, dans l'incipit du De Monarchia, indique la raison principale qui l'a poussé à écrire son traité restent imprimés : tout intellectuel qui se respecte doit employer ses talents à écrire des œuvres significatives pour le bénéfice des générations futures.
Il est possible d'interpréter largement le message de Dante comme un appel très actuel à la responsabilité du savoir à un moment de l'histoire où l'on assiste de plus en plus à une nouvelle " trahison des clercs " face aux pièges de la pensée unique.
(1) Gianni Vacchelli, L'"actualité" de l'expérience de Dante. Un'inizizione alla Commedia, Mimesis,2014, pp.369 ; de Vacchelli voir aussi le plus récent "Dante e la selva oscura", Lemma Press, 2018, pp.179.
(2) Rémi Brague, L'avenir de l'Occident. Dans le modèle romain le salut de l'Europe, Bompiani,2016, pp.225.
*La traduction italienne du texte de Dante est tirée du site Dante Online.
12:01 Publié dans Littérature, Philosophie, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, littérature italienne, lettres, lettres italiennes, philosophie, philosophie politique, théorie politique, moyen âge, empire, saint-empire |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
L'idéologie du politiquement correct et la civilisation occidentale

L'idéologie du politiquement correct et la civilisation occidentale
Vojtěch Belling
Ex: https://deliandiver.org/2007/11/ideologie-politicke-korektnosti-a-zapadni-civilizace.html
Lorsque, au début des années 1930, le politologue et théoricien du droit allemand Carl Schmitt a tenté de prouver la présence cachée mais néanmoins évidente de tendances totalitaires dans l'État libéral-démocratique moderne, il a semblé à nombre de ses contemporains conservateurs qu'il s'agissait d'une exagération. Les années suivantes ont apparemment confirmé à leurs yeux l'absurdité de l'affirmation de Schmitt. Au contraire, le véritable totalitarisme était palpable dans les régimes qui positionnaient la démocratie libérale comme leur ennemi juré.
Les théories classiques du totalitarisme associées aux noms de Carl Joachim Friedrich, Zbigniew Brzezinski et Hannah Arendt, fondées sur les caractéristiques externes des régimes totalitaires (idéologie, parti, police secrète terroriste, monopole du renseignement, monopole des armes, économie planifiée), ont soutenu cette mise en opposition absolue du totalitarisme avec la démocratie libérale. Ni la conception de Voegelin et de Meier sur l'émergence des religions politiques en tant que substitut de la foi, ni la conception de Schelsky sur le totalitarisme pluraliste, n'ont changé quoi que ce soit à l'acception générale et exclusive du totalitarisme en tant que phénomène anti-libéral et anti-démocratique en contradiction avec les démocraties ordinaires de style occidental.
Pourtant, depuis que le monde a célébré le triomphe de l'establishment libéral-démocratique et que Francis Fukuyama a commencé à parler de la fin de l'histoire, certaines tendances totalitaires ont commencé à émerger très clairement au sein des États libéraux-démocratiques, ce qui peut nous amener à repenser les propositions de Schmitt et à les comprendre sous un jour nouveau. Je pense en particulier au phénomène multicouche du soi-disant politiquement correct qui imprègne toutes les réalités du discours politique, social et scientifique dans la civilisation occidentale actuelle. Dans l'article suivant, j'essaierai de démontrer comment ce politiquement correct, issu du régime libéral-démocratique développé, tend à détruire progressivement son essence (ndt: du moins l'essence qu'on lui attribue et/ou qu'il s'est auto-attribuée). En décrivant la nature de ce phénomène et ses formes dans les environnements nord-américain, européen et tchèque, j'essaierai de le placer dans le contexte du développement de la société moderne et de documenter la dérivation naturelle de son essence.

L'essence du politiquement correct
Le politiquement correct, dans le sens courant du terme, désigne un ensemble d'éléments nécessaires pour qu'une certaine action ou expression d'opinion soit considérée comme pertinente ou ne soit pas sanctionnée socialement. En d'autres termes, le politiquement correct est une sorte de cadre externe de communication que l'auteur et le lecteur ou l'auditeur doivent accepter s'ils veulent se comprendre. À cet égard, elle joue donc un rôle similaire à celui de la langue elle-même. Toutefois, contrairement à cette dernière, le politiquement correct n'est pas exigé par les caractéristiques biologiques de l'homme, mais par certaines normes sociales imposées aux deux sujets - l'auteur et le lecteur - par la société extérieure.
En un sens, le politiquement correct peut donc être assimilé à la politesse, qui est également une forme externe universelle de communication entre des personnes d'horizons différents. Contrairement à la politesse, cependant, le politiquement correct a un impact beaucoup plus important sur le contenu du discours lui-même, et pas seulement sur sa forme. En outre, les sanctions pour violation du politiquement correct sont beaucoup plus sévères et durables que celles pour violation de la politesse. Car, comme le note Gerard Radnitzky, ne pas suivre le politiquement correct revient à briser un tabou. Le politiquement correct, comme nous le verrons, tend en fait à étendre la gamme des tabous éthiques de l'ordre libéral classique, tels que le meurtre, le vol, etc. D'autre part, elle supprime de force certains des tabous traditionnels existants (meurtre de l'enfant à naître, fornication, etc.). Cela change fondamentalement le système de valeurs éthiques de la civilisation occidentale.
Le politiquement correct repose sur la conviction que les idées d'un courant de valeurs politiques particulier, essentiellement et exclusivement de gauche, peuvent prétendre à une validité universelle. Les défenseurs de ces idées, par une manipulation habile, en utilisant au maximum les possibilités de l'État et de ses instruments dans la sphère culturelle (les médias publics), parviennent à subordonner à ces idées les normes du langage humain, du comportement humain, de l'action politique et, en définitive, de la pensée humaine. Les unités idéologiques que le politiquement correct universalise de cette manière concernent le plus souvent les questions des minorités nationales, ethniques, sexuelles ou religieuses et de l'égalité des sexes. En même temps, le politiquement correct est une arme efficace qui aide les minorités défavorisées pour diverses raisons (parfois, étonnamment, elles sont justifiées) à atteindre facilement leurs objectifs. Cependant, le but ultime et l'élément omniprésent du politiquement correct est l'élimination d'une identité culturelle ou civilisationnelle qui joue encore un rôle de premier plan dans un domaine particulier. Le politiquement correct étant un phénomène spécifiquement occidental, la réalisation de son objectif constitue une élimination concomitante de l'identité occidentale.
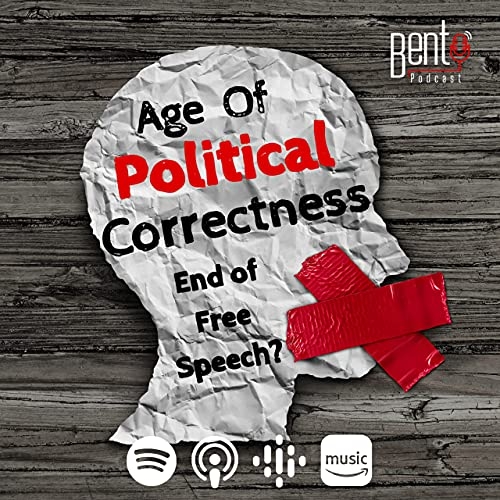
Réglementer le langage : le premier domaine du politiquement correct
La modification des règles d'utilisation de la langue est l'un des symptômes les plus évidents du politiquement correct, partout dans le monde. Au lieu des termes traditionnels utilisés, le politiquement correct crée de nouvelles tournures de phrases ou des termes de substitution qui changent le sens de la chose nommée. Le terme existant est immédiatement tabou dès qu'il est remplacé. Un exemple classique est le développement des termes servant à désigner un membre du groupe ethnique noir aux États-Unis. Au lieu du terme "nègre", le politiquement correct a inventé dans le passé le terme "de couleur". Dès que la signification de ce terme est redevenue problématique, le politiquement correct l'a remplacé par "noir". Il n'a pas fallu longtemps pour que le terme soit à nouveau remplacé par "afro-américain". Un processus similaire peut être observé pour certains mots de la langue tchèque. Par exemple, le terme original "Gypsy" a été remplacé par "Roma", en dépit du fait que le terme "Roma" était auparavant utilisé pour se référer uniquement à un groupe spécifique de Gitans. C'est pourquoi les Allemands ont utilisé le double terme "Roma und Sinti" pour désigner un groupe plus important des tribus gitanes d'origine, mais pas toutes.
Lorsqu'il existe un risque de jugement négatif à l'égard des membres d'un groupe ethnique particulier, le politiquement correct refuse toute discussion sur l'ethnicité. Un exemple en est la couverture des crimes dans les programmes d'investigation de la télévision publique, dans lesquels le téléspectateur doit souvent déchiffrer littéralement l'origine ethnique de l'auteur sur la base de quelques références accessoires (peau brune, cheveux noirs, "mauvais Tchèque", etc.). Et ce, malgré le fait qu'une information directe sur cette affiliation faciliterait grandement la recherche. En bref, les règles du politiquement correct l'emportent sur l'objectif du message lui-même.
Les exigences linguistiques du politiquement correct visant à donner du pouvoir aux minorités discriminées sont souvent très absurdes. Aujourd'hui, par exemple, il est très dangereux de commander un café blanc à une serveuse noire aux États-Unis en utilisant le terme traditionnel "café blanc". Le terme a déjà été coulé et tabouisé en termes de politiquement correct. Il faut soit réfréner son envie de la boisson en question, soit faire preuve de beaucoup d'imagination pour trouver des formes descriptives.
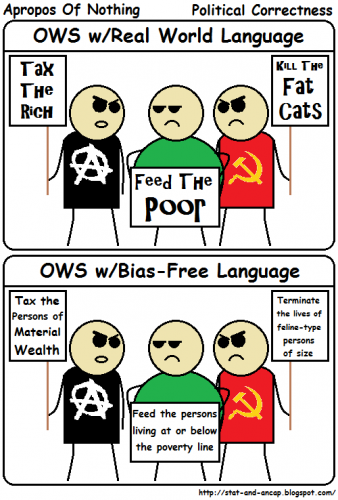
Une raison très courante des transformations politiquement correctes du langage est le discours de l'égalité des sexes, qui cherche délibérément à s'emparer du langage comme de l'arme la plus puissante de l'homme postmoderne. Peut-être que toutes les langues subissent aujourd'hui des changements qui correspondent au désir des femmes d'avoir une part de pouvoir. Il n'y aurait rien d'étrange à cela si ces changements n'étaient pas effectués sans tenir compte de la logique interne de ces langues et de leurs règles. En français, ce problème a été soulevé dans le débat sur les équivalents féminins d'expressions traditionnellement masculinisées : monsieur le ministre - madame la/le ministre.
En allemand, en revanche, la question du pluriel commun des noms existant à la fois sous forme masculine et féminine a été abordée. Par exemple, le terme "étudiants" (Studenten) était traditionnellement utilisé au pluriel pour les étudiants et les étudiantes. Plus tard, les idéologues du politiquement correct ont jugé que cela était discriminatoire à l'égard des femmes, et ce sens a été redéfini en tant qu'étudiants (Studenten) et étudiantes (Studentinnen). Ici, cependant, le problème est que les femmes ne sont pas prises en compte. Enfin, une toute nouvelle forme de pluriel "unisexe" a été créée pour la plupart des noms en ajoutant la terminaison féminine "Innen" avec une lettre initiale majuscule pour prouver son égalité avec les pluriels masculins. Ainsi, "Studenten" est devenu le mot absurde "StudentInnen", qui viole toutes les règles de la logique grammaticale allemande en incluant une majuscule au milieu du mot. Pour l'instant, la langue tchèque du politiquement correct en matière de genre se contente de l'usage courant des pluriels féminins et masculins, les femmes venant généralement en premier (étudiantes et étudiants, citoyennes et citoyens, etc.).
Cependant, le règlement linguistique s'étend également à des domaines où l'on ne s'y attend pas. L'exemple le plus évident de la prétention du politiquement correct à une validité universelle est son empiètement sur le domaine de la religion dans le domaine du langage. L'apparition d'éditions politiquement correctes de la Bible ou de livres de prière en est la preuve. Ainsi, en plus de Dieu le Père, "Dieu la Mère" apparaît également dans ces versions, et des changements similaires se produisent dans d'autres concepts fondamentaux du langage religieux. Même dans la sphère sacrée, le politiquement correct est l'arbitre suprême de la qualité du contenu et de la forme du message.
Régulation du comportement
Au stade suivant, le politiquement correct passe de la régulation du langage à la régulation du comportement des individus, mais aussi de groupes entiers, de la société et de l'État dans son ensemble. Comme nous l'avons déjà mentionné, le but du politiquement correct est la destruction de l'identité. L'une des façons d'atteindre cet objectif est de souligner la position non seulement égale mais souvent privilégiée de toute minorité dans un environnement culturel donné. Cette promotion prend de nombreuses formes, parmi lesquelles le principe de la discrimination positive, l'affirmative action, mérite une mention spéciale. Son essence repose sur le principe d'égaliser, mais aussi de favoriser et de privilégier tout ce qui est considéré comme étant en dehors de la norme ou de la normalité dans la tradition occidentale. La discrimination positive vise les minorités ethniques, les groupes religieux et les personnes non hétérosexuelles (n'oublions pas que, selon le langage du politiquement correct, il n'y a pas deux, mais cinq genres).
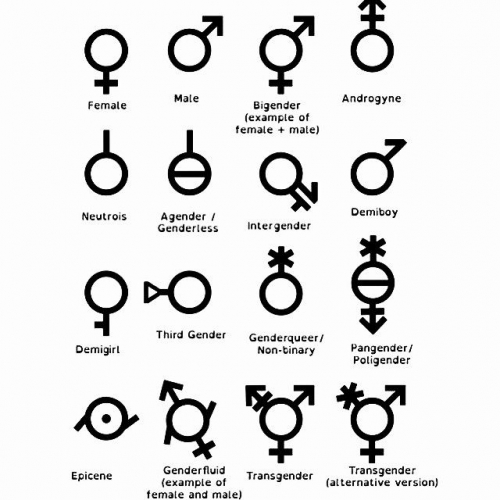
Aux extrêmes, la discrimination positive peut prendre des formes très curieuses : par exemple, certaines universités américaines favorisent les membres de minorités ethniques (mais seulement certaines, comme les Afro-Américains ou les Amérindiens), mais avec la preuve d'une ascendance biologique-raciale jusqu'au quatrième degré. En d'autres termes, un demandeur d'aide sociale ou de traitement spécial doit documenter l'ascendance biologique de ses grands-parents et autres ancêtres, y compris le pourcentage de "sang minoritaire". La méthodologie de l'affirmative action est donc très proche des pratiques raciales du régime nazi, dont les fameux "Ahnenpässe" - mais à la différence que l'objectif est de favoriser les minorités ethniques.
Dans tous ces cas, il s'agit d'une démarche rationnelle de la part des minorités. Dans son livre The Holocaust Industry, l'auteur juif américain Norman Finkelstein utilise l'exemple de l'utilisation de l'Holocauste à des fins qui n'ont rien à voir avec la commémoration et l'héritage de cette horrible tragédie du 20ème siècle pour critiquer l'approche utilitaire de nombre de ses collègues qui ont fait de l'Holocauste un concept industrialisé. Ce qui mérite d'être analysé, c'est donc plutôt le comportement de la majorité, qui est non seulement capable de s'accommoder des efforts rationnels des minorités, mais qui anticipe elle-même ces efforts. Après tout, la simple mention de l'existence d'une culture majoritaire est politiquement incorrecte, comme l'a montré, par exemple, la discussion sur le terme "Leitkultur" qui a eu lieu en Allemagne il y a quelques années à propos de l'intégration des étrangers dans l'environnement allemand. En réponse aux tentatives des politiciens conservateurs de créer une législation qui rendrait obligatoire l'initiation des immigrants aux principes culturels de l'espace d'Europe centrale, la gauche a répondu par le jugement surprenant qu'il n'y a aucune culture qui a une position privilégiée dans l'environnement allemand, et qu'il ne peut y en avoir.

Cela nous amène à la deuxième dimension de la réglementation politiquement correcte des comportements, qui ne vise pas à privilégier les minorités et les cultures minoritaires, mais à détruire la culture majoritaire. Bien sûr, toujours avec la conscience de la liquidation de l'identité comme ultima ratio. Cette lutte contre l'identité occidentale prend plusieurs formes. L'une d'entre elles est la tentative de supprimer ou de remettre en question les éléments distinctifs de la culture occidentale. Comme l'a écrit le théologien Henry van Til, "la culture est la religion incarnée". L'assaut du politiquement correct se concentre donc en premier lieu contre le christianisme. On peut trouver des exemples partout dans le monde de la civilisation occidentale. La première association qui vient à l'esprit est la destruction des symboles religieux : le retrait des croix dans les écoles bavaroises sur l'insistance des parents d'un seul élève d'une autre religion qui se sentait offensé par la présence de la croix dans les salles de classe, le retrait de la crèche dans les écoles du nord de l'Italie, ou encore le retrait des croix et des tablettes des dix commandements des palais de justice américains et d'autres espaces publics.
Cependant, si les efforts de neutralité religieuse dans la sphère publique sont plus anciens (en France, la laïcité est l'un des principes constitutionnels fondamentaux depuis le début du 20ème siècle), dans la sphère privée, cette ingérence a déjà lieu exclusivement sous la bannière du politiquement correct. Les Boy Scouts of America, par exemple, ont échappé de justesse à une modification de leur constitution, ordonnée par un tribunal, interdisant le recrutement d'homosexuels actifs comme chefs scouts. Ils ont payé leur victoire à la Cour suprême par le mépris d'un certain nombre d'organisations et d'institutions publiques activées par l'American Civil Liberties Union (ACLU) - la structure personnifiée du politiquement correct aux États-Unis. Par ailleurs, même les scouts n'ont pas résisté à la pression du politiquement correct, qui les a contraints à modifier la formulation du serment des nouveaux membres et à autoriser une version athée du serment scout.

Toutefois, l'influence du christianisme est également limitée par des moyens beaucoup plus radicaux : par exemple, la possibilité de désacraliser librement les symboles chrétiens dans l'art ou la littérature, ou l'attitude a priori négative de la plupart des médias, en particulier les médias publics, à l'égard des dénominations chrétiennes. Cependant, quiconque voudrait désacraliser de la même manière toute religion autre que celle qui constitue l'identité occidentale se heurterait au mal. Nous trouvons donc un paradoxe intéressant : le politiquement correct, qui lui-même nie officiellement l'existence de sources spécifiques de l'identité occidentale (par exemple, ses racines chrétiennes), dans ses activités visant à éliminer ces sources, confirme effectivement ce rôle, tout en prouvant qu'il en est en fait très conscient.
Outre la religion, le politiquement correct s'attaque également à d'autres symboles de la culture occidentale. Cela est évident, par exemple, dans les efforts acharnés pour remettre en question puis démanteler la famille en tant que principale forme de vie légitimée dans la société occidentale. La promotion de formes de vie alternatives (favorisant les minorités) et, à l'inverse, la discrimination de la famille traditionnelle et du mariage en tant qu'élément institutionnel central (désavantageant la majorité) dans les actions de nombreux États en sont la preuve.
Régulation de la pensée
Si la régulation du langage et la régulation des comportements sont des symptômes très évidents, et faciles à décrire, de la présence du discours du politiquement correct, son caractère totalitaire ne devient apparent que dans la troisième étape de sa progression : la régulation de la pensée. Pourtant, c'est précisément l'atteinte d'un état d'autorégulation totale de la pensée, la définition de nouveaux critères moraux et la prise de conscience de ce qui est ou n'est pas acceptable et approprié qui constituent le but ultime du politiquement correct. À cet égard, le politiquement correct a eu plus de succès que les régimes totalitaires classiques, qui se concentraient le plus souvent uniquement sur la réglementation du langage et du comportement.
Le stade de l'autorégulation ne nécessite plus d'intervention extérieure et le politiquement correct n'a plus besoin de soutien institutionnel extérieur (par exemple dans les médias publics, les partis politiques et les ONG). L'étendue du niveau d'autorégulation atteint est révélée par des enquêtes d'opinion publique comportant des questions choisies de manière appropriée. Lorsque l'opinion publique a été sondée en Allemagne après la récente affaire dite Hohmann (1), la majorité des personnes interrogées (80 %) ont exprimé leur profond désaccord avec les opinions de cet homme politique conservateur. Peu après, l'opinion publique a été sondée sur les opinions de Hohmann sans le nommer explicitement, et un groupe tout aussi important (80 %) les a approuvées. Cette enquête a donc démontré que la population avait déjà accepté les attitudes politiquement correctes médiatisées envers le porteur spécifique du message (Hohmann), mais pas envers le message lui-même, qui n'était pas encore dans la sphère du tabou autorégulateur.
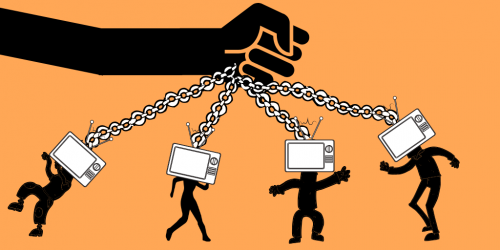
Dans la régulation de la pensée, les médias jouent un rôle central, et presque entièrement les médias publics, qui sont coordonnés par la sphère politique et en même temps ne sont pas liés par la loi de l'offre et de la demande. Au lieu de fournir un divertissement, leur objectif est d'éduquer et de former le public, bien sûr dans l'esprit des élites intellectuelles qui les influencent. Les médias de service public sont également les propagateurs de mythes et de stéréotypes modernes qui, contrairement aux stéréotypes culturels classiques, revendiquent une vérité universelle et incontestable.
Un exemple de ce "stéréotype à l'envers" est la thèse de la discrimination salariale présumée à l'encontre des femmes, qui atteint en République tchèque le niveau d'un écart salarial de vingt-cinq pour cent. En réalité, cette différence au sein d'une même profession (et c'est seulement là qu'elle peut être constatée) ne dépasse pas 4 %, selon les statistiques officielles du ministère du travail et des affaires sociales. La différence d'un quart de point souvent citée n'est due qu'à la répartition différente de la main-d'œuvre féminine et masculine dans les différentes professions (féminisation de certains secteurs, comme l'éducation, et masculinisation d'autres, comme la métallurgie et l'extraction de minéraux et de charbon). Néanmoins, l'allégation susmentionnée de discrimination salariale monstrueuse à l'encontre des femmes se retrouve dans les documents officiels et les présentations médiatiques et fonctionne selon les principes d'un stéréotype bien ancré. Cependant, il n'est pas permis de le nier - c'est politiquement incorrect, avec tout ce que cela comporte comme classification.
Un exemple similaire est celui des stéréotypes de la soi-disant correction historique - un symptôme classique de la correction politique en Allemagne. Ses règles rendent impossible la recherche historique sur certaines questions du passé. Certaines vérités sont considérées comme immuables et les recherches à leur sujet ne sont pas autorisées (par exemple, le sujet de certains crimes commis par l'Armée rouge sur le front de l'Est pendant la conquête de l'Allemagne nazie a longtemps été tabou et sa recherche même était "historiquement incorrecte").
Lorsqu'une exposition sur les crimes de la Wehrmacht a été organisée en Allemagne il y a quelques années, son intention et le matériel présenté étaient incontestables en Allemagne, même si de nombreux experts étaient conscients des difficultés fondamentales du concept. En raison de l'objectif de l'exposition - montrer la criminalité de l'armée allemande (encore considérée dans les années 1950 et 1960 comme une organisation non criminelle à la suite des conclusions du tribunal de Nuremberg) -, rien ne pouvait être contesté qui puisse nuire à sa réalisation. Seul l'historien polonais Bogdan Musial a perturbé le concept de l'exposition en soulignant le fait (connu de nombreux experts, mais pas officiellement déclaré) que, dans de nombreux cas, les images représentant des crimes brutaux ne mettaient pas en scène des soldats allemands, mais des membres de l'Armée rouge et du NKVD. Il est intéressant de noter qu'aucun des centaines de milliers de visiteurs allemands, souvent d'anciens soldats, n'a fait remarquer la différence évidente entre les uniformes sur les photos (ces uniformes n'étaient clairement pas allemands). L'institutionnalisation de la prétention à la vérité dans le régime du politiquement correct rend impossible la négation d'un mensonge flagrant si une telle négation compromet les objectifs du politiquement correct.
Conclusion : Le politiquement correct comme élément du totalitarisme pluraliste
À ce stade, nous pouvons revenir à la question initiale : est-il possible de voir dans le politiquement correct un élément de tendances totalitaires au sein de l'État démocratique libéral moderne ?
Comme je l'ai dit dans l'introduction, pour les théoriciens classiques du totalitarisme, Arendt, Friedrich et Brzezinski, l'ordre démocratique est absolument opposé au totalitarisme. Bien entendu, la définition structurelle-fonctionnelle du totalitarisme ne nous permet pas de considérer le régime du politiquement correct comme totalitaire, puisqu'il ne remplit que deux des six éléments nécessaires au totalitarisme : l'élément idéologique et le monopole de l'information.
Une perspective quelque peu différente est toutefois fournie par la conception du totalitarisme telle qu'elle a été exposée par les représentants de l'école de sociologie de Leipzig, qui voyaient dans le totalitarisme un produit logique de la société industrielle moderne. Selon Arnold Gehlen et Hans Freyer, l'ordre social industriel contient des éléments totalitaires immanents. Hans Freyer parle dans ce contexte de systèmes dits "secondaires". Alors que l'ordre social traditionnel des temps pré-modernes est construit "auf gewachsenem Grunde" (métaphore de la continuité avec la nature : "sur une base de développement organique"), la société moderne est basée sur des "systèmes secondaires". Freyer les considère comme des "types idéaux" qui permettent d'isoler et d'analyser certains des éléments individuels de l'ordre social moderne : avant tout, les systèmes de production, de consommation et d'administration.
La production est fondée sur la tentative d'organiser et de distribuer le travail, de rationaliser tous les facteurs de production et de transformer le travailleur en une machine à travailler. La consommation est basée sur le principe de tout offrir à tout le monde, selon le slogan: "le niveau de vie est le dieu de l'époque et la production est son prophète". Enfin, le système d'administration apporte un nouveau type d'autorité - l'administration bureaucratique remplaçant les autorités naturelles de l'ère pré-moderne. Les systèmes secondaires créent un nouveau type d'homme, sans valeurs traditionnelles et sans base naturelle. Le totalitarisme trouve un terrain fertile à ce stade, selon Freyer, car il fournit des réponses faciles aux complexités de l'ordre social actuel et trouve un coupable spécifique pour les maux de notre temps : le juif, le capitaliste, le koulak. Le système administratif moderne accroît la menace du totalitarisme et facilite l'application de mécanismes totalitaires dans toutes les sphères de la vie humaine.
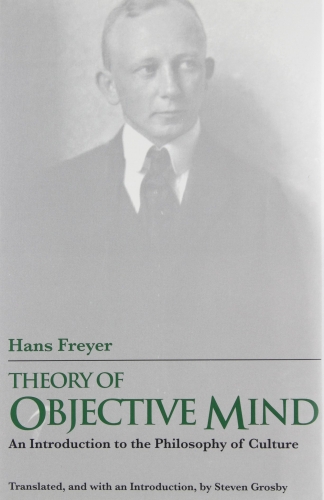
Freyer voit deux formes résultantes de l'État moderne : l'État totalitaire classique à l'Est, l'État providence à l'Ouest. Mais si Freyer considère que l'État-providence occidental est bénéfique dans le cadre des possibilités offertes par la modernité, Gehlen et Schelsky s'appuient sur ce concept en considérant que l'État-providence est également secrètement totalitaire. En effet, à la différence de l'État antérieur, l'État providence a pour objectif de fournir à l'homme la couverture de tous ses besoins sociaux et culturels, mais en même temps de contrôler ces besoins et les domaines correspondants. Cette idée est notamment développée par Roland Huntford, qui, sur la base d'une analyse du modèle suédois, conclut que le système de protection sociale constitue la base d'un nouveau totalitarisme conduisant à la croissance de la planification, de la bureaucratie et du conformisme des médias de masse.
Si le politiquement correct est analysé dans le contexte de cette théorie sociologique du totalitarisme de Leipzig, son essence apparaît sous un jour nouveau. Le politiquement correct est ici un produit spécifiquement occidental, issu des valeurs libérales classiques, mais qui les détruit en même temps. Le libéralisme classique, appliqué à la sphère des valeurs, a conduit à la relativisation de valeurs jusqu'alors considérées comme indiscutables et universelles. Le politiquement correct consiste dans le fait que cette relativisation revendique un caractère universel et s'absolutise (selon les termes du pape Benoît XVI, quand il été encore appelé cardinal Ratzinger).
C'est, après tout, le paradoxe bien connu de la philosophie post-structuraliste, qui élève sa thèse de la non-existence de la vérité au rang de révélation incontestable. Ce faisant, il se détourne du libéralisme classique et détruit même les libertés traditionnelles dont il dépend (liberté d'expression, liberté de pensée, liberté de religion). Dans le même temps, cependant, nous observons une ligne de développement cohérente depuis les Lumières et le libéralisme classique jusqu'au totalitarisme relativiste. Dans ce contexte, nombreux sont ceux qui se souviennent du célèbre dilemme de Böckenförde, selon lequel l'État laïque moderne est construit sur des principes qu'il ne peut garantir lui-même. En effet, ce dilemme peut être appliqué sans faille à la société moderne post-Lumières elle-même.
L'hypothèse selon laquelle le totalitarisme relativiste est peut-être plus modéré que le totalitarisme classique du passé est, bien sûr, erronée. Les principes des deux systèmes sont identiques. Le politiquement correct remet en question toutes les vérités, sauf celle qui prétend qu'il n'y a pas de vérité. Cette vérité, cependant, est universellement valable et sa négation est inacceptable. C'est également la base de l'application concrète des règles du politiquement correct à la vie de l'individu et de la société. Toutes les sources traditionnelles de la vérité et ses supports institutionnels doivent être détruits.
C'est la justification du fait que j'ai affirmé au début de cette étude sur la base d'une analyse empirique : le principal ennemi du politiquement correct est l'identité, en tant qu'élément institutionnalisant de la vérité. Sans identité, il n'y a pas de vérité. Et comme le politiquement correct est un phénomène occidental, l'ennemi est avant tout l'identité de l'Occident, c'est-à-dire la culture occidentale elle-même. Cet ennemi est certes désincarné, mais dans sa fonction de coupable systémique et d'ennemi universel, il remplit pour le politiquement correct la même fonction que le juif pour le nazisme ou le capitaliste pour le communisme. Par conséquent, il remplit pleinement les conditions de la conception du totalitarisme de Freyer.
La seule différence réside dans le fait que le politiquement correct est un élément qui découle de la tradition du système libéral-démocratique post-Lumières. Devenu la seule forme de gouvernement universellement légitime dans le monde après la fin de la guerre froide, et ayant ainsi perdu la raison de définir ses origines civilisationnelles contre un Orient dominé par le totalitarisme, ce système s'est en même temps livré au règne du politiquement correct, qui détruit les fondements sur lesquels repose le système libéral-démocratique, bien plus efficacement que n'importe quelle force armée extérieure.
Notes :
(1) L'acteur de cette affaire, un membre du Bundestag pour la région de Fulda, en Allemagne, a contesté il y a plusieurs années la thèse selon laquelle le peuple allemand est collectivement responsable de l'Holocauste et que cette culpabilité fait partie de l'identité allemande. Hohmann a étayé son affirmation en disant que défendre un tel point de vue revient à essayer de rendre les Juifs responsables de la révolution russe simplement parce que la plupart de ses dirigeants étaient juifs. Selon Hohmann, les deux approches sont tout aussi absurdes l'une que l'autre. Sur la base de ces déclarations, Hohmann a été exclu de la CDU et du Bundestag.
Conférence de Vojtěch Belling, PhD, au séminaire de l'Institut civique "Le monde 4 ans après le 11 septembre", 14 octobre 2005. Adapté du magazine Distance n° 3/2005.
11:39 Publié dans Actualité, Philosophie, Sociologie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, sociologie, philosophie, philosophie politique, politiquement correct |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mercredi, 10 novembre 2021
L'État est plus que la démocratie

L'État, c'est plus que la démocratie
par Vojtěch Belling
Ex: https://deliandiver.org/2009/12/stat-je-vic-nez-demokracie.html
Dans les études politiques et juridiques modernes, il serait difficile de trouver un penseur plus controversé que Carl Schmitt. D'une part, il fut un brillant philosophe du droit et un théoricien de la politique, doté d'un sens extraordinairement développé du raisonnement juridique logique ; d'autre part, il fut un savant qui a baigné jusqu'au cou dans le national-socialisme et que l'on appelle encore "l'avocat de la couronne" (Kronjurist) du Troisième Reich. Nous parlons bien sûr de l'homme d'État allemand Carl Schmitt (1888-1985). Ses livres comptent toujours parmi les textes les plus traduits et les plus cités de la littérature juridique et, ces dernières années, ils ont également fait leur apparition dans les bibliorhèques tchèques - la Théorie du partisan de Schmitt vient d'être publiée dans notre pays.
Il est difficile de ne pas aborder Schmitt
Le paradoxe est que l'œuvre de Schmitt a autant inspiré les marxistes italiens ou les maoïstes français que les conservateurs libéraux ou la pensée de la nouvelle droite européenne des années 1990. Ses idées se retrouvent dans les textes des philosophes contemporains les plus célèbres du monde, mais aussi dans les arrêts de la Cour constitutionnelle allemande, dont certains des anciens membres étaient des élèves de Schmitt. Dans la société policée par le politiquement correct, cependant, le nom de Schmitt n'est prononcé qu'avec la plus grande prudence, voire pas du tout. Pourtant, aucun philosophe du droit ou théoricien du parlementarisme sérieux dans ses recherches ne peut éviter de l'aborder.
Le plus grand problème, cependant, est que l'œuvre de Schmitt ne peut pas être simplement rejetée du revers de la main en référence aux activités politiques de son auteur. En fait, elles sont scientifiquement extrêmement raffinées, toujours pertinentes et nous obligent à réfléchir plus profondément aux questions existentielles des États modernes. Le différend sur Schmitt touche toutefois au problème de savoir dans quelle mesure une œuvre, même excellente, peut être dissociée de la personne particulière de l'auteur et de son comportement politique, ou dans quelle mesure les parties stimulantes de l'ensemble de l'œuvre peuvent être extraites et séparées des parties que d'aucuns jugent inacceptables.
Quand un collègue est abattu devant vous
Carl Schmitt est né le 11 juillet 1888 dans la ville de Plettenberg, en Westphalie. Il est resté étroitement lié à sa ville natale, située dans l'enclave catholique autour de Münster, il est resté attaché à ce site pendant toute sa vie, et y a vécu pendant de nombreuses années après la Seconde Guerre mondiale et y est décédé. Il étudia le droit à Berlin, Munich et Strasbourg, où il soutint sa thèse en 1915 et où il y fut habilité un an plus tard. Il s'est essayé à la littérature et a entretenu de nombreux contacts avec des représentants de l'avant-garde artistique. En 1916, il a épousé une femme serbe, Pavla Dorotić, mais ils ont divorcé en 1924. Lorsqu'il épouse une autre Serbe, Duška Todorović, deux ans plus tard, il est excommunié par l'Église catholique. Le juriste et philosophe, qui fut toute sa vie un admirateur enthousiaste du catholicisme en tant que "forme politique" et précurseur de l'idée de représentation politique, qui chercha des liens entre la théorie politique et la théologie, et qui était considéré comme un auteur typiquement catholique, resta donc excommunié et ne put recevoir les sacrements jusqu'à la mort de sa première femme en 1950. Un fait un peu piquant, mais qui est plus que caractéristique de Schmitt, avec son double visage de Janus.
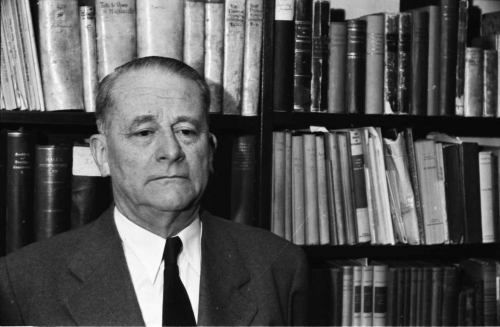
Le jeune professeur a passé une grande partie de la Première Guerre mondiale au ministère bavarois de la Guerre à Munich, où il a été affecté à la lutte contre la propagande ennemie. Il est resté dans la capitale bavaroise même pendant les jours troublés qui ont suivi la révolution de novembre 1918, et peu après, il a été le témoin direct d'une tentative de coup d'État communiste. Lorsqu'un révolutionnaire communiste a abattu un collègue devant lui au ministère, Schmitt est devenu un partisan déterminé d'un État fort capable de se défendre contre des groupes sociaux révoltés qui défendent leurs intérêts. Cette attitude est devenue l'un des contenus centraux de son œuvre.
Résolu : la science juridique gagne
Après avoir quitté le ministère, Schmitt a été professeur de droit public dans différentes universités allemandes, de Greifswald à Cologne, jusqu'en 1933. À cette époque, il a renoncé à ses ambitions artistiques et se consacre entièrement à la science juridique, tout en mettant l'accent sur la théorie politique, la philosophie et la sociologie. Il qualifie lui-même la science moderne de l'État de "théologie politique" et nomme l'un de ses livres comme tel. Dans ses écrits, il se lance dans une lutte déterminée contre la faible démocratie parlementaire, qu'il accuse d'être incapable de faire valoir vigoureusement l'intérêt politique de la nation dans son ensemble contre les pressions des partis politiques, des syndicats d'intérêts et d'autres groupes qui opposent leurs intérêts particuliers à l'ensemble. Dans son livre Die geistesgeschichtliche Lage des heutigen Parlamentarismus, il formule une critique sévère du système parlementaire, qui, selon lui, est directement construit sur le principe de la concurrence des intérêts privés. De plus, de par le profil social de ses membres, le Parlement ne représente qu'un certain groupe social, la bourgeoisie, et non la nation dans son ensemble.

La solution, selon Schmitt, devrait être une démocratie basée sur un système de votes populaires, qui remplacerait le règne des partis politiques et permettrait en même temps de prendre des décisions. Schmitt considère l'incapacité à prendre une décision claire comme l'une des faiblesses de la démocratie parlementaire, qui, selon lui, n'est encline qu'à des compromis boiteux. En même temps, cependant, il dit qu'il faut un gouvernement autoritaire qui prépare les questions pour le référendum et en même temps, soutenu par la confiance du peuple, qui décide de toutes les autres questions.
Quel est l'intérêt avant tout
Dans ses textes, Schmitt n'évite pas la question de savoir quelles compétences l'État fort qu'il proclame doit réellement avoir. Comme d'autres écrivains conservateurs, il critique un État qui s'immisce dans toutes les sphères de la vie, de l'économie à la culture, qu'il considère comme un "État total quantitatif". L'Allemagne de Weimar devait être à son image. L'idéal de Schmitt, en revanche, était un "État total qualitatif" limité à la sphère purement politique du gouvernement et laissant tous les autres domaines, y compris l'économie, à l'autogestion sociale ou au marché - une idée proche de nombreux libéraux. Un tel État se concentre sur la véritable nature de la sphère politique, que Schmitt voit, dans son célèbre ouvrage "Le concept du politique" (2007), comme un conflit intense et existentiel qui ne peut exister qu'au niveau supranational, mais pas au sein de l'État, qui repose sur l'unité nationale. En d'autres termes, la politique étrangère et la garantie de la sécurité intérieure de l'État font partie de la sphère des compétences inhérentes à l'État. L'élément "total" doit se manifester dans le fait que l'État agit ici de manière autoritaire, en excluant l'influence des groupes sociaux, en premier lieu les partis politiques, qui tendent à s'emparer de l'État pour promouvoir des objectifs dans la sphère de la société, mais avec lesquels l'État ne devrait à juste titre rien avoir à faire.
La conception de Schmitt du totalitarisme n'a pas grand-chose en commun avec les conceptions du totalitarisme célèbres plus tard, bien que leurs auteurs, comme Hannah Arendt et Carl Joachim Friedrich, aient fait de nombreuses références à Schmitt. Schmitt ne se concentre pas sur des caractéristiques externes telles que l'idéologie ou la terreur, mais sur la structure même du système social et sur l'interrelation entre l'État et la société. Selon Schmitt, l'État démocratique est aussi quantitativement total, c'est-à-dire omniprésent, dans la mesure où il ne laisse aucune place à la liberté humaine et régit tout d'en haut. Cette idée a été développée après la guerre, notamment par le sociologue Helmut Schelsky et le philosophe Arnold Gehlen.
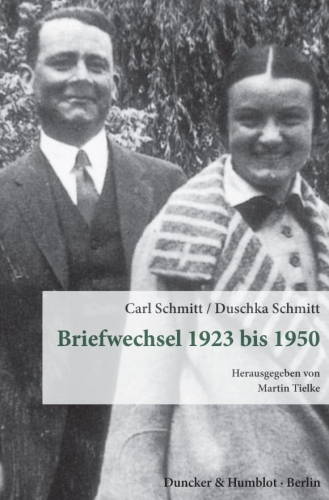
Un expert en plein essor
Dans la phase finale de la période de Weimar, Schmitt a rejoint un groupe d'intellectuels appelant au remplacement de la forme d'État existante par un régime autoritaire qui mettrait fin aux efforts des radicaux des deux côtés du spectre politique pour s'emparer des institutions de l'État et contrôler le parlement. Dans son essai Légitimité et légalité, il remet en cause la théorie juridique positiviste selon laquelle tout ce qui est conforme aux lois écrites est légitime et, à l'inverse, tout ce que les lois ne permettent pas est en même temps illégitime. Ce sont les nazis qui ont utilisé ce raisonnement positiviste pour défendre leur "révolution légale", dans laquelle une force totalitaire s'est emparée de l'État par des moyens légaux autorisés par la constitution. Ici aussi, l'argumentation de Schmitt est paradoxalement à l'origine du principe d'après-guerre de la démocratie dite défendable, qui est capable de se défendre contre les abus, ne permet pas de modifier les fondements de l'ordre constitutionnel même en recourant aux mécanismes démocratiques, et est capable d'éliminer les groupes politiques qui cherchent à le faire. Un tel principe est désormais inscrit dans la constitution allemande. Ses racines remontent à Schmitt, bien que lui-même n'ait certainement pas eu l'intention de protéger ainsi la démocratie parlementaire, mais un État autoritaire démocratique plébiscitaire contre une société hétérogène.
À la fin de l'ère Weimar, Schmitt est l'un des juristes les plus connus d'Allemagne. Le cabinet de Franz von Papen l'a même engagé comme conseiller juridique dans un procès contre l'État de Prusse, dont le gouvernement socialiste a été démis par le gouvernement du Reich en raison de la menace de déstabilisation du pouvoir. Il a défendu, bien sûr - dans l'esprit de ses convictions - le droit de l'État à intervenir dans une situation d'urgence. Avec la même véhémence, il préconise le renforcement des pouvoirs du Président à cette époque et rejette l'idée que le Président soit lié par un vote parlementaire de défiance envers un gouvernement qui n'en installe pas automatiquement un nouveau, provoquant ainsi une crise politique. Ce raisonnement est à l'origine du concept allemand actuel de vote de défiance constructif, selon lequel lorsqu'un chancelier est renversé, un nouveau chancelier doit être approuvé en même temps.
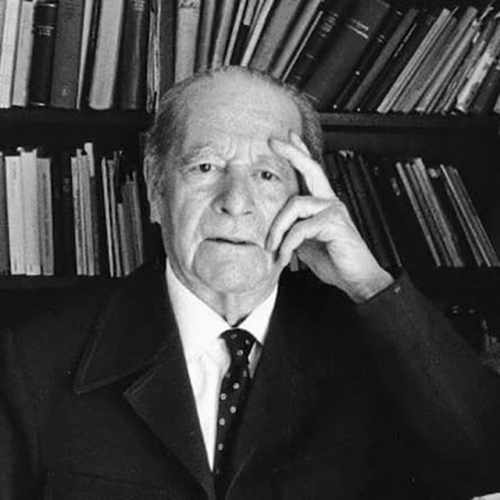
L'ivresse du nazisme
Schmitt a rejoint les nazis immédiatement après la prise de pouvoir d'Hitler en 1933. Il attendait du nouveau régime ce qu'il n'avait pas réussi à obtenir sous les chanceliers conservateurs Papen et Schleicher, à savoir l'établissement d'un État autoritaire, qualitativement totalitaire, concentré sur ses compétences et séparé de la société. Selon Schmitt, l'État nazi devait empêcher un véritable totalitarisme consistant soit dans la "socialisation de l'État" par la domination des partis et des groupes, soit dans la "nationalisation de la société" dans sa domination par l'État.
En 1933, Schmitt est nommé professeur à l'université de Berlin à l'instigation de Hermann Göring. Dans le même temps, il devient président de l'association des avocats nationaux-socialistes et occupe un certain nombre d'autres fonctions. Dans la hiérarchie des juristes nazis, il se hisse aux plus hauts rangs, et ses éditoriaux paraissent aux côtés de ceux des ministres du Reich dans des revues prestigieuses. Schmitt a rapidement commencé à adapter ses vues à l'idéologie dominante. Dans son essai sulfureux Le Führer protège la loi, il va même jusqu'à défendre juridiquement la Nuit des longs couteaux (au cours de laquelle Hitler a fait assassiner l'opposition interne du parti autour d'Ernst Röhm et de Gregor Strasser) comme un acte de "justice administrative". Il a ainsi remis en cause le principe de la séparation des pouvoirs judiciaire et politique. Avec la même véhémence, il a prôné la "purification" de la science juridique de l'influence juive. Ce faisant, il a également perdu de nombreux anciens amis. Ernst Forsthoff, l'un de ses plus proches élèves, a rompu avec lui après que Schmitt l'ait invité à une conférence sur l'influence juive sur la recherche juridique, ce que Forsthoff a refusé.
Cependant, même son opportunisme proclamé haut et fort n'a pas protégé Schmitt des attaques des partisans purs et durs du nouveau régime. En effet, même pendant la dictature, il a défendu sa position fondamentale consistant à séparer la gestion de l'État de la sphère de la société. Dans son livre Staat, Bewegung und Volk il défend l'idée que le mouvement nazi, en tant que force sociale et seul parti politique, doit se concentrer dans la sphère de la culture et de la société, tandis que la véritable politique doit être réservée à l'État, séparé de ce mouvement. Un tel concept allait clairement à l'encontre de l'objectif nazi de mettre les institutions étatiques sur la touche et de remplacer leur rôle par les organes du parti. Le disciple de Schmitt mentionné plus haut, Ernst Forsthoff, est allé encore plus loin en affirmant que l'ensemble du système de politique sociale avec lequel le système nazi travaillait devait être politiquement neutralisé - et retiré des mains du NSDAP. Cette idée était complémentaire de l'étatisme fort de Schmitt. S'il avait précédemment critiqué la domination de l'État par une ou plusieurs forces sociales comme une forme malsaine de totalitarisme, il ne pouvait manquer de voir que le système émergent était l'exemple le plus dur d'un tel processus.
Le contraste entre l'étatisme et le mépris des nazis pour l'État était évident pour les autres théoriciens nazis, qui ont rapidement commencé à critiquer Schmitt comme un libéral hégélien qui niait la supériorité de la nation et des idées nazies sur l'État. À partir de 1936, il est confronté aux attaques du magazine officiel SS Das Schwarze Korps", qui le considère comme un opportuniste et l'accuse même de collaborer avec les Juifs. À la suite de cette affaire, il a progressivement perdu tous ses postes. Jusqu'à la fin de la guerre, il reste cependant professeur à Berlin.
Des années de réclusion et un retour au premier plan
Après la Seconde Guerre mondiale, Schmitt a été arrêté mais non inculpé. Le procureur général du tribunal de Nuremberg, Robert Kempner, s'en est défendu plus tard en disant qu'il n'y avait pas d'acte spécifique pour lequel le condamner: "Il n'avait pas commis de crime contre l'humanité, il n'avait pas tué de prisonniers de guerre, il n'avait pas préparé une guerre offensive". En tant que scientifique, il ne pouvait tout simplement pas être reconnu coupable d'un crime. Pourtant, il a été exclu de la fonction publique sans pension. Il n'a plus postulé pour regagner l'opportunité d'enseigner, sachant qu'avec son passé, il n'aurait aucune chance. Il s'est retiré dans la solitude, une sorte d'exil intérieur, et a vécu le reste de sa vie dans sa ville natale de Plettenberg. Il y a écrit un certain nombre d'autres textes importants, en se concentrant notamment sur les questions de politique et de droit internationaux, qu'il avait commencé à aborder à la fin des années 1930. Il n'est pas revenu pour réfléchir à sa période nazie. Bien qu'il ait admis avoir honte de certains de ses écrits avec le recul, il ne s'est jamais distancié de son travail à l'époque. Son objectif était de se postuler rétrospectivement dans le rôle d'un érudit impartial qui se trouvait par hasard au mauvais endroit au mauvais moment.
Bien qu'il n'ait pas été en mesure d'enseigner, il a conservé une influence extraordinaire sur le développement des sciences sociales et juridiques. Des philosophes, écrivains, juristes et politologues de toute l'Europe lui ont rendu visite à Plettenberg. Son cercle de fidèles était vraiment bizarre autant que varié: l'écrivain Ernst Jünger, le philosophe du droit et socialiste Ernst-Wolfgang Böckenförde, qui est d'ailleurs devenu plus tard juge à la Cour constitutionnelle, le philosophe Alexander Kojéve et l'historien de gauche Reinhart Koselleck, le politologue de la droite radicale Armin Mohler, le sociologue Hanno Kestings, Ernst Forsthoff (que nous venons de mentionner), qui s'est rapproché de Schmitt après la guerre, et de nombreux autres intellectuels européens de premier plan issus de divers camps politiques.
Schmitt était estimé comme un expert de premier plan en droit constitutionnel par Hannah Arendt, par exemple, et nombre de ses idées ont même été reprises par le célèbre religieux juif Jacob Taubes lorsqu'il a rédigé des textes programmatiques pour l'aile d'extrême-gauche des leaders étudiants allemands en 1968. Un certain groupe de gauchistes italiens d'après-guerre, admirateurs de Schmitt, ont même été appelés "schmittiens marxistes" par leurs adversaires. Après la publication de La théorie du partisan (1963), son apologie de la résistance de principe à toute domination étrangère, comprise toutefois dans un sens social, lui a valu des adhérents de la gauche maoïste comme de la nouvelle droite.
La question de la réception de la théorie politique de Schmitt dans le milieu conservateur américain est très débattue. Son cas le plus célèbre est le philosophe politique Leo Strauss, l'une des figures centrales de la pensée néo-conservatrice. Dans l'un de ses livres, il a accepté le célèbre concept de Schmitt selon lequel la "politique" est le conflit le plus intensément ressenti le long du fossé entre amis et ennemis. Il accepte son concept, mais rejette en même temps l'antilibéralisme schmittien. Selon Strauss, le réalisme politique de Schmitt devait être combiné avec la pensée du droit naturel, qui était cependant étrangère au penseur allemand. En combinant ces deux éléments, Strauss a réussi à obtenir une base idéologique qui constitue encore aujourd'hui le substrat théorique des théories politiques néo-conservatrices. En effet, même le célèbre "Choc des civilisations" de Samuel Huntington ne nie pas l'influence de la théorie des "grands espaces" de Schmitt.
Et le célèbre enfant de Plettenberg ?
Schmitt lui-même, dans la solitude de Plettenberg jusqu'à sa mort en 1985, a regardé avec satisfaction son influence se répandre dans le monde entier, et a reçu de nombreuses visites de ses adeptes et de ses anciens et nouveaux disciples sans être gêné par leurs différentes orientations politiques. Lorsqu'un ami lui demande, dans une lettre, si, parmi ses élèves, figure le comte Christian von Krockow, le célèbre écrivain et historien allemand, Schmitt répond avec humour, en faisant référence au nom de Krockow : "J'ai parmi mes élèves tout le monde, des communistes et des fascistes, mais pas encore de crocodiles". Bien qu'il soit lui-même resté jusqu'à la fin de sa vie un étatiste conservateur, désireux d'empêcher l'État d'être submergé par les forces sociales, il a souvent toléré chez ses élèves des conclusions exactement opposées à celles auxquelles il était lui-même parvenu.

Il n'a jamais repris l'enseignement, mais il a néanmoins effectué des tournées de conférences à l'étranger pendant longtemps. En tant que philosophe et homme d'État catholique, il a été accueilli avec enthousiasme, notamment dans l'Espagne de Franco, qu'il considérait comme son refuge intellectuel, et où ses livres étaient présentés simultanément avec l'édition allemande. Mais il est ensuite retourné dans sa campagne de Westphalie. Dans les dernières années avant sa mort, il souffrait d'anxiété et était affecté par des délires de persécution, et était en outre hanté par de nombreuses visions, et, selon des témoins, il essayait encore de modifier certaines de ses théories en fonction de celles-ci.
Il est enterré dans le cimetière de Plettenberg. La ville où il a vécu plus de la moitié de sa vie ne veut toujours pas savoir grand-chose de lui, bien qu'il ait été son plus célèbre habitant. Une observation similaire s'applique à la position de Schmitt dans la recherche juridique et politique aujourd'hui : tout le monde le lit, mais si vous voulez vous référer à lui, c'est déjà risqué. La pensée de Schmitt est considérée comme précise, presque brillante, mais en même temps, comme le note Jan-Werner Müller dans le titre du livre qu'il lui a consacré, également très "dangereuse". Pourtant, la question demeure de savoir si ses textes étaient dangereux ou si c'était plutôt ses positions politiques spécifiques qui l'étaient, tout en étant souvent plutôt en contradiction avec le sens de ses livres. Le fait que Schmitt n'ait jamais été loin de telles contradictions a été démontré très tôt dans sa vie personnelle lorsque, en tant qu'auteur catholique ayant laborieusement obtenu une "permission" ecclésiastique pour ses textes, ce qui constituait à l'époque un ajout esthétique plutôt superflu au titre, il a divorcé puis a été excommunié.
Que Schmitt ait été un homme dangereux ou que ses textes soient dangereux, peut importe, car il ne perdra pas facilement sa popularité. Ces dernières années, en effet, il a fait un retour en force, comme en témoigne l'exclamation du célèbre philosophe Jacques Derrida, en 2000, selon laquelle il est nécessaire de "relire Schmitt".
Tiré du site web tchèque de l'Institut civique.
18:07 Publié dans Révolution conservatrice, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : carl schmitt, théorie politique, état, politologie, sciences politiques, philosophie politique, révolution conservatrice, allemagne |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mardi, 09 novembre 2021
Carl Schmitt - Avocat de la Couronne au 20ème siècle
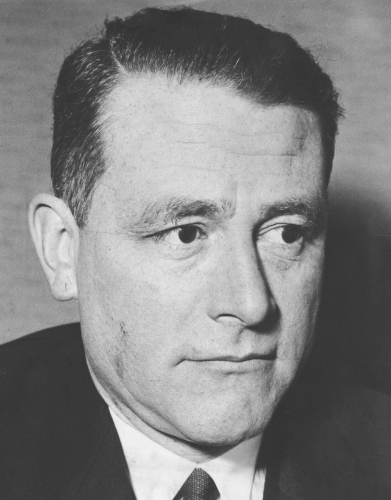
Carl Schmitt - Avocat de la Couronne au 20ème siècle
par Franz Chocholatý Gröger
Ex: https://deliandiver.org/2010/06/carl-schmitt-korunni-pravnik-20-stoleti.html
Le concept de révolution conservatrice apparaît pour la première fois en 1921 dans l'essai L'Anthologie russe de Thomas Mann, un représentant du conservatisme de la République de Weimar, et a été exploré pour la première fois par Armin Mohler dans son ouvrage de 1950 Die Konservative Revolution in Deutschland 1918-1932. Il faut souligner que la Révolution conservatrice n'est pas un mouvement explicitement politique, mais plutôt un mouvement idéologique d'intellectuels conservateurs.
Mohler a divisé le spectre conservateur en cinq groupes de base, auxquels il a attribué des auteurs ou des groupes d'auteurs. Ces groupements sont : le groupe nationaliste (die Völkischen), les jeunes conservateurs (les cerlces de Berlin avec A. Moeller van den Bruck), le groupement hambourgeois des amis de Wilhelm Stapel, le groupement munichois des amis d'Edgar J. Jung, dont j'ai déjà parlé dans les colonnes de Delian Diver), le magazine Die Tat et son rédacteur Hans Zehrer, les révolutionnaires nationaux (le soi-disant nationalisme soldatique représenté par Ernst Jünger et les représentants de tous les groupes paramilitaires) et les groupes moins importants, à savoir la mouvance dite "Bündnisch" (avec Hans Blüher) et le Landvolkbewegung. Un groupe spécifique est constitué de ce que l'on appelle les personnalités, qui, du point de vue de Mohler, brisent les catégories (Oswald Spengler, Thomas Mann, Carl Schmitt, et en partie Hans Blüher et Ernst Jünger) (1).
Laissons de côté les deux groupes, celui de la mouvance Bündisch et la Landvolkbewegung, et les nationaux-socialistes, et prêtons attention à ceux qui sont les porteurs des processus de pensée dominants, soit en tant qu'individu, comme Ernst Jünger, soit dans le duo formé par Othmar Spann et Edgar J. Jung.
Carl Schmitt, l'un des penseurs juridiques et politiques les plus influents du 20ème siècle, est une personne qui traverse ce spectre. Qui était Carl Schmitt ? D'abord critique du positivisme étatique (1910-1916), il devient décisionniste et théoricien de l'État souverain moderne (1919-1932), national-socialiste et professeur de "Pensée d'ordre concret" (Konkrete Ordnungsdenken) (1933-1936) et, convaincu de la fin de l'État souverain, il ébauche une "théorie de l'espace des grandes puissances" (1937-1950) ainsi que la politique du monde techno-industriel (1950-1978). Un poste ou plusieurs postes ? Dans tous les cas, un miroir de ce siècle. Et lorsque ce siècle y voit aussi ce qu'il n'aime pas voir, ce n'est pas seulement la faute du théoricien (2).
Dans ses écrits, Schmitt a exposé une théorie du décisionnisme juridique, a théorisé la primauté des décisions politiques dans l'intérêt de l'État sur l'ordre constitutionnel. L'hostilité à la démocratie libérale a fait entrer Schmitt, d'orientation catholique, dans les milieux de la République de Weimar; il était lui-même généralement hostile à l'establishment républicain, se situant dans les rangs et le cercle des théoriciens de la "révolution conservatrice."

Il est né le 11 juillet 1888 dans une famille de petits commerçants de la ville de Plettenberg, en Westphalie. Il est resté étroitement lié à sa ville natale, située dans l'enclave catholique autour de Münster, jusqu'à la fin de sa vie ; il y a même passé de nombreuses années après la Seconde Guerre mondiale. Il a étudié le droit et les sciences politiques à Berlin, Munich et Strasbourg, où il a obtenu son diplôme en 1910 avec sa thèse Über Schuld und Schuldarten (Sur la culpabilité et les types de culpabilité, sous la direction de Fritz von Calker) dans le domaine du droit pénal, où il a également soutenu sa thèse en 1915 et a été habilité un an plus tard (3). La même année, en tant que volontaire de guerre, il est transféré à la représentation du commandement général à Munich, et en 1919 au commandement de la ville. C'est également à Munich qu'il occupe son premier poste de professeur à la Handelshochschule München, et c'est cette année-là, ou peu avant, qu'il fait la connaissance des poètes Franz Blei, Konrad Weiß, Theodor Däubler. Schmitt, comme le poète Däubler, a compris la modernité comme une époque de perte de la transcendance, comme la lutte de l'esprit contre l'avancée du monde du matérialisme et du capital, de la technologie et de l'économie.
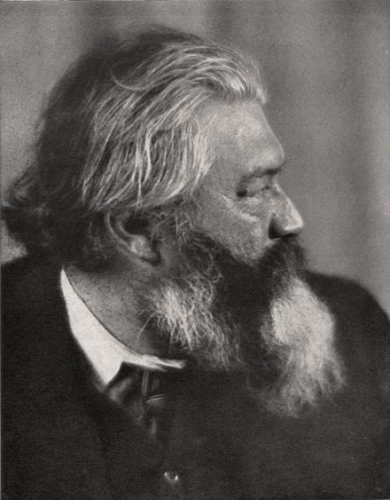
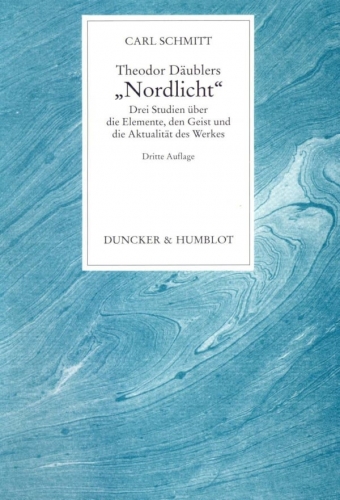
En 1921, il devient professeur à l'université de Greifswald et écrit Die Diktatur. Von den Anfängen des modernen Souveränitätsgedankens bis zum proletarischen Klassenkampf (4). Il y discute des fondements de la République de Weimar nouvellement établie et souligne la fonction du président du Reich. Décider sans discuter, c'est incarner la dictature. Une dictature peut mieux exercer la volonté du peuple qu'une législature car, juge Schmitt, elle peut prendre des décisions sans être contrainte, alors que les parlements doivent débattre et faire des compromis sur leurs actions: "Si l'État est démocratique, alors tout rejet des principes démocratiques, tout exercice du pouvoir de l'État indépendamment du consentement de la majorité, peut être qualifié de dictatorial". Selon Schmitt, tous les gouvernements qui veulent prendre des mesures décisives doivent recourir à un comportement dictatorial. Cet "état d'exception" dispense l'exécutif d'appliquer toute contrainte légale sur son pouvoir qu'il appliquerait dans des circonstances normales. Il distingue deux types de dictatures : la dictature du "commissariat", que l'on trouve chez les Romains, chez Bodin, dans les commissariats des princes absolutistes, ou dans les commissariats populaires de la Révolution française, où elle était commandée par le pouvoir constitutionnel; son but était de préserver la constitution par la suspension temporaire de ses articles. Contre cela, la "dictature souveraine", commandée par le pouvoir constituant, avait pour but, comme la "dictature du prolétariat" ou la dictature de l'Assemblée nationale révolutionnaire de France, de créer une nouvelle constitution à la place de l'ancienne; puisque la dictature "souveraine" dépend formellement de la volonté du commanditaire, elle ne peut être limitée dans son contenu - le phénomène de l'indépendance dépendante (5). En examinant la constitution de Weimar, Schmitt pourrait qualifier son assemblée constituante de "souveraine" et désigner la dictature du président du Reich, en vertu de l'article 48 de la constitution du Reich, comme la dictature de l'"intendance" (6).
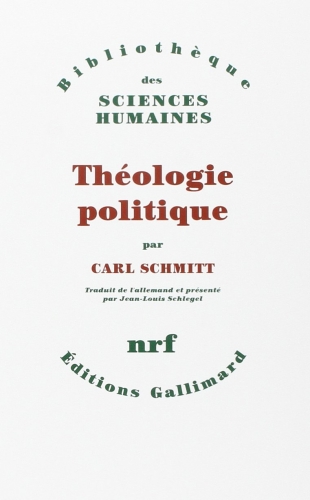
Il serait problématique de savoir ce que ces différents termes sont censés signifier dans le cas d'un consensus constitutionnel qui s'effrite. L'année suivante, il s'installe à l'université de Bonn et publie son livre Politische Theologie. Vier Kapitel zur Lehre von der Souveränität (Théologie politique) avec la célèbre première phrase du livre, "Seul celui qui décide de l'état d'urgence est souverain". La souveraineté est ici associée à l'extrême urgence, et le souverain, selon elle, est celui qui décide dans un cas extrême pour la sécurité et le bien-être public. La compétence souveraine devient ainsi sans ambiguïté indivisible et illimitée, le souverain est un ou personne, et la souveraineté est un monopole de la décision, et celui qui décide souverainement le fait sur la base d'une pure déférence, non révisable par la loi et la norme, puisqu'il décide dans le "néant" normatif (7). Dans ses analyses du "monopole de la décision", il invoque Jean Bodin, le père du concept moderne de souveraineté, comme exemple classique de cette prise de décision "décisionniste" du souverain, où la décision est prise à partir d'un rien normatif, non pas dérivé d'une vérité supérieure, mais de l'autorité du souverain lui-même.
Auctoritas, non veritas facit legem - les lois ne s'appliquent pas sur la base d'un rapport à la vérité, mais sur la base de la reconnaissance - c'est le principe du désaccordisme, ici justifié théologiquement en fin de compte. L'association du décionnisme et de l'état d'exception était cohérente. L'État devient alors, en quelque sorte, le créateur du droit. La "théologie politique" avait sa propre signification chez Schmitt, et une signification qui était interprétée de plusieurs manières. Elle devait être (a) une histoire des concepts, (b) une critique des religions terrestres sécularistes et (c) une théologie de la polis. "Tous les concepts prégnants de la politique moderne sont des concepts théologiques sécularisés" (8). Schmitt voyait encore la théologie et la métaphysique derrière la politique et luttait non seulement contre l'anarchisme et le socialisme athée mais aussi, et avec plus de vigueur, contre le libéralisme en tant qu'adversaire tout aussi politique et métaphysique.
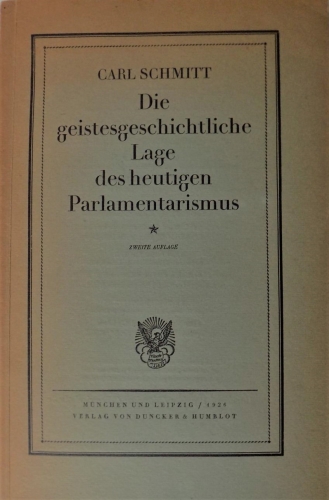
En 1923, il a publié Die geistesgeschichtliche Lage des heutigen Parlamentarismus (L'état spirituel-historique du parlementarisme aujourd'hui), dans lequel il critiquait les pratiques institutionnelles de la politique libérale et soutenait qu'elles étaient justifiées par la croyance en la discussion rationnelle et en l'ouverture. Cependant, ils sont en contradiction avec la politique de parti parlementaire réelle, puisque cette dernière est généralement le résultat d'accords conclus par les chefs de parti lors de réunions à huis clos. Le parlementarisme de l'État civil avait son principe spirituel, son "idée" en public et dans la "discussion" publique (9). Tous deux ont été privés de leur sens dans la démocratie de masse moderne ; au lieu de la libre concurrence des opinions, c'est la propagande qui a pris la place, orientée vers la conquête et le maintien du pouvoir. Le débat politique public est remplacé par la politique secrète des négociations à huis clos. La réalité du parlementarisme ne correspond plus à son "idée". Dans l'histoire, la démocratie n'a pas toujours été associée au seul parlementarisme. Cette alliance a été forgée par une lutte commune contre le monarchisme, dont l'objectif était la social-démocratie. Le césarisme du 19ème siècle a démontré la combinaison de la démocratie plébiscitaire et de la dictature connue depuis l'époque de l'union de la plèbe et de César. "La démocratie est l'identité des gouvernés et des gouvernants" ainsi que "l'homogénéité" et l'union de la démocratie plébiscitaire produite par le consentement tacite des gouvernés ou "acclamation". Cette critique donnait l'impression que le parlementarisme avait été dépassé et n'avait plus qu'un rôle décoratif, "comme si quelqu'un avait peint le radiateur du chauffage central avec des flammes rouges" (10). La Verfassungslehre de 1928 était plus modérée sur cette question.
Schmitt a consacré vingt ansde sa vie à une théorie de la souveraineté étatique, position qu'il renverse avec Der Begriff des Politischen (Le concept du politique) de 1927 (11). " Le concept de l'État présuppose le concept du politique. "Cette première phrase de l'écrit contredit l'identification traditionnelle de la politique et de l'État. L'État a renversé son monopole sur la politique. Le politique se retrouve dans tous les domaines d'action, que ce soit l'économie, la culture, la religion ou la science. Le critère est "la distinction entre ami et ennemi" (12). L'amitié et l'inimitié doivent être considérées comme des concepts politiques ; l'ennemi était un ennemi "public" et non un adversaire personnel. Hostis (polemicus) pas inimicus (echthros). L'ennemi politique ne doit pas être aimé, mais il ne doit pas non plus être haï. On ne peut pas échapper à la politique. C'est un plurivers, pas un univers. Un État mondial établissant la paix pour toujours et éliminant la politique est une contradiction dans les termes. Cependant, même un État mondial n'éliminerait pas la possibilité de guerre civile, et si la guerre civile pouvait être éliminée une fois pour toutes, l'"État mondial" ne serait pas un État, mais une "société de consommation et de production" (13). "Toutes les vraies théories politiques" présupposent "l'homme comme étant mauvais", "mauvais" signifiant théologiquement "pécheur", politiquement "dangereux". La notion de politique a tacitement contourné l'ami. Mais Schmitt parle ailleurs de la cohérence des unités politiques, de l'identité et de l'homogénéité. Le "noyau du politique" n'était pas du tout "l'inimitié", mais la distinction entre ami et ennemi, et présuppose les deux: l'ami et l'"ennemi". Dans le domaine de la politique, les gens ne se situent pas les uns par rapport aux autres dans l'abstrait en tant qu'êtres humains, mais en tant que personnes politiquement intéressées et politiquement déterminées, en tant que gouvernants et gouvernés, alliés ou adversaires politiques, dans chaque cas dans des catégories politiques. Dans la sphère du politique, on ne peut s'abstraire du politique, ne laissant que l'égalité humaine générale ; de même que dans la sphère de l'économique, les gens sont compris comme des producteurs, des consommateurs, donc seulement dans des catégories économiques spécifiques.
En 1926, Schmitt se marie en secondes noces avec la Serbe Duška Todorović; auparavant, il avait été marié à la Serbe Pavla Dorotić de 1916 à 1924. Pour cette raison, il serait excommunié de l'Église catholique. Le juriste et philosophe, qui a été toute sa vie un admirateur enthousiaste du catholicisme en tant que "forme politique" et un précurseur de l'idée de représentation politique, qui a cherché des liens entre la théorie politique et la théologie et qui était considéré comme un auteur typiquement catholique, est donc resté excommunié de la réception des sacrements jusqu'à la mort de sa première femme en 1950. De 1928 à 1933, il travaille à la Handelshochschule de Berlin. En 1930, il rencontre Ernst Jünger et leur amitié dure jusqu'à la mort de Schmitt.
Proche du catholicisme politique et du parti du centre (Zentrumpartei), Schmitt a été conseiller des chanceliers Franz von Papen et Kurt von Schleicher en 1932/1933 et ne s'implique dans leur politique qu'après l'élaboration de plans d'urgence conspiratoires préparés par des officiers de la Reichswehr en septembre et décembre 1932 et en janvier 1933. Le 20 juin 1932, le chancelier Franz von Papen organise un coup d'État dans l'État libre de Prusse, qui a toujours été la république allemande modèle des gouvernements stables du social-démocrate Otto Braun depuis 1920 (dernier 4 avril 1925-20 juillet 1932), et s'est lui-même nommé par le président du Reich commissaire du Reich pour la Prusse en vertu de l'article 48 de la Constitution. Le gouvernement prussien a intenté un recours contre cette décision devant la Cour de justice du Reich. Le 20 juillet 1932, la "mission de la nouvelle Prusse pour assurer et approfondir la démocratie en Allemagne" prend fin, comme le déclare Otto Braun dans sa dernière interview avec von Schleicher. La Prusse cesse de facto d'exister (14).
Le dernier écrit important de la période de Weimar est Legalität und Legitimität (Légitimité et légalité) de 1932. L'ouvrage est, d'une part, une attaque contre la légalité même de la constitution et, d'autre part, un appel à prévenir l'abus éventuel de la légalité à des fins contraires à la constitution. Il discute ouvertement de l'interdiction éventuelle du KPD et du NSDAP et plaide en faveur de cette interdiction. Son analyse mettait en garde, à juste titre en principe, contre le risque d'autodestruction d'une constitution censée être neutre même envers elle-même. Il met en garde la République de Weimar contre la possibilité d'une "révolution légale", c'est-à-dire la possibilité que des partis hostiles au système constitutionnel accèdent au pouvoir par des moyens légaux, excluent les opposants politiques et claquent la "porte de la légalité" derrière eux (15). Il a exhorté le président du Reich Paul von Hindenburg à abolir le NSDAP et à emprisonner ses dirigeants, et il s'est élevé contre ceux qui, au sein du Parti catholique du Centre, pensaient que les nazis pouvaient être contenus s'ils devaient former un gouvernement de coalition.
Participation à la commission Vierer pour la rédaction de la loi du gouverneur du Reich (Reichsstatthalter-Gesetz du 7 avril 1933). Puis, le 1er mai 1933, il adhère au NSDAP (numéro de membre 2.098.860). Dans la période 1933-1936, ses articles paraissent, comme Der Führer schützt das Recht (Le Führer protège le droit, 1934), qui peut être lu comme une tentative de justifier le meurtre d'E. Röhm, ou Die deutsche Rechtswissenschaft im Kampf gegen den jüdischen Geist (La science juridique allemande dans la lutte contre l'esprit juif, 1936), un titre qui parle de lui-même, ont atteint une triste notoriété.
À cette époque, il abandonne la notion de décisionisme, qui fait place à "une pensée concrète de l'ordre et de la formation". A la place de l'antithétique décisionniste, la pensée du trinitarisme est entrée. L'ordre politique était (statiquement) "l'État", (dynamiquement) "le mouvement", (non politiquement) "la nation", et Schmitt, qui jusqu'en 1932 avait été un étatiste, attribuait maintenant le rôle principal au "mouvement". La pensée juridique, qui jusqu'alors était confrontée à l'alternative du "normativisme" ou du "décisionnisme", s'est divisée de manière triadique : "normativisme", "décisionnisme", "pensée concrète de l'ordre et de la formation". "Formation" n'était rien d'autre que ce qui avait été précédemment défini. Le politique est devenu, en référence à la doctrine des institutions d'Hauriou, l'institutionnel (16). La décision jusqu'alors sans restriction s'est révélée être un "épanchement d'un ordre déjà présupposé", et le décisionisme jusqu'alors autosatisfait s'est trouvé en danger de "... par la ponctuation du moment, l'être immobile qui est contenu dans tout grand mouvement politique..." (17).
En 1936, Schmitt est dénoncé dans la revue SS Das Schwarze Korps et dans les Mitteilungen du bureau de Rosenberg : comme catholique, comme ami des Juifs, comme opposant au NSDAP en matière de légitimité et de légalité. Il perd la plupart de ses fonctions politiques universitaires nationales-socialistes, mais reste professeur et conseiller d'État prussien jusqu'en 1945. Ce qu'il a écrit pendant les années du Troisième Reich était ambivalent, oscillant entre l'accommodation et la subversion (18).
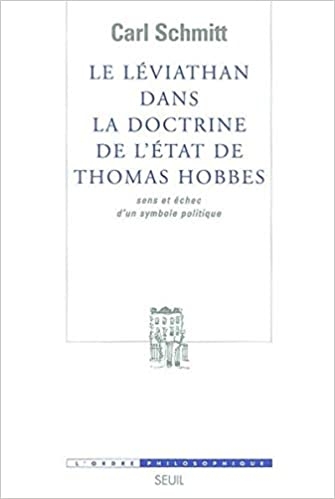 Après 1936, Schmitt s'est présenté comme l'"ami" et le "frère" du grand Thomas Hobbes, et tout comme Hobbes était le géniteur de l'État souverain, Schmitt voulait être le diagnosticien de sa fin. Der Leviathan in der Staatslehre der Thomas Hobbes (1938) de Schmitt a démontré l'"échec" de ce grand symbole. Avec le "Léviathan", que Schmitt interprète de quatre manières : comme un dieu mortel, comme un grand homme, comme une non-créature et comme une machine, Hobbes a tenté d'utiliser la "totalité mythique" du symbole pour restaurer l'unité politico-théologique de l'État qui avait été détruite par la guerre civile religieuse. En faisant de la foi une affaire privée, en séparant la croyance intérieure (fides) et le credo extérieur (confessio), Hobbes a greffé le "germe de la mort" qui a "détruit le puissant Léviathan de l'intérieur et vaincu le dieu mortel" (19).
Après 1936, Schmitt s'est présenté comme l'"ami" et le "frère" du grand Thomas Hobbes, et tout comme Hobbes était le géniteur de l'État souverain, Schmitt voulait être le diagnosticien de sa fin. Der Leviathan in der Staatslehre der Thomas Hobbes (1938) de Schmitt a démontré l'"échec" de ce grand symbole. Avec le "Léviathan", que Schmitt interprète de quatre manières : comme un dieu mortel, comme un grand homme, comme une non-créature et comme une machine, Hobbes a tenté d'utiliser la "totalité mythique" du symbole pour restaurer l'unité politico-théologique de l'État qui avait été détruite par la guerre civile religieuse. En faisant de la foi une affaire privée, en séparant la croyance intérieure (fides) et le credo extérieur (confessio), Hobbes a greffé le "germe de la mort" qui a "détruit le puissant Léviathan de l'intérieur et vaincu le dieu mortel" (19).
À partir de 1939, Schmitt abandonne la catégorie juridique internationale de l'État-nation souverain et la remplace par une doctrine de l'"empire" et de l'"espace des grandes puissances", qui est ambiguë et proche de la politique de l'époque. L'"espace des grandes puissances" est une catégorie de "légitimité historique" qui reflète la fin de la vieille Europe et l'émergence d'un nouvel ordre mondial. Dans Land und Meer (Terre et mer, 1942), Schmitt a étendu la théorie du conflit des puissances mondiales à une théorie de l'ordre moderne des grandes puissances en général. Selon lui, cet ordre des grandes puissances était fondé sur la distinction entre les puissances terrestres et les puissances maritimes et trouvait sa forme concrète dans l'équilibre entre les puissances continentales et la puissance maritime qu'était l'Angleterre. Cet arrangement avait perdu son équilibre ; l'arrangement à venir était incertain, car la technologie et l'industrie ont révolutionné les idées de l'espace, et l'espace organisé selon la distinction entre la terre et la mer est devenu "un champ de force de l'énergie humaine, de l'activité et de la performance humaine".
En 1945, il est arrêté, interrogé et interné à Nuremberg. Il s'est retiré dans la solitude, une sorte d'exil intérieur, et a vécu le reste de sa vie dans sa ville natale de Plettenberg. Il y a écrit un certain nombre d'autres textes importants, dans lesquels il s'est principalement concentré sur les questions de politique et de droit internationaux. La conclusion systématique de la théorie de l'espace des grandes puissances est Der Nomos der Erde (Le Nomos de la Terre), publié en 1950. Schmitt y choisit le terme nomos dans son sens archaïque comme concept de base pour la définition de l'espace, pour le lien entre le droit et l'espace, et pour l'organisation et la localisation de tout le droit. Selon cette théorie, l'histoire de l'ordonnancement existant du monde était l'histoire de l'ordonnancement des espaces ; le droit et la politique pouvaient être déterminés par les pratiques de "prendre", "partager" et "jouir". À l'époque pré-moderne, ces pratiques ont conduit à une organisation pré-globale de l'espace, à l'époque moderne à une organisation globale. L'ordonnancement global de l'espace était initialement eurocentrique en tant que première grande ligne de démarcation entre l'Ancien et le Nouveau Monde (raya, ligne d'amitié). Ces lignes ont été abandonnées au 20ème siècle avec la création des hémisphères, opposant l'Est et l'Ouest. Comme pour la Terre et la Mer, le Nomos de la Terre laissait dans le flou la disposition future de l'espace. Pour Schmitt, qui dès 1929 avait placé la technique comme centre de gravité du 20ème siècle, au terme d'une série de "neutralisations" antérieures de la modernité, s'affirme de plus en plus l'idée que "la technification et l'industrialisation... sont désormais devenues le destin de notre pays". Avec la technologie et l'industrie sont apparus des pouvoirs qui transcendent l'organisation spatiale elle-même et se délocalisent radicalement, des pouvoirs dont la démarcation politique de l'espace n'était pas encore visible"(20).
Il a essayé de montrer ce que signifiait la fin de l'ancien État à l'époque de la technologie en 1963 dans Die Theorie des Partisanen (La théorie du partisan). Pour Schmitt, le partisan est une figure symbolique du 20ème siècle, tout comme Lénine et Mao, Giap ou Che Guevara étaient des symboles ayant un pouvoir de construction du monde. Avec en toile de fond les questions d'espace politique, de relations internationales et les questions de naturel et de contre-nature, Schmitt décrit le développement du mouvement de guérilla depuis ses origines dans la guérilla espagnole contre Napoléon jusqu'à l'époque moderne, analyse les pensées de Clausewitz sur la guérilla et examine l'influence que Lénine, Mao, Staline, Che Guevara et Castro ont eu sur le développement du mouvement de guérilla, soulignant que l'une des caractéristiques fondamentales du guérillero est son engagement politique. Le point de départ ici est la phrase "la guerre, en tant que moyen politique le plus extrême, démontre la possibilité que cette distinction entre ami et ennemi constitue la base de toute idée politique et n'a donc de sens que dans la mesure où cette distinction existe réellement dans l'humanité, ou est au moins réalistement possible". Qu'est-ce qui a prouvé la fin de la guerre-combat et la fin du justus hostis plus que le guerrier qui est devenu un combattant politique luttant contre l'oppression coloniale pour la libération nationale ou la révolution mondiale prolétarienne? Schmitt lui attribue une "légitimité tellurique". Il avait sa légitimité en tant que personne qui se battait encore pour un morceau de terre, qui était "l'un des derniers gardiens du pays" (21). Le Partisan ressemble à bien des égards au partisan spirituel-politique de l'essai Waldgang de Jünger en 1957. "Ennemi" dans cet essai est devenu un concept interprétable d'au moins trois façons. Il fallait distinguer l'"ennemi absolu" de l'hostilité raciale et de classe de l'ennemi "relatif" ou "conventionnel" du partisan, contre lequel on doit légitimement se battre comme un envahisseur en terre étrangère.
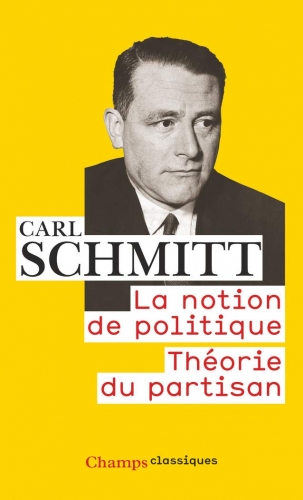
La dernière œuvre majeure de Schmitt est Politische Theologie II. Die Legende von der Erledigung jeder Politischen Theologie (Le concept de la théologie politique II). La théologie politique est pour Schmitt la clé pour comprendre la période moderne. Pour lui, l'époque moderne est "légale" (juridique) mais n'est plus "justifiée" (légitime). Elle se caractérise par une métaphysique des auto-empowerments hybrides, pour lesquels il n'y a pas d'origine, mais seulement une émancipation, plus d'"ovum", plus de "novum".
Bien qu'il ne pouvait plus enseigner, il a conservé une influence extraordinaire sur le développement des sciences sociales et juridiques. Des philosophes, des écrivains, des juristes et des politologues de diverses régions d'Europe se sont déplacés pour lui rendre visite à Plettenberg. Le cercle de ses fidèles était vraiment bizarre : nous y trouvons son ami l'écrivain Ernst Jünger, le philosophe juridique et socialiste Ernst-Wolfgang Böckenförde, plus tard juge à la Cour constitutionnelle, le philosophe Alexander Kojéve, l'historien de gauche Reinhart Kosellek, le politologue de droite radicale Armin Mohler, le sociologue Hanno Kestings et une foule d'autres intellectuels européens de premier plan issus de différents camps politiques. Il a publié pendant 68 ans, de 1910 à 1978. Il est décédé le dimanche de Pâques 1985.
Pouvons-nous l'interpréter uniquement dans la perspective des trois années où il a fait l'apologie de l'injustice ? Ses théories n'étaient souvent pas meilleures que le siècle auquel elles appartenaient. Ne lisons-nous pas Hobbes, Machiavel ou Bodin indépendamment de ce en quoi consistait leur engagement politique réel ? L'histoire du fonctionnement de ses idées n'a pas encore été écrite, et leur interprétation est aussi contestée que son œuvre elle-même. Schmitt lui-même, dans la solitude de Plettenberg jusqu'à sa mort en 1985, a vu avec satisfaction son influence se répandre dans le monde entier, recevant de nombreuses visites de ses admirateurs et de ses disciples anciens et nouveaux, sans se soucier de leurs différentes orientations politiques.
Notes :
(1) Urválek Aleš a kol., Dějiny německého a rakouského konzervativního myšlení, Nakladatelství Olomouc. 2009, s.243-244
(2) Ottmann Hennig , Carl Scmitt, in: Ballestren Graf Karl, Ottmann Hennig, Politische Philosophie des 20. Jahrhunderts,. Oldenbourg Wissenschaftsverlag München 1990, s.62
(3) Schmitt, C., Über die Schuld und Schuldarten. Breslau 1910.
(4) Die Diktatur. Von dem Anfängen des modernen Souveränitätsgedankens bis zum proletarischen Klassenkampf, München /Leipzig 1921
(5) Die Diktatur. Von dem Anfängen des modernen Souveränitätsgedankens bis zum proletarischen Klassenkampf, Auflage 1978. S.144
(6) Die Diktatur. Von dem Anfängen des modernen Souveränitätsgedankens bis zum proletarischen Klassenkampf, Auflage 1978. S.240
(7) Politische Theologie. Vier Kapitel zur Lehre von der Souveränität, ,2. Auflage 1934, S. 20, S.42
(8) Politische Theologie. Vier Kapitel zur Lehre von der Souveränität, ,2. Auflage 1934, S.49
(9) Die geistesgeschichtliche Lage des heutigen Parlamentarismus, Auflage, Berlin 1979 S.43
Pozice dnešního parlamentarismu s hlediska dějin ducha, in.: Urválek Aleš a kol., Dějiny německého a rakouského konzervativního myšlení, Nakladatelství Olomouc. 2009, česky překlad str.8-11,34- 38,62-63,81-84.88-90 vydání Die geistesgeschichtliche Lage des heutigen Parlamentarismus z r.1996 (1923)
(10) Die geistesgeschichtliche Lage des heutigen Parlamentarismus, Auflage, Berlin 1979 S. 35, S. 14, S:22. S.10
(11) Der Begriff des Politischen, v: Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik 58 (1927), S. 1-33, Berlin 1928.
Česky: Pojem politična, OIKOYMENH, CDK Praha Brno 2007 ISBN 978-80-7298-127-42007
(12) Der Begriff des Politischen, München / Leipzig 1932,S.26
(13) Der Begriff des Politischen, München / Leipzig 1932,S.50
(14) Ballestren Graf Karl, Ottmann Hennig, Politische Philosophie des 20. Jahrhunderts,. Oldenbourg Wissenschaftsverlag München 1990 S. 72, S.86
Schoeps Hans-Joachim, Dějiny Pruska, Garamond 2004, ISBN:80-86379-59-0 S.245
Moravcová Dagmar, Výmarská republika,Karolinum Praha 2006 S.195
(15) Legalität und Legitimität, Berlin 1968. S.50 n
(16) Staat, Bewegung, VOlk. Die Dreigliederung der politischen Einheit, 2. Auflage 1934 S.12, S. 55 n
(17) Ober die drei Arten des rechtswissenschaftlichen Denkens, Hamburg 1934. S. 35 , S. 8
(18) Ballestren Graf Karl, Ottmann Hennig, Politische Philosophie des 20. Jahrhunderts,. Oldenbourg Wissenschaftsverlag München 1990, S.73-74
(19) Der Leviathan in der Staatslehre des Thomas Hobbes. Sinn und Fehlschlag eines politischen Symbols, Ko1n 1982. S. 31, S. 86
(20) Ballestren Graf Karl, Ottmann Hennig, Politische Philosophie des 20. Jahrhunderts,. Oldenbourg Wissenschaftsverlag München 1990, S.76
(21) Theorie des Partisanen. Zwischenbemerkung zum Begriff des Politischen,; 2. Auflage 1975 s.74
Převzato ze stránek Náš směr.
16:35 Publié dans Droit / Constitutions, Philosophie, Révolution conservatrice, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : carl schmitt, révolution conservatrice, allemagne, république de weimar, philosophie, philosophie politique, politologie, sciences politiques, théorie politique |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
dimanche, 07 novembre 2021
Diego Fusaro : "Plus que Gramsci, nous vivons aujourd'hui dans une hégémonie subculturelle"

Diego Fusaro : "Plus que Gramsci, nous vivons aujourd'hui dans une hégémonie subculturelle"
Propos recueillis par Francesco Subiaco
Ex: https://culturaidentita.it/diego-fusaro-altro-che-gramsci-oggi-viviamo-unegemonia-subculturale/
Révolutionnaire, humaniste, national-populaire. Il s'agit d'Antonio Gramsci, l'un des plus grands penseurs du vingtième siècle qui, dans ses Cahiers de prison, a réalisé une réforme humaniste du marxisme, rompant avec tout déterminisme et tout mécanisme. Il a affirmé que l'histoire sans les hommes ne progresse pas. Retour à la culture humaniste, à la vision révolutionnaire de la culture et de l'école dans la formation d'un nouveau Léonard de Vinci, capable de dépasser l'atomisme et la spécialisation entomologique de l'homme contemporain. Une philosophie de la praxis qui poursuit le projet d'une hégémonie fondée sur le lien sentimental entre le peuple et l'élite, le national et le populaire, qui est bien représenté dans le nouveau livre de Diego Fusaro (Bentornato Gramsci, La nave di Teseo, pp. 362, 18 euros). Une grande exégèse du penseur sarde qui devient la clé de voûte pour interpréter notre société et décoder les relations de pouvoir inhérentes aux fictions de la société de consommation.
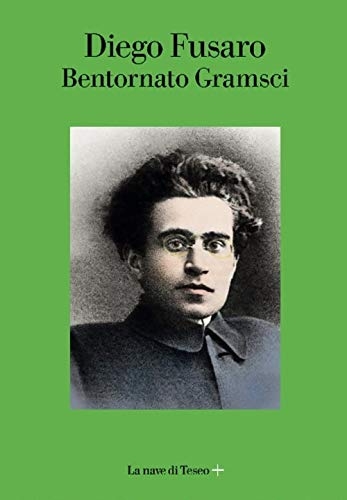
Qu'est-ce qui rend la pensée de Gramsci si actuelle à notre époque ?
À mon avis, il est particulièrement actuel pour diverses raisons, mais surtout sur le plan ontologique, car il déconstruit la mystique néolibérale de la nécessité, cette vision selon laquelle le monde est dépourvu d'alternatives, mais d'une positivité morte, qu'il faut accepter comme un rapport de force donné et indiscutable. Alors que pour Gramsci, toute vision est le produit d'un processus, d'une praxis, d'une histoire en cours. Défataliser l'existant et lui redonner la dimension du possible et de la volonté transformatrice.
Quelle est la principale différence entre la vision du monde libérale-progressiste, qui se développe à travers le politiquement correct, et la vision gramscienne ?
Gramsci a théorisé le concept d'hégémonie parmi de nombreux autres concepts fondamentaux dans les Cahiers de prison. L'hégémonie est la domination plus le consentement. C'est-à-dire une domination qui s'exerce par le biais du consentement et de la culture. Aujourd'hui, cependant, nous vivons dans une hégémonie subculturelle, qui n'utilise pas l'hégémonie culturelle comme celle de l'idéologie bourgeoise et libérale du début du vingtième siècle, mais une subculture faite de spectacle médiatique et d'annulation de la culture. Qui s'exerce en niant l'idée même de culture par le politiquement correct, ce qui se traduit par une culture éthiquement corrompue et annulée.
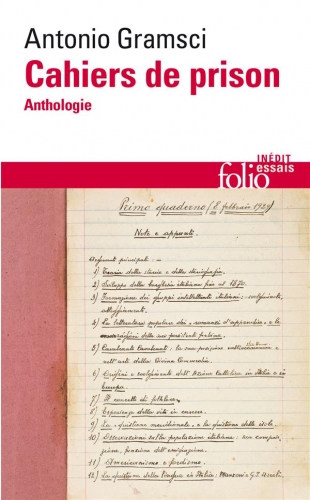
Le politiquement correct est-il la superstructure du monde néo-capitaliste global ?
Il se présente certainement comme la superstructure du monde global. Il procède à la sanctification idéologique des relations installées par le capitalisme financier. Il doit lutter contre toute souveraineté nationale, en la dénigrant jusqu'à la définir comme fascisme et ce, à ses propres fins, il doit ensuite détruire la famille en brisant tout lien social pour ne créer que des consommateurs, en délégitimisant la famille comme étant d'emblée homophobe, paternaliste et sexiste, tout cela se fait par le biais du politiquement correct. Qui devient ainsi le sanctificateur de l'immigration massive, ou de la déportation massive, qui par humanitarisme légitime le trafic de nouveaux esclaves qui deviennent des travailleurs très bon marché exploités par le capital.
Quelle est la relation entre Gramsci et Marx et quelle partie du marxisme le philosophe des Cahiers de prison examine-t-il ?
La grandeur de Gramsci dans sa lecture de Marx est de le libérer des scories du naturalisme, du fatalisme. Le montrant comme une ligne de faille sismique entre l'idéalisme allemand et le positivisme anglo-saxon. Gramsci développe chez Marx la composante de la praxis, celle des thèses de Feuerbach, de l'idéalisme. Qui abandonne le déterminisme au nom d'une vision de l'histoire faite par les hommes. Montrer la Révolution d'Octobre comme une révolution contre le capital, à la fois dans le sens d'une révolution anticapitaliste, et comme une révolution volontariste contre la vision capitaliste de Marx dans Das Kapital.
Gramsci a réformé Hegel, s'éloignant de l'actualisme pour se rapprocher d'une philosophie de la praxis. Qu'est-ce que Gramsci entend par une philosophie de la praxis et dans quelle mesure est-elle éloignée de la vision de Gentile ?
La thèse que j'ai développée dans mon livre est que le marxisme de Gramsci est un marxisme d'actualité. L'idée de l'essentiel comme praxis a un lien profond avec la philosophie de Gentile, car l'acte de penser est proprement réel. Il met en avant une philosophie de l'acte impur, par opposition à l'acte pur de la pensée du Gentile. Une vision qui ramène la philosophie dans le concret et le réel. Car, comme je le dis dans le livre, Gramsci est à Gentile ce que Marx est à Hegel.
14:22 Publié dans Entretiens, Livre, Livre, Philosophie, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, antonio gramsci, diego fusaro, italie, livre, marxisme, gramscisme, philosophie, philosophie politique, théorie politique, politologie, sciences politiques |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mardi, 02 novembre 2021
Décision et souveraineté (Carl Schmitt)
18:10 Publié dans Philosophie, Révolution conservatrice, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : carl schmitt, révolution conservatrice, allemagne, république de weimar, décisionnisme, philosophie, philosophie politique, politologie, sciences politiques |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
samedi, 30 octobre 2021
Introduction à l'idée d'une révolution conservatrice
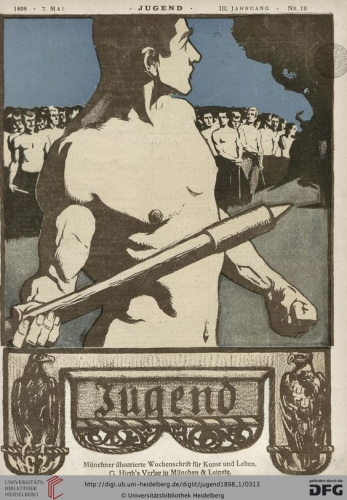
Introduction à l'idée d'une révolution conservatrice
"La révolution n'est rien d'autre qu'un appel du temps à l'éternité." - G.K. Chesterton
Par Diego Echevenguá Quadro (2021)
Ex : https://www.osentinela.org/introducao-a-ideia-de-uma-revolucao-conservadora/
Dans le domaine de la philosophie politique contemporaine, il est considéré comme acquis qu'il existe une affinité immédiate entre les libéraux et les conservateurs. Les premiers se définiraient par leur appréciation des libertés individuelles (économiques, politiques, idéologiques, religieuses, etc.) et leur rejet catégorique de l'intervention de l'État dans les affaires privées des citoyens ; les seconds se reconnaîtraient par leur attachement à la tradition, aux coutumes consolidées, aux mœurs établies par le bon sens et la religion, et par leur scepticisme à l'égard des projets politiques globaux. Ainsi, libéraux et conservateurs s'allient chaque fois que l'individu est menacé par des tentatives politiques de transformation radicale des conditions sociales établies. Conservateurs et libéraux se donneraient la main face à la crainte que tout bouleversement radical ne détruise la tradition ou la figure stable de l'individu libéral. De ce point de vue, il nous semble impensable qu'une telle alliance soit réalisable et victorieuse ; car la peur ne peut servir de lien solide qu'à des enfants effrayés dans une forêt la nuit, mais jamais à des hommes et des frères d'armes qui se réunissent dans une taverne pour boire et rire en racontant leurs faits et gestes sur le champ de bataille.
Il nous semble clair que la véritable fraternité dans les armes et dans l'esprit n'est pas entre libéraux et conservateurs, mais entre radicaux révolutionnaires et conservateurs. Au premier abord, un esprit fixé par la pâle lueur des idées fixes pourrait rejeter une telle alliance comme une simple rhétorique qui utilise la contradiction entre des termes opposés comme moyen de mobiliser l'attention au-delà d'une proposition sans contenu substantiel. Mais ce n'est pas le cas. En fait, il s'agit ici d'une alliance spirituelle forgée par la dynamique même qui représente le mouvement de toute vérité révélée dans le monde. Prenons l'exemple du christianisme. Au moment de son énonciation, le christianisme apparaît comme la négation concrète de tout le monde antique, de toute vérité établie jusqu'alors et reconnue comme le visage légitime de ce qui est devenu le monde social. Dans sa révélation, le christianisme est la négation déterminée de l'antiquité ; en ce sens, il ne peut être qu'une véritable révolution. Ce que même le conservateur le plus effrayé ne peut refuser. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Une fois énoncée, toute vérité nouvelle comme celle d'un enfant doit être conservée et protégée afin qu'elle grandisse et que, dans sa maturité, elle réclame ce qui lui revient de droit.
Dans ce deuxième moment, toute vérité devient conservatrice, car elle cherche à sauvegarder les conquêtes qui émanent de son cadre énonciatif originel. Nous voyons ainsi la communauté horizontale des disciples se transformer en la hiérarchie verticale de l'église, avec ses prêtres comme gardiens spirituels de la foi et ses soldats comme bras armé de la vérité qui lacère la chair pour que l'esprit ait son berceau. Il n'y a rien à critiquer dans ce mouvement. Nous devons l'accepter comme la dialectique nécessaire de toute vérité qui mérite son nom. Il y a autant de beauté dans un sermon du Christ que dans les armées qui marchent sous le signe de la croix et qui utilisent l'épée pour préserver la poésie de ses paroles.
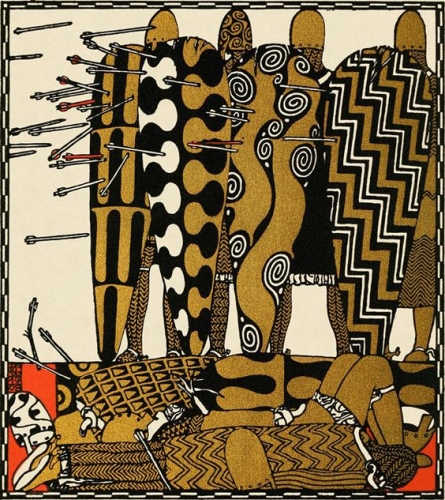
NOTE DE L'ÉDITEUR : Le Mouvement révolutionnaire conservateur ou Révolution conservatrice était un mouvement allemand guidé par le conservatisme nationaliste, qui a pris de l'importance après la Première Guerre mondiale. L'école de pensée des conservateurs révolutionnaires prône une synthèse entre un "nouveau" conservatisme et un nouveau nationalisme (spécifiquement allemand ou prussien), ainsi qu'un nationalisme ethnique axé sur le concept de Volk ("peuple" et "nation" en allemand). À l'instar d'autres mouvements conservateurs de la même époque, ils ont tenté d'endiguer la marée montante du libéralisme et du communisme.
Nous voyons ainsi que la révolution et la conservation sont deux moments d'un même mouvement : celui de la vérité qui arrache le voile du temple et érige ensuite les cathédrales. Dans cette perspective, rien ne nous semble plus erroné que de lier le conservatisme au rationalisme bien élevé du libéralisme, ou au scepticisme politique de la tradition britannique. Et nous explicitons ici ce qui nous semble être la vérité la plus incontestable de ce que représente l'unité entre conservatisme et révolution : la défense de l'absolu. Il est inacceptable que le conservatisme soit laissé à ceux qui l'imaginent comme l'expression de la retenue épistémique et existentielle face à la nouveauté ; car le conservatisme n'est pas et ne sera jamais la défense paresseuse de la tradition et de l'ancien qu'il faut préserver parce que c'est le sceau que l'utilité a conféré à l'habitude. Le conservatisme est la défense du nouveau, de l'actuel et du présent, parce qu'être conservateur, c'est défendre l'éternité sans aucune honte et sans aucune pudeur. Et parce que l'éternité est l'expression temporelle de l'absolu, le conservatisme est la glorification du présent, car l'éternel n'est ni l'ancien ni le vieux, mais le nouveau et le vivant comme l'artère qui pulse et pompe le sang dans le monde matériel.
Mais qu'en est-il des révolutionnaires ? Seraient-ils des défenseurs de l'éternité et de l'absolu ? La tradition révolutionnaire ne serait-elle pas l'expression ultime de tout refus de la transcendance, du sacré et de l'éternel ? Comme l'ont souligné de bons penseurs conservateurs, il existe un noyau sotériologique, gnostique et mystique qui place la pensée radicale socialiste dans le tronc judéo-chrétien. Le marxisme n'est pas la négation abstraite du christianisme, mais son fils prodigue dont le père attend le retour avec un banquet à rendre Dieu lui-même jaloux. Et nous devons nous rappeler que la prétention hégélienne d'unir le sujet et l'objet, l'individu et la société, l'esprit et le monde est la manifestation ultime de l'absolu dans le domaine de la philosophie. Une vision qui cherche finalement à concilier immanence et transcendance, dans ce que nous pourrions appeler l'eucharistie spéculative de la raison. Et c'est cette compréhension qui est l'âme du marxisme.
Après avoir défini ce qui unit les conservateurs et les révolutionnaires, il nous reste à comprendre ce qui et contre qui ils se sont rangés. Et leur ennemi commun est le matérialiste de supermarché, le libéral athée et irréligieux, l'arriviste borné dont l'haleine empoisonne tous les esprits humains depuis que ses ancêtres ont rampé des égouts du Moyen Âge jusqu'au centre financier de la bourse des grandes capitales du monde sous le règne de l'antéchrist.
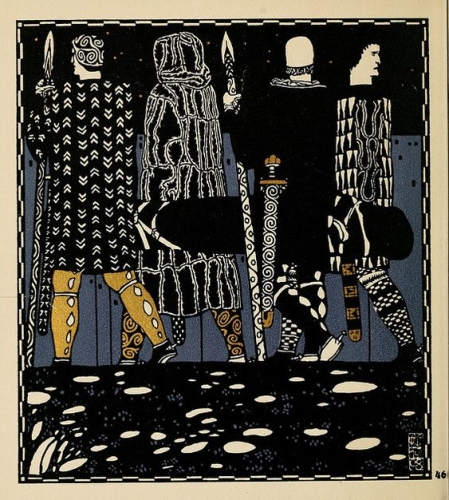
Nous devons ici nous tourner vers la définition de la société libérale comme une société ouverte telle que présentée par Karl Popper. Les sociétés ouvertes sont des formes sociales déterritorialisées, sans aucune affiliation traditionnelle aux racines du sol, de la culture, de la famille, des logos. Sans aucune forme d'appartenance stable de la part de leurs individus. Des individus qui sont l'expression ultime de la substance élémentaire de toute vie sociale ; de pures formes procédurales planant spectralement dans l'éther, libres de toute détermination culturelle, symbolique, spirituelle et biologique. Ces sociétés sont la réalisation même de toute négation de l'absolu, puisqu'elles n'admettent aucune causalité dans l'action des sujets qui ne soit pas guidée par leur intérêt rationnel à maximiser leur confort, leur bien-être et leur ventre déjà bien rempli. Une telle société est la négation de l'animal politique grec, du citoyen, du philosophe, du saint, du guerrier et des amoureux qui ne contemplent comme objet que l'Absolu qui déchire leur chair et les propulse au-delà d'eux-mêmes. L'intérêt personnel éhonté du libéral l'empêche de risquer sa vie pour autre chose que de mourir comme un idiot dans la file d'attente d'un magasin pour acheter l'appareil imbécile du moment.
C'est contre l'empire des sociétés ouvertes que les révolutionnaires et les conservateurs prennent les armes. C'est par amour de l'absolu qu'ils s'assoient à la table et partagent leurs sourires, leurs angoisses et leurs larmes. Un libéral ne pleure jamais. Il n'y a pas de larmes dans un monde d'objets remplaçables et interchangeables. Il n'y a pas de pertes dans le capitalisme. Il n'y a que des gains. Le libéral ne comprendra donc jamais ce qu'il a perdu. Il ne comprendra jamais qu'il a échangé l'Absolu contre un écran d'ordinateur. Seuls les révolutionnaires et les conservateurs savent pleurer, car ils pleurent pour l'absolu. Leurs larmes seront le nouveau déluge qui couvrira la terre et noiera ceux qui n'ont pas l'esprit des poissons et des navigateurs. Car ce sont les navigateurs qui découvrent de nouvelles terres, de nouveaux continents et de nouvelles géographies. Et ce seront les révolutionnaires et les conservateurs qui jetteront l'ancre sur de nouveaux rivages, de nouvelles îles et de nouveaux territoires. Car ils habitent sous les latitudes de l'absolu. Et ce sera une révolution conservatrice - une fraternité non encore imaginée - qui mettra fin aux sociétés ouvertes et à leur cortège de banquiers, de marchands, de gestionnaires, de spéculateurs et de propriétaires.
12:22 Publié dans Définitions, Révolution conservatrice, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : définition, révolution conservatrice, philosophie, philosophie politique, théorie politique, politologie, sciences politiques |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
L'Etat vrai selon Platon
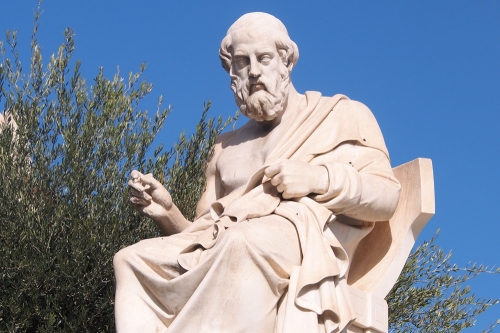
L'Etat vrai selon Platon
Par Giorgio Freda
Ex: https://www.osentinela.org/
"Nous croyons qu'il faut rendre l'État heureux non pas en convertissant en heureux au sein de l'État quelques individus, considérés sous une forme séparée et singulière, mais l'État dans son ensemble." (Politeia, 420c)
Les modernes attribuent à la justice un fondement exclusivement moral.
Sur la base d'un tel caractère, ils ont converti la justice en une valeur du monde moral, en un commandement de la conscience, situé in interiore homine.
Une fois rompue la relation analogique entre le monde divin et le monde humain, le monde divin a perdu le caractère concret de réalité naturelle que les anciens lui attribuaient et, par conséquent, l'humain a été privé de sa dimension divine. Il en est résulté une fracture entre les deux ordres, et la chute progressive de leur caractère divin - converti en éléments moraux - dans le monde de la conscience, d'une part, et l'absolutisation de l'humain, réduit à des termes profanes et "séculiers", d'autre part.
Ce n'est pas entièrement à cause de la virulence du christianisme que cette unité originelle a été brisée ; le christianisme a plutôt été la conséquence d'un processus de dissolution - ou, mieux encore, d'effondrement qui s'est produit dans les deux entités - une dissolution qui lui préexistait néanmoins. L'apparition du christianisme a signifié, dans un certain sens, la "prise de conscience" de la crise, la représentation, insérée en termes d'habeas théologique, d'un état d'esprit qui assumait lentement de telles caractéristiques, au moins depuis quelques siècles avant son arrivée.
Ce n'est pas le lieu - et nous ne sommes pas suffisamment qualifiés - pour déterminer les phases du passage d'une affirmation objective, "nue" et active de la valeur-justice, à son internalisation émotive, moralisatrice et passive dans la conscience humaine : nous croyons suffisant pour notre propos de partir de l'hypothèse que la sensibilité classique n'admettait aucun hiatus entre le monde des valeurs et le monde politique, entre la sphère de la conscience morale et le plan des principes politiques, ce hiatus étant une conséquence qui est devenue inhérente aux conceptions des modernes, et qu'il serait illicite de le rapporter aux anciens, si le caractère abstrait, que les termes d'une telle séparation trahissaient pour eux, n'était mis en évidence.
Par conséquent, il est arbitraire par rapport à la conception classique de distinguer la justice entre justice "individuelle" et justice "sociale": pour Platon, il y a une justice-idée, une justice-valeur, qui s'applique aussi bien à l'âme individuelle qu'au corpus étatique.
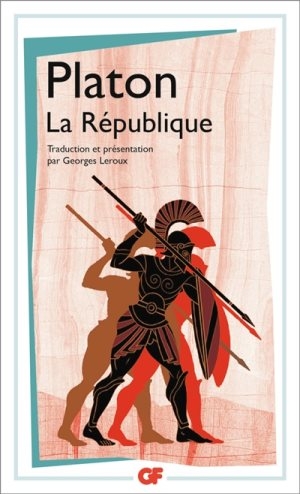 La justice est une valeur qui est réalisée par les citoyens dans leur ensemble selon un parallélisme absolu avec la réalisation de la même chose de la part de l'âme individuelle: la politique est donc "le soin de l'âme" et ce qui prend soin de la santé de l'âme, prend également soin de "la polis elle-même".
La justice est une valeur qui est réalisée par les citoyens dans leur ensemble selon un parallélisme absolu avec la réalisation de la même chose de la part de l'âme individuelle: la politique est donc "le soin de l'âme" et ce qui prend soin de la santé de l'âme, prend également soin de "la polis elle-même".
Ainsi, dans le Gorgias, Socrate appelle "politique" l'art qui prend pour objet l'âme: c'est la conception classique pour laquelle le lieu naturel de l'homme est l'État et non l'individu, et les structures politiques n'ont pas non plus d'existence autonome en soi, mais toutes deux sont animées par une tension qui les organise et les intègre nécessairement.
Pourtant, au IVe siècle, on assiste à l'émergence d'un état d'esprit individualiste qui, sous l'influence de nouvelles exigences et des recherches sophistiques, tend à opposer à la sphère des intérêts et des besoins individuels l'activité de la polis, que ces intérêts tentent d'inclure dans le cadre coercitif de la loi ; même si l'antithèse nature-droit est apparue presque comme un leitmotiv dans la recherche sophistique, l'âme grecque devait rester - dans son essence et malgré ces "incertitudes" - ancrée à cette identité naturelle de l'individu et de l'État, qui fonctionnait pour elle à la manière d'un canon normatif.
Pour Socrate aussi en effet, la science de l'humain signifie l'investigation et la connaissance de l'homme intégral, dans son aspect individuel et dans son aspect politique : c'est seulement la perspective selon laquelle l'homme - objet unitaire et identique dans ses aspects - est assumé qui change.
A travers cet aspect de l'influence socratique, nous pouvons comprendre comment Platon, dans la mesure où il tend à rechercher le meilleur modus vivendi, la connaissance de ces principes qui induiront chez l'homme la possession de la sagesse, entreprend de la même manière de déterminer la meilleure forme d'Etat, l'Etat parfait, dont le but suprême est le "bonheur".
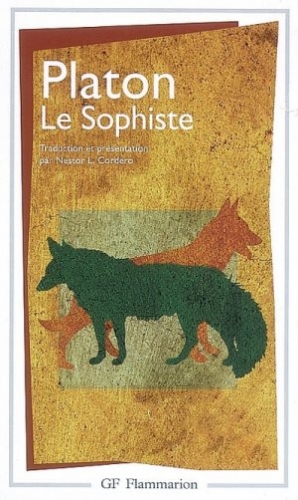 Il s'agit maintenant de développer la prémisse initiale de l'inséparabilité entre la "morale" et la politique ou, si l'on préfère, entre l'éthique individuelle et l'éthique "sociale", c'est-à-dire de souligner comment les deux termes, dans la double existence que nous leur prêtons, n'ont pas de réalité authentique selon l'œuvre de Platon, puisque la justice individuelle ne prend pas un sens proprement "moral" et que le régime platonicien, en outre, ne comporte pas les éléments profanes et temporels que le citoyen moderne attribue nécessairement à l'État. Il s'agit donc de rendre raison de la correspondance analogique entre l'individu et l'État dans la détermination platonicienne de la justice.
Il s'agit maintenant de développer la prémisse initiale de l'inséparabilité entre la "morale" et la politique ou, si l'on préfère, entre l'éthique individuelle et l'éthique "sociale", c'est-à-dire de souligner comment les deux termes, dans la double existence que nous leur prêtons, n'ont pas de réalité authentique selon l'œuvre de Platon, puisque la justice individuelle ne prend pas un sens proprement "moral" et que le régime platonicien, en outre, ne comporte pas les éléments profanes et temporels que le citoyen moderne attribue nécessairement à l'État. Il s'agit donc de rendre raison de la correspondance analogique entre l'individu et l'État dans la détermination platonicienne de la justice.
Selon Platon, de même que la justice chez l'homme est la relation qui intègre harmonieusement les trois degrés de la vie individuelle et s'établit comme la vertu qui renforce et unit la sagesse, le courage et la tempérance, de même, dans l'État, elle est déterminée comme l'élément qui lie et coordonne les trois castes, vues sous le profil des fonctions qu'elles exercent. Il considère que l'élément fondamental de l'être humain est constitué par l'âme et, d'autre part, ce qui revêt une plus grande importance dans l'activité humaine est la politique, c'est-à-dire tout ce qui concerne le fonctionnement organique de la cité. L'âme humaine et la société étatique ont la même structure: dans les deux cas, la même cause produit le même effet. C'est pourquoi l'injustice n'est pas seulement une forme particulière de désordre, mais le désordre lui-même dans ce qu'il apporte de plus dangereux et de plus caractéristique, affectant aussi bien l'État que l'âme humaine lorsqu'une caste ou une des facultés de l'âme, au lieu de rester à la place que la nature lui a assignée, développe une fonction qui ne lui est pas propre. De même que l'âme injuste est celle où il n'y a pas de subordination des autres facultés à la nous, dont le rôle est de conduire l'homme vers la réalisation du Bien ; de même la cité injuste est celle où l'autorité n'est pas exercée par les philosophoi, c'est-à-dire par ceux qui possèdent exclusivement la connaissance du Bien.
Mais l'affirmation selon laquelle les mêmes caractéristiques différentielles sont placées dans l'individu au même endroit que dans l'État, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'un seul problème d'injustice et que le même problème est formulé à la fois pour l'individu et pour l'État ; que de simples "applications" parallèles de la justice - en soi unitaire - s'expriment sur les deux plans: cette affirmation n'est pas démontrée par Platon. Il ne formule pas le problème de vérifier si les supports de cette injustice, représentés respectivement par l'individu et l'État, sont susceptibles d'être opposés l'un à l'autre. La question à régler est constituée par lui par la délimitation des éléments substantiels de la justice, non des termes formels auxquels elle est inhérente.
Que la justice, en effet, étant érigée en canon normatif pour l'homme, doive se présenter dans la même mesure aussi pour l'État et vice versa, est une donnée que Platon accepte "naturellement", comme un présupposé: un présupposé qui n'est pas converti en termes de démonstration, non pas parce qu'il est indémontrable comme principe de raisonnement, mais précisément à cause de l'objectivité spontanée avec laquelle sa reconnaissance s'impose. Nous avons déjà vu au passage - de manière encore incomplète - comment l'idée de faire adhérer l'individu au " régime politique ", de construire une relation entre l'être individuel et l'État, a été reconnue de manière tout à fait naturelle par les Grecs anciens.
En effet, les Grecs ont spontanément accepté la conception selon laquelle l'éthique individuelle est liée à l'organisme politique, ainsi que le principe selon lequel les deux entités se déterminent mutuellement dans une relation de coordination réciproque.
Il convient donc de répéter que dans la polis antique il n'y a pas de solution dualiste entre l'individu et la cité, ni l'individu ni la cité n'ont une existence conclue dans des fonctions et des limites spécifiques et en tant que telles exclusives: il y a le citoyen qui est l'homme inséré dans la cité et il y a la cité qui est la cité du citoyen.
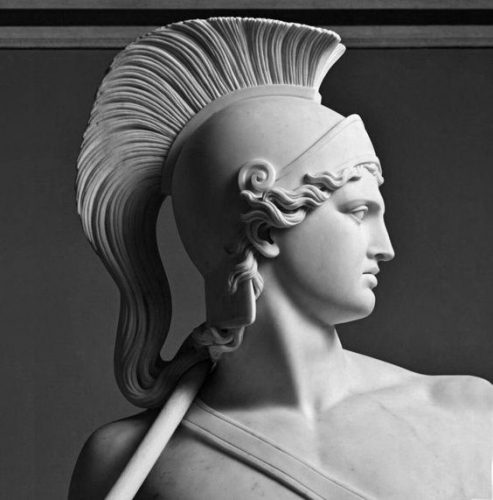
Pour revenir à Platon, sur la base de cette prémisse, il est nécessaire de souligner que l'analogie ne constitue pas l'élément d'une investigation "originale" concernant le philosophe, mais qu'elle se réfère plutôt à une tendance dominante dans le monde grec. Platon n'avait pas besoin de rechercher l'identité "formelle" homme-état, puisque pour lui le problème ne se posait pas, les termes n'ayant pas le même caractère dual que celui que leur accordent les modernes.
En effet, lorsque Socrate, dans la Polythéa, propose de transférer l'enquête sur la justice du niveau spirituel au niveau étatique, personne ne formule d'objection, puisque le transfert est considéré comme légitime: puisqu'il ne s'agit pas d'un changement de substance, mais d'un changement de plan, de perspective, d'angle de vision.
De Platon, à son tour, émerge l'intensification d'un tel présupposé unitaire, ce qui rend l'analogie encore plus évidente lorsque le présupposé devient distinct dans ses composantes. L'identité qualitative de l'homme avec la société politique induit en effet un lien étroit entre organisme individuel et organisme étatique : les deux entités ayant "la même structure, les mêmes besoins, le même principe d'organisation", puisque pour Platon la cité est un être vivant. Platon est explicite à ce sujet, en développant la comparaison selon laquelle l'État et l'individu présentent les mêmes caractéristiques : avec la différence que celles de la cité sont écrites dans des dimensions plus grandes et que la lecture en ressort plus facilement. L'État n'est donc rien d'autre que "l'image magnifiée" de la personne, et tout comme l'essence de la personne est ordonnée par la Vertu qui donne l'harmonie aux autres vertus, l'État est également fondé sur le même principe. L'État est, en somme, la personne elle-même, il constitue son âme au sens large, de sorte qu'il existe une certaine relation d'altérité entre le citoyen et l'État : en plaçant l'État comme image de l'âme individuelle à un niveau différent et par les vertus de l'âme possédant des valeurs éthiques et politiques en même temps.
Surtout, à partir du livre IV du Polythea, cette continuité de nature entre l'individu et l'État émerge, de sorte que - comme on l'a souligné plus haut - le passage du niveau de l'éthique à celui de la politique, plus qu'un passage véritable et propre, est une mise sous les différents angles de vision.
On voit ainsi que Platon ne se préoccupe pas de formuler un plan de " constitution " politique, mais de déterminer les " vertus " mises en avant comme fondement de l'État, et il est symptomatique que lorsqu'il veut donner une image générale de la Polyphée, il la définit comme: "l'État dans lequel les désirs d'une masse vicieuse sont dominés par les désirs et la sagesse d'une minorité vertueuse ".
L'objectif suprême de l'individu et de l'État est le bonheur au sens classique d'intégration, de plénitude et de participation au divin.
Dans ce but, l'État n'est pas placé comme une réalité extérieure à l'âme, mais comme une présence intime dans l'homme: s'il reste comme une simple structure extérieure, comme un simple facteur d'organisation sociale, il n'est pas l'État selon la justice. Elle le sera si elle est ordonnée dans son noyau métaphysique, dans l'idée de valeur que le véritable État a en commun avec le juste citoyen. C'est pourquoi - comme on l'a souligné - entre la réalité de cette dernière et la réalité de l'individu il n'y a pas de différence ontologique, mais en tout cas une distinction de possibilité et d'intensité, à partir du moment où la polis représente le centre de tension pour que le citoyen devienne eudaimon (heureux).
Mais quelle valeur ou fonction l'État représente-t-il devant le citoyen ? Il est évident - selon ce que nous avons essayé de mettre en évidence auparavant - que le problème - tel qu'il est présenté - ne concerne que ceux qui, interprétant en termes duels les termes d'État et de citoyen, renvoient la même altérité à la conception platonicienne. Deux thèses suscitent à cet égard un intérêt prédominant : la première se réfère à ceux qui présentent l'État platonicien comme un État totalitaire ; la seconde est propre à ceux qui attribuent à la Politeia une "fonction éthique" au service de l'âme individuelle.

En ce qui concerne la thèse qui divise dans la Politeia platonicienne les éléments typiques des régimes totalitaires, nous considérons que l'idée de convertir l'État en une entité "divinisée" devant laquelle la personne doit se sacrifier et à laquelle elle doit renvoyer la raison de ses propres actions, est complètement étrangère à la position platonicienne. Si l'on considère toutes les fonctions, ou plutôt les applications, du totalitarisme, la comparaison de celui-ci avec un système qui - comme le Polythea - est basé sur l'identité entre l'économie intérieure de l'âme individuelle et la vie de l'État, est manifestement absurde. Si dans l'État platonicien émergent des éléments capables de conformer en apparence la thèse d'un État "centralisateur", ce n'est pas d'un État totalitaire dans ses dimensions typiques qu'il s'agit ici. Dans le système totalitaire, l'unité est imposée de l'extérieur, non pas sur la base d'un principe émanant d'en haut, d'une autorité naturelle et reconnue, mais d'une partie d'un pouvoir politique matérialiste. Ceci est affirmé comme l'une des dernières implications - dans la sphère politique - de la décadence qui avait déjà commencé avec la séparation de l'élément humain, séculier, de l'élément sacré. La sclérose typique de l'État totalitaire, l'instinct de tronquer toute harmonie et toute liberté différenciée qu'il veut atteindre, l'absolutisation conférée à la sphère inférieure des besoins humains et d'autres éléments qu'il est inutile de souligner ici, sont en antithèse radicale avec les formes organiques de l'État platonicien, avec la multiplicité et la vivacité des fonctions présentes en lui, avec l'Idée transcendante sur laquelle il repose. Plus exactement, les articulations différenciées et organiques de l'État platonicien sont telles qu'il ne faut pas parler de totalitarisme, mais d'un "ordre total", qui se présente par rapport au citoyen avec les mêmes caractères du cosmos au niveau individuel. Les préoccupations du gouvernant "idéal" ne s'identifient donc pas aux instances vulgaires qui donnent la prééminence - dans le cadre des formes étatiques que les temps modernes développent - aux facteurs matérialistes, économiques et technicistes : pour Platon, la politique reste toujours adhérente à un canon normatif et à une fonction formative qui, en tant que telle, assume l'âme du citoyen et ses inclinations comme son propre sujet.
Mais à ce stade, il est nécessaire de prendre position contre la thèse opposée, qui voulait attribuer à l'État platonicien la fonction d'auxiliaire de la morale individuelle et à l'activité politique celle de subordonné à celle-ci.

Nous considérons que la thèse du fondement moral de l'État platonicien est valable pour restreindre le Polythea dans les limites d'une activité purement temporelle, humaine, génératrice de " vertus " au sens moderne du terme : sans le situer, donc, dans le domaine qui lui est propre.
Or, selon nous, la polis représente dans le système platonicien l'élément de médiation qui favorise la réintégration du citoyen dans la réalité divine : à travers l'État, le citoyen parvient à dépasser la simple éthique individuelle pour s'ouvrir à une réalité qui le transcende. L'État platonicien ne doit donc être considéré ni comme une fin (un État totalitaire, une entité séculaire sublimée et divinisée) ni comme un élément fonctionnel limité à la conscience de l'homme. Si l'on veut, on peut également dire que l'État est "en fonction" du rapport harmonique entre les puissances de l'âme, bien qu'il faille noter que pour Platon, fonder la justice in interiore homine ne signifie nullement limiter une telle réalisation à l'intérieur de la conscience humaine, puisque, comme le dit Platon, en exprimant Dieu tout bien, par conséquent aussi l'accomplissement juste de tout effort pour devenir juste signifie tendre à devenir semblable à Dieu.
La justice dans l'âme constitue le présupposé de l'ascension vers le divin : c'est l'État qui, lorsque la justice est atteinte, induit chez l'individu une tension anagogique vers le supra-humain. Par conséquent, ce qui est la morale individuelle, au contact de l'ordre représenté par l'État, s'ouvre, s'intensifie, s'objective, se convertit en une éthique absolue, déconnectée de ces traits de simple "vertu" que les modernes sont amenés à lui attribuer.
Ainsi - selon nous - lorsque nous parlons de la priorité de l'homme sur l'État selon Platon, nous nous enfermons dans une abstraction aussi absurde que celle qui résulte de l'attribution d'une dimension totalitaire à la Polythéa. Platon ne parle pas des hommes tels que nous sommes amenés à les concevoir : les hommes de Platon sont des êtres différenciés, qui possèdent chacun une certaine catégorie, une liberté différente, un style différent.
Ces hommes sont supposés être l'objet du travail de l'État, et leur perfection est la fin à laquelle l'ordre étatique est subordonné. A ce propos, nous avons parlé de la fonction analogique de l'ordre politique, ou plutôt de ce qui constitue sa légitimation : cultiver, susciter, soutenir les dispositions de ceux qui y sont organiquement insérés, et agir en fonction de ce qui dépasse la simple individualité.
Cela est possible dans la mesure où la Polythéa, incarnation de la justice, se présente comme un ordre qui participe hiérarchiquement à la " stabilité " au sens spirituel, comme le reflet " effectif " du monde de l'être, c'est-à-dire de l'idée du Bien, sur le devenir.
Seuls les modernes peuvent concevoir l'existence d'un ordre politique qui revendique sa propre légitimité et le destin même de la vie associé au purement temporel : tout comme il appartient à la décadence des modernes de penser que seul l'ordre "moral" pose le problème de la fin ultime de l'homme. Dans la Politeia platonicienne - comme ailleurs dans tous les régimes politiques "normaux" - l'État est soutenu par une puissance non humaine, par une idée et par une signification étrangère : par conséquent, en tant qu'expression d'une réalité supérieure, l'État doit aussi être un "chemin" vers elle.
En conclusion, chez Platon, l'instance politique est légitimée par des valeurs supra-individuelles et c'est la tâche de l'État d'assigner à ces valeurs leur place dans un ordre complet, afin de réaliser dans un sens supérieur la justice. L'État détermine donc la direction à suivre pour que les citoyens vivent dans la pratique des valeurs sur terre et méritent l'eudamonia (bonheur) que les Dieux accordent à ceux qui vivent selon la justice.
Le régime platonicien émerge d'une idée déterminée du destin de l'homme et des devoirs qui lui sont imposés : dans cet état, les gouvernants ont les yeux dirigés vers l'idée du Bien à laquelle ils tentent d'adhérer par leur action politique. Il ne s'agit ni du bien de l'âme individuelle en tant que " pratique de la vertu ", ni du bien de l'État : mais du Bien absolu, du principe divin qui n'apparaît que sous une forme impersonnelle ; du suprême, en tant que tel supérieur à l'existence - car rien n'existe sans lui - et à l'essence, car il ne peut être conclu dans aucune définition.
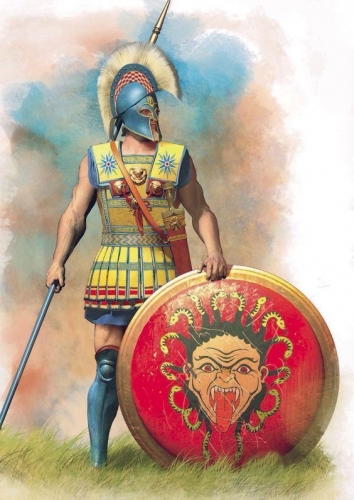
C'est en ces termes que se réduit le sens de la Politeia platonicienne : découlant de l'existence d'un " bonheur " fondateur, elle " ordonne " les moments par lesquels l'homme parvient au bout du chemin, précisément à l'eudaimonio, qui consiste en sa participation au divin. L'État ne peut exister sans une tension de la volonté de l'homme (surtout de l'homme-philosophos) d'adhérer au Bien authentique, mais il est vrai à son tour, réciproquement, que seule cette Politeia peut permettre au sage de s'élever à l'idée du Bien.
Ce n'est que dans la polis parfaite que le sage opère en réalisant cette perfection intégrale, ce "bonheur" auquel il aspire : l'action politique s'impose donc au sage comme ce qui doit être fait. C'est pourquoi il doit redescendre dans la grotte pour instruire et gouverner les prisonniers. Le mythe de la caverne n'a pas d'autre sens : l'homme politique a la vocation d'opérer en termes politiques et opérer en termes politiques signifie conduire à la vraie réalité - qui est la réalité divine - des gouvernés. C'est précisément par rapport à cette signification antérieure que le caractère dominant de l'État a été considéré comme celui de la médiation, de la relation : c'est-à-dire de la "voie" qui relie l'existence humaine à la réalité supra-humaine.
Et c'est à cette direction ascendante qu'il faut se référer pour considérer la Polythéa platonicienne, œuvre née à une époque qui présentait déjà des éléments de rupture, comme une tentative organique de restaurer non pas tant l'aspect politique extérieur que le sens et la position de l'homme dans son rapport avec la réalité divine.
11:50 Publié dans Définitions, Philosophie, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : platon, giorgio freda, état, république, politeia, philosophie, philosophie politique, théorie politique, sciences politiques, politologie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mercredi, 27 octobre 2021
Réflexions sur l'Europe, le déclin et le renouveau hespérialiste - Entretien avec David Engels

Réflexions sur l'Europe, le déclin et le renouveau hespérialiste
Entretien avec David Engels
14:29 Publié dans Entretiens, Histoire, Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : david engels, histoire, livres, entretiens, philosophie politique, déclin |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
dimanche, 24 octobre 2021
Georges Sorel, notre maître. Le livre de Pierre Andreu
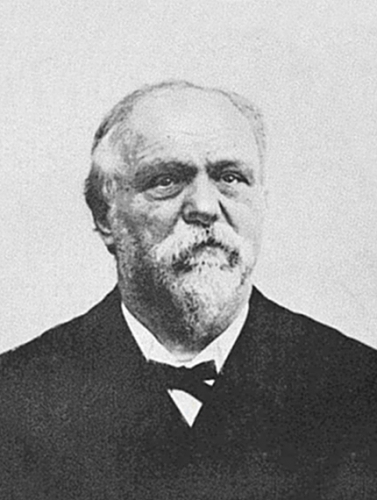
Georges Sorel, notre maître. Le livre de Pierre Andreu
par Gennaro Malgieri
Ex: https://www.destra.it/home/georges-sorel-il-nostro-maestro-il-libro-di-pierre-andreu/
Pierre Andreu est l'une des grandes figures oubliées de la culture politique du vingtième siècle. On lui doit pourtant d'importantes études sur Max Jacob, Drieu La Rochelle et surtout Georges Sorel. Ce manque de mémoire est dû aux préjugés dont il a fait l'objet, animés principalement par les intellectuels de la gauche française de l'après-guerre qui ne lui pardonnaient pas son amitié avec le philosophe catholique Emmanuel Mounier et l'ancien ministre de Vichy Paul Marion. Mais c'est surtout sa "révision" de la pensée de Sorel, qu'il appelait "Notre maître" dans l'essai que nous recensons ici, qui a alimenté le ressentiment de la gauche à son égard.
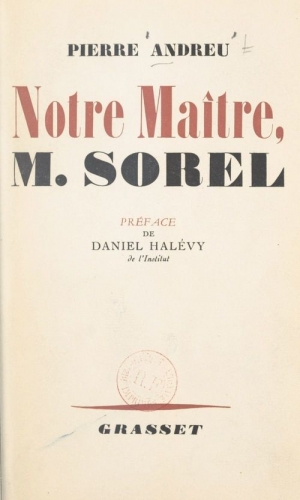
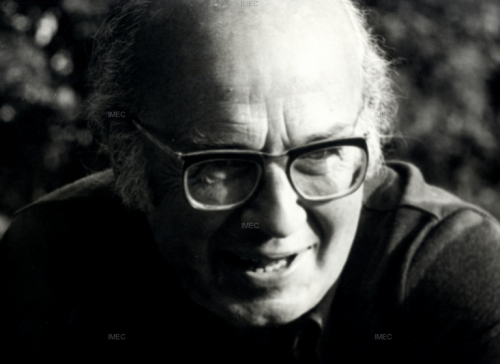
Sorel était sans aucun doute un grand maître à penser : en témoigne le travail qu'il a mené avec passion pour démonter la théorie marxiste, fournissant ainsi au syndicalisme révolutionnaire naissant les armes pour s'opposer à l'exploitation du prolétariat dans le cadre plus large de la crise de civilisation dans laquelle il était inévitablement impliqué, comme la bourgeoisie d'ailleurs. Des classes sociales victimes du progrès, responsables de la décadence morale et sociale que Sorel a dénoncée dans un ouvrage aussi mince qu'efficace et passionnant : Les Illusions du progrès.
Journaliste, essayiste, biographe et poète, Pierre Andreu est né le 12 juillet 1909 à Carcassonne, dans le département de l'Aude en Occitanie. En tant qu'étudiant, il est fasciné par les œuvres de Charles Péguy, Pierre-Joseph Proudhon et Georges Sorel, avec lesquels il se lie d'amitié, malgré l'énorme différence d'âge. Et ce n'est pas par hasard, mais par véritable gratitude, que ce livre, dédié à son ami et maître, s'ouvre sur ces mots: "J'ai rencontré Sorel dans l'atelier de Péguy. À cinquante ans, avec sa barbe blanche, il avait l'air d'un vieillard dans cet endroit qui mesurait à peine douze mètres carrés et où personne ne touchait aux trente ans". Une intense entente s'établit entre le vieil homme et le jeune homme, qui se traduira par les livres que l'élève consacrera des années plus tard au penseur, ainsi que par les choix intellectuels et politiques ultérieurs qui le conduiront, de manière apparemment contradictoire, près de Mounier et de sa revue catholique Esprit et de l'anarcho-fasciste Drieu La Rochelle. À la fin des années 1930, Andreu se définit comme un fasciste. Et malgré ce choix difficile, il reste proche de Max Jacob, dont il admire la poésie et la peinture, ainsi que la rectitude morale: anti-nazi, il est mort dans un camp.
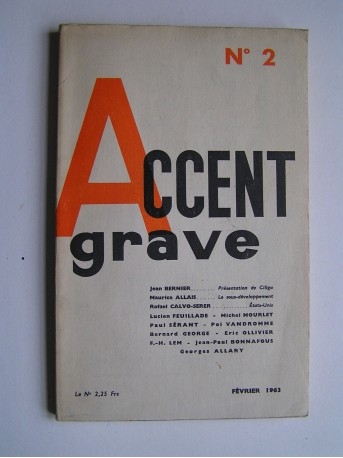
Andreu connaît un meilleur sort à la fin de la guerre: il est fait prisonnier et, après avoir purgé sa peine, il met en place de nombreuses activités culturelles et éditoriales, dont l'Accent grave (revue de l'Occident), lancé en 1963 avec Paul Sérant, Michel Déon, Roland Laudenbach et Philippe Héduy, quelques-uns des meilleurs représentants de la pensée conservatrice française de l'époque. Le magazine s'inspire des idées de Charles Maurras et se concentre sur la crise de la civilisation occidentale. Andreu est ensuite directeur du bureau de l'ORTF à Beyrouth de 1966 à 1970, où il entre en contact avec des intellectuels arabes et palestiniens et devient ensuite directeur de la chaîne de radio France Culture.
En 1982, il a reçu le prix de l'essai de l'Académie française pour son ouvrage Vie et mort de Max Jacob. Dans les dernières années de sa vie, Andreu a soutenu François Mitterrand, sans oublier son ancien maître, au point de reprendre la rédaction des Cahiers Georges Sorel.
Pierre Andreu est mort le 25 mars 1987 à l'âge de 77 ans, écologiste et pacifiste, témoignant jusqu'au bout de son étonnante irrégularité intellectuelle malgré la cohérence d'une pensée inspirée par la lutte contre la décadence.
Parmi ses ouvrages les plus importants, citons Drieu, témoin et visionnaire, préfacé par Daniel Halévy ; Histoire des prêtres ouvriers ; l'essai sur Max Jacob déjà cité ; Les Réfugiés arabes de Palestine ; Le Rouge et le Blanc : 1928-1944 (mémoires) ; avec Frédéric Grover (1979), Drieu La Rochelle ; Georges Sorel entre le noir et le rouge ; Poèmes ; Révoltes de l'esprit : les revues des années 30.
Sorel, notre maître, est déterminant dans l'interprétation des idées de l'idéologue français. Il est si décisif qu'Andreu en fait une sorte de "prophète" du déclin en reconstruisant sa critique profonde des conséquences des Lumières, des résultats de la Révolution française et donc du produit plus mûr des deux événements, intellectuel et politique, qui ont changé l'histoire de la pensée européenne : le marxisme. C'est entre 1897 et 1898 que Sorel prend conscience de l'inanité du socialisme marxiste pour changer le destin des classes populaires et forger en même temps une nouvelle société.
Lorsque la crise du parti socialiste éclate, grâce aux critiques impitoyables de Bernstein et Lagardelle, Sorel se range sans hésiter du côté des réformateurs et attaque le marxisme en affirmant qu'il n'est "pas une religion révélée". Andreu ajoute qu'à la même époque, le Maître a fait la grande découverte de sa vie : le syndicalisme dans lequel il voyait l'avenir du socialisme. Le syndicalisme consiste, essentiellement, en une action autonome des travailleurs. Ainsi, ce ne sont plus les partis, les associations affiliées aux cliques politiques, le parlementarisme comme élément d'acquisition de pouvoirs indus qui auraient pu faire bouger un monde embaumé par la Grande Révolution. Rien de tout ça. Ce sont les travailleurs qui doivent, peut-être violemment, prendre possession de leur destin, qui coïncide avec celui de la nation.
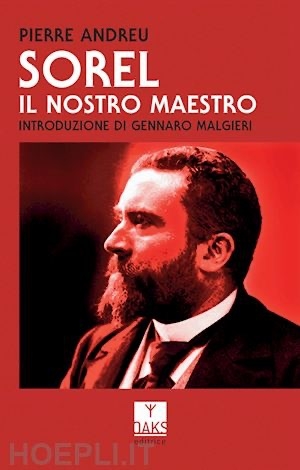
Sorel, tout en restant paradoxalement marxiste, estime, écrit Andreu, que la remise en cause du marxisme exigée par les révisionnistes au début du XXe siècle pour sauver tout ce que le marxisme avait apporté en philosophie et en recherche économique, a été réalisée par les syndicalistes révolutionnaires dans la pratique de l'action ouvrière.
C'est à Benedetto Croce que nous devons l'introduction de la pensée et de l'œuvre de Sorel en Italie. Bien qu'éloigné de l'idéologue français en termes de théorie et de pratique politique, le philosophe italien a saisi sa "proximité" tant au niveau de sa critique du marxisme que de sa rectitude morale illustrée par une vie concentrée sur l'étude et la compréhension de la modernité - nous dirions aujourd'hui - sans se laisser emporter par les modes et les utopies en vogue à l'époque. C'est ainsi que l'œuvre majeure de Sorel, Réflexions sur la violence (1906), a pu paraître en Italie grâce à Croce et influencer de manière décisive les intolérants au marxisme scolastique, à commencer par les syndicalistes révolutionnaires dont elle est devenue le "mythe" absolu, tandis que Lénine et Mussolini s'abreuvaient également à sa doctrine.
Sorel a reconnu que si pour Marx le socialisme était "une philosophie de l'histoire des institutions contemporaines", il lui apparaissait comme "une philosophie morale" et "une métaphysique des mœurs", mais aussi "une œuvre grave, redoutable, héroïque, le plus haut idéal moral que l'homme ait jamais conçu, une cause qui s'identifie à la régénération du monde". Les socialistes n'auraient donc pas à formuler des théories, à construire des utopies plus ou moins séduisantes, puisque "leur seule fonction consiste à s'occuper du prolétariat pour lui expliquer la grandeur de l'action révolutionnaire qui lui est due".
"Le socialisme est devenu une préparation pour les masses employées dans la grande industrie, qui veulent supprimer l'État et la propriété; on ne cherche plus comment les hommes s'adapteront au bonheur nouveau et futur: tout se réduit à l'école révolutionnaire du prolétariat, tempérée par ses expériences douloureuses et caustiques". Le marxisme n'est donc pour Marx qu'une "philosophie des armes", tandis que son destin "tend de plus en plus à prendre la forme d'une théorie du syndicalisme révolutionnaire - ou plutôt d'une philosophie de l'histoire moderne dans la mesure où celle-ci est fascinée par le syndicalisme. Il ressort de ces données indiscutables que, pour raisonner sérieusement sur le socialisme, il faut d'abord se préoccuper de définir l'action qui relève de la violence dans les rapports sociaux actuels".
Ici: c'est la suggestion d'un théoricien de l'histoire moderne qui rapproche Croce de Sorel, à qui il reconnaît qu'"à cause du flou de la pensée de Marx sur l'organisation du prolétariat, les idées de gouvernement et d'opportunité se sont glissées dans le marxisme, et ces dernières années, une véritable trahison de l'esprit lui-même a eu lieu, remplaçant ses principes authentiques par "un mélange d'idées lassalliennes et d'appétits démocratiques...". Les conseils de Sorel aux travailleurs sont résumés en trois chapitres, à savoir: en ce qui concerne la démocratie, ne pas courir après l'acquisition de nombreux sièges législatifs, qui peuvent être obtenus en faisant cause commune avec les mécontents de toutes sortes; ne jamais se présenter comme le parti des pauvres, mais comme celui des travailleurs; ne pas mélanger le prolétariat ouvrier avec les employés des administrations publiques, et ne pas viser à étendre la propriété de l'État; - en ce qui concerne le capitalisme, rejeter toute mesure qui semble favorable aux travailleurs, si elle conduit à un affaiblissement de l'activité sociale; en ce qui concerne le conciliarisme et la philanthropie, rejeter toute institution qui tend à réduire la lutte des classes à une rivalité d'intérêts matériels; rejeter la participation des délégués ouvriers aux institutions créées par l'Etat et la bourgeoisie; s'enfermer dans les syndicats, ou plutôt dans les Chambres de Travail, et rassembler autour d'eux toute la vie ouvrière".
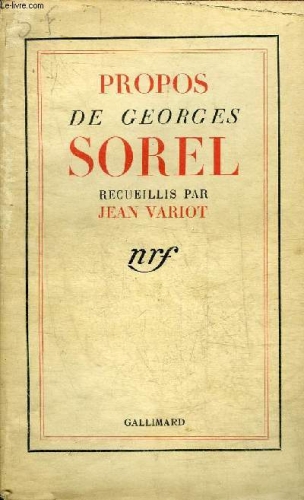
La morale révolutionnaire - qui allait au-delà du marxisme - était toute là, comme le résume Croce dans Conversations critiques. Sorel a nourri et manifesté de grandes ambitions qu'il aurait transfusées dans son enseignement doctrinaire : combattre l'indifférence en matière de morale et de droit, lutter contre l'utilitarisme, initier le peuple à la vie héroïque. Nous serions heureux, écrit-il en 1907 dans les Procés de Socrate, si nous pouvions parvenir à allumer dans quelques âmes le feu sacré des études philosophiques et à convaincre certains des dangers que court notre civilisation par l'indifférence en matière de morale et de droit.
En bref, seul un mouvement ouvrier héroïque et pur, selon Sorel, pourrait empêcher le monde de glisser vers la décadence, comme l'a observé Andreu, "en bannissant toute influence démocratique et bourgeoise (parlementaires, fonctionnaires, avocats, journalistes, riches bienveillants), en rejetant toute idée de compromis avec les patrons et en assurant une autonomie d'action complète".
Sorel était devenu un conservateur. Le spectacle français et européen l'a déprimé. Il ne voyait plus personne. Il y avait peu d'amis avec qui il échangeait des lettres et à qui il confiait son amertume. Les nouveaux révolutionnaires n'étaient pas dignes de sa leçon, même si, du moins en Italie, ils continuaient à le vénérer. Il a écrit à quelques personnes: Benedetto Croce et Mario Missiroli qui a accompagné "le dernier Sorel" vers la fin. Missiroli (photo, ci-dessous) avait l'habitude de publier ses articles dans le Resto del Carlino (il les a ensuite réunis en deux volumes: L'Europa sotto la tormenta et Da Proudhon a Lenin). Seul, malade et pauvre, il meurt le 27 août 1922. Sa chambre funéraire, raconte Daniel Halévy, était nue, le cercueil recouvert d'un tissu noir, sans croix, reposant sur un simple trépied, personne ne veillait sur lui, une flamme s'éteignait lentement.

L'homme qui avait mis le feu à l'Europe n'avait même pas les condoléances de ceux qui lui devaient tout. Et il a laissé derrière lui l'une de ses œuvres les plus impressionnantes, des Réflexions sur la violence aux Illusions du progrès et aux Ruines du monde antique : un héritage dans lequel nous ne cesserons jamais de puiser à la recherche des raisons de la décadence d'un monde et des déceptions de révolutions qui ont produit des monstruosités infinies.
Pierre Andreu, Sorel il nostro maestro, éditions Oaks, 2021, pp. 295, € 25,00.
10:17 Publié dans Livre, Livre, Philosophie, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : livre, pierre andreu, georges sorel, philosophie, philosophie politique, théorie politique, politologie, sciences politiques |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook



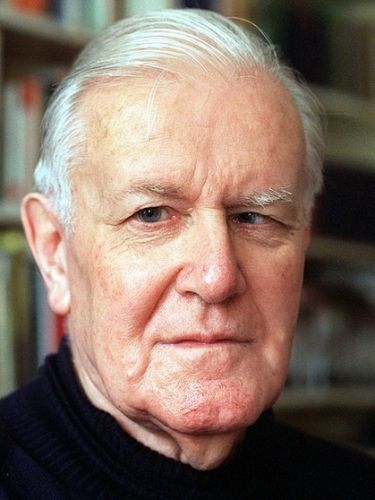
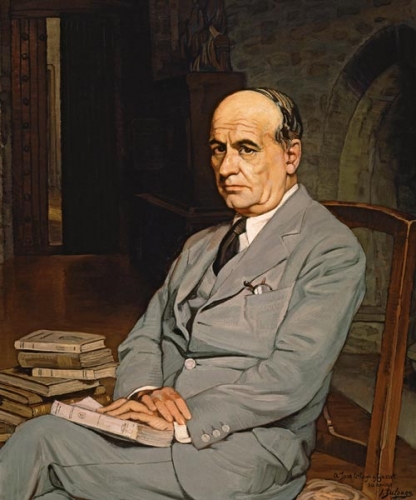
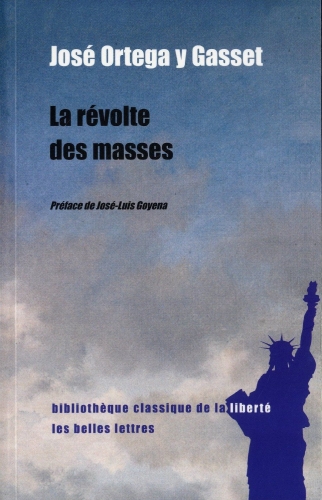 Pour me suivre sur les réseaux sociaux :
Pour me suivre sur les réseaux sociaux : 
![Légalité_légitimité_par_Carl_Schmitt_[...]Schmitt_Carl_bpt6k3040486k.JPEG](http://euro-synergies.hautetfort.com/media/00/02/3605638423.JPEG)

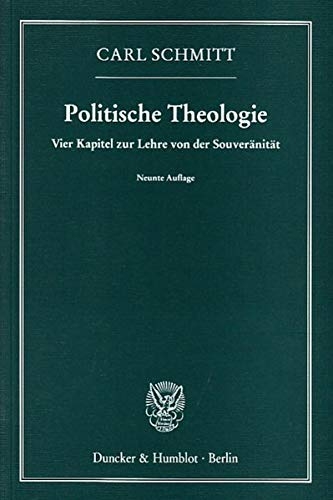
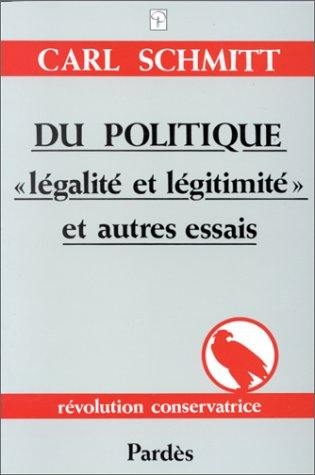
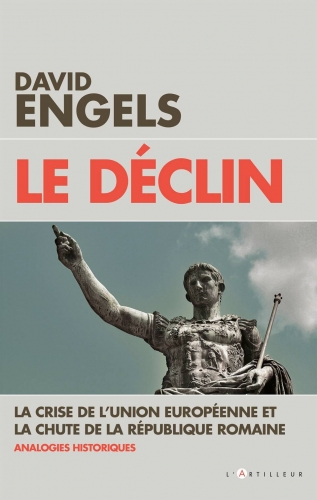
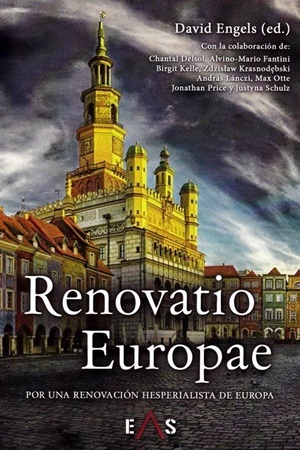
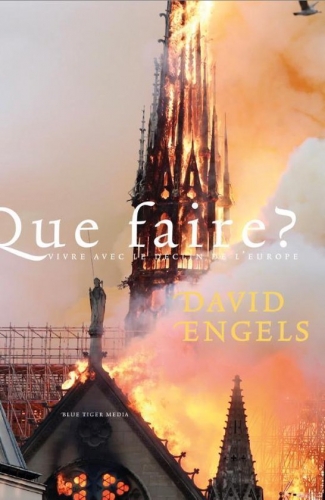
![Le_rouge_et_le_blanc_[...]Andreu_Pierre_bpt6k33717177.JPEG](http://euro-synergies.hautetfort.com/media/02/00/1484539435.JPEG)